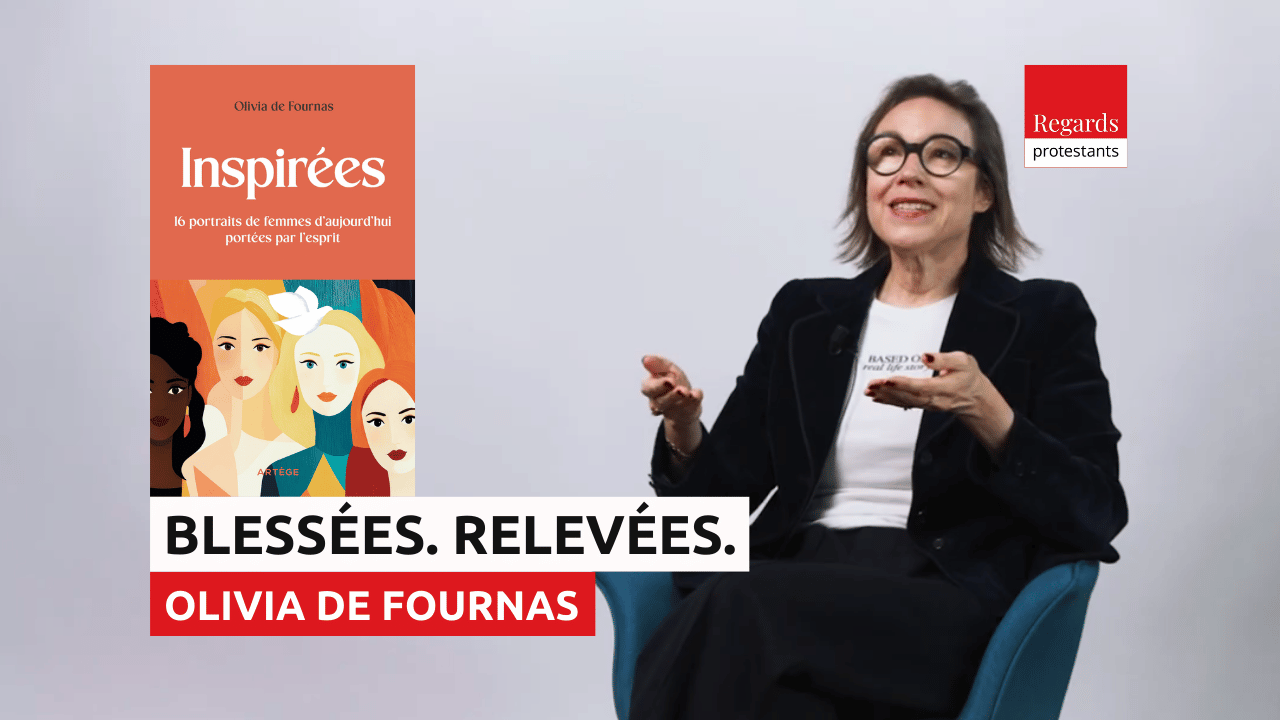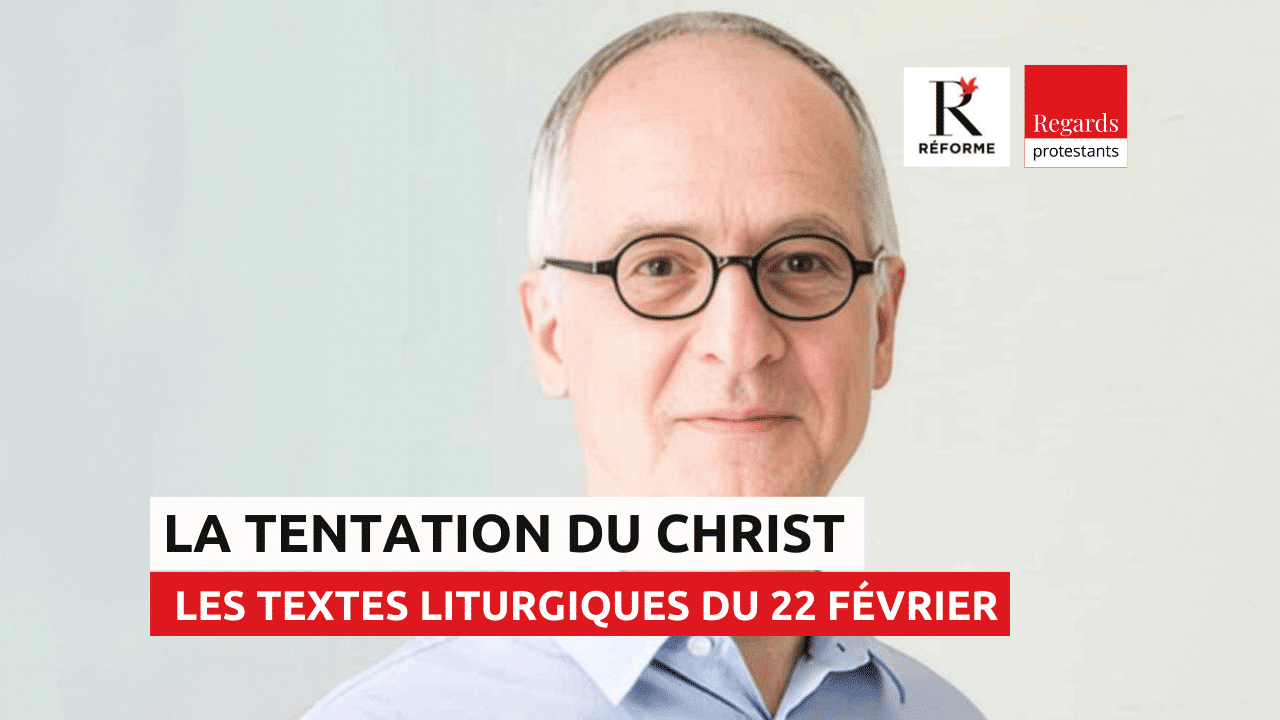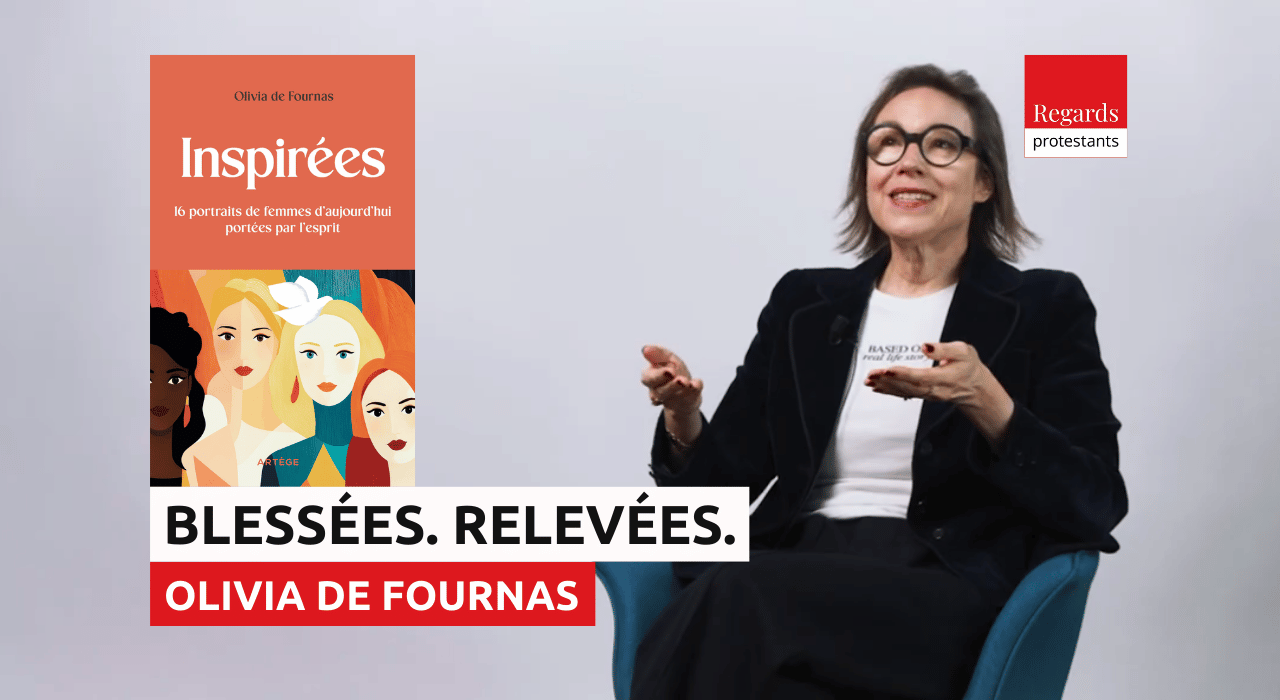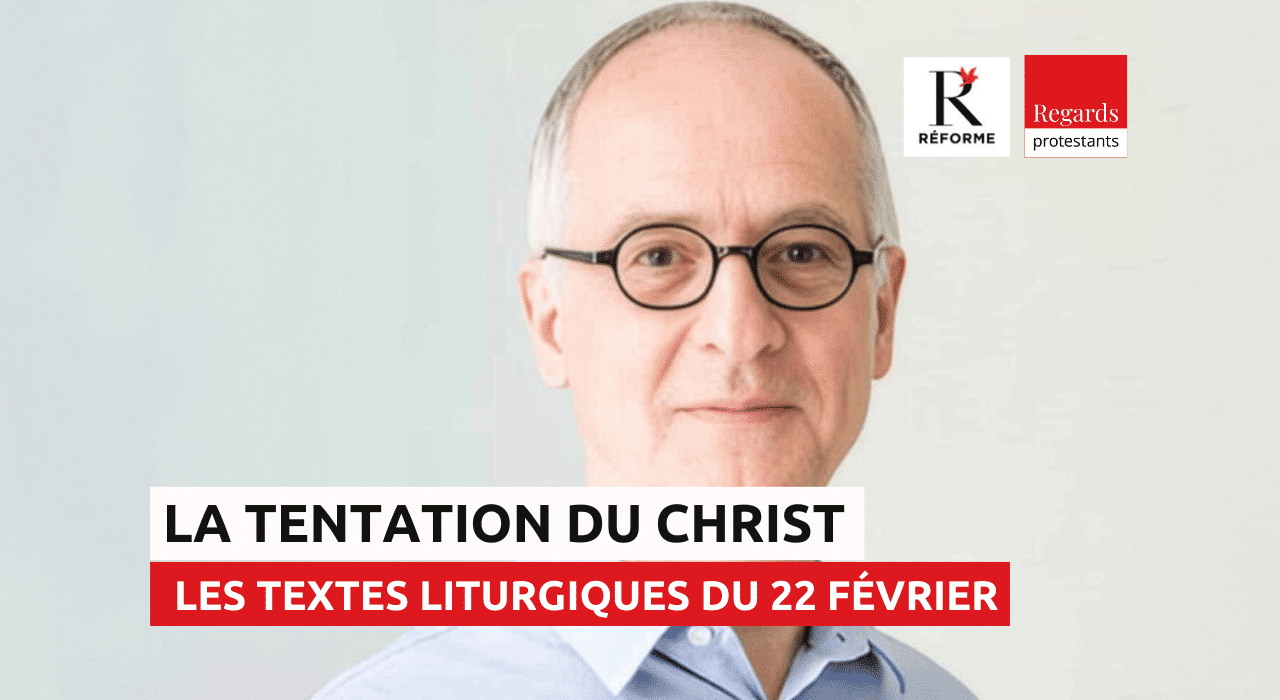L’évangile du dimanche du 12 octobre (Luc 17, 11-19)
Qu’est-ce qu’une guérison par la foi ?
Introduction
La semaine dernière, dans la parabole du serviteur qui n’a fait que son devoir, Jésus a répondu aux disciples qui lui demandait plus de foi en lui proposant plus de fidélité. C’est en vivant fidèlement sa condition de serviteur qu’on augmente sa foi. Dans le récit qui suit que nous méditons aujourd’hui, Jésus apporte une deuxième réponse à la question de la foi en l’inscrivant dans le registre de la reconnaissance.
Ce récit parle de guérison, mais celle-ci est décrite de la façon la plus laconique qui soit pendant qu’ils y allaient, ils furent purifiés. L’important dans ce récit n’est pas la guérison, mais la réaction des malades à leur guérison.
Points d’exégèse
Attention sur deux points.
La lèpre et le prêtre
La lèpre était une maladie redoutable, pratiquement inguérissable. À l’épreuve physique, s’ajoutait l’exclusion religieuse du fait de la culpabilité qui accompagnait la maladie et la mise en quarantaine sanitaire pour éviter la contagion. Les lépreux étaient appelés « maudits de Dieu », ils vivaient entre eux en marge de la société des bien-portants. S’ils étaient guéris, il devait faire enregistrer leur guérison par le prêtre avant de réintégrer la vie sociale.
Dans notre récit, lorsque Jésus demande aux lépreux d’aller trouver le prêtre, il préfigure leur guérison.
Évangile à coups de marteau
Jésus donne en exemple la foi d’un Samaritain, comme il avait donné en exemple la compassion d’un autre de ces mauvais croyants dans la parabole dite du bon Samaritain. Jésus n’hésite pas à faire de la théologie à coups de marteau en choquant ses interlocuteurs lorsqu’il présente comme modèle de foi un centurion (Lc 7.9), une femme pécheresse (Lc 7.47), un collecteur des taxes (Lc 18.14, 19.9) et maintenant un Samaritain. Il met en pratique son évangile qui dit que les grands sont les petits et les petits des grands. Il renverse les catégories en mettant en avant les méprisés, les mauvais croyants, les rejetés de la bonne société religieuse.
Pistes d’actualisation
1er thème : Le Samaritain revient sur ses pas
Quand les lépreux étaient malades, ils étaient tous ensembles, les juifs et les samaritains car avant cela, ils étaient tous lépreux. Dans leur guérison, les vieilles oppositions réapparaissent puisqu’une scission s’opère dans le groupe entre ceux qui vont voir le prêtre et celui qui revient sur ses pas. Le verbe grec traduit un verbe hébreu qui est celui de la conversion, du retour vers Dieu.
Le Samaritain fait le parcours de la foi en trois temps : il voit – il revient sur ses pas – il rend gloire à Dieu. La foi consiste à voir le monde comme Dieu le voit – à changer de direction et de comportement pour répondre à ce que nous avons vu – et enfin d’être capable de reconnaissance pour tout ce qu’il y a de beau et de bon dans notre histoire.
2e thème : Ta foi t’a guéri – la foi et les miracles
Souvent nous nous disons que si nous pouvions être témoins d’un vrai bon gros miracle, notre foi serait renforcée. Ce texte dit l’inverse. La guérison de la lèpre est un gros miracle, mais seulement un dixième, dix pour-cent, des guéris a transformé sa guérison en foi.
Au Samaritain seul Jésus déclare que sa foi l’a sauvé, ou que sa foi l’a guéri (le verbe a les deux sens). Dix ont été guéris. Neuf ont été guéris parce qu’ils ont eu de la chance, parce qu’ils ont su s’adresser à la bonne personne, parce qu’ils ont bien fait ce qui leur était demandé, et un est guéri par la foi, celui qui a rendu grâce à Dieu.
3e thème : Nos guérisons
Nous tous qui lisons cet évangile, si nous sommes vivants, c’est que nous avons été guéris. Nous avons été malades, plus ou moins gravement, à un moment de notre vie et nous ne le sommes plus, ou nous avons appris à vivre avec notre maladie.
Qu’avons-nous fait de nos guérisons ? Est-ce que nous avons pensé qu’elles étaient normales, que nous les méritions car nous avons suivi sagement les prescriptions du médecin ou est-ce que nous avons transformé notre rétablissement en guérison par la foi en rendant grâce à Dieu ?
Dans ce récit, la foi se confond avec notre capacité à rendre grâce pour ce qu’il y a de beau et de bon dans notre histoire.
Une illustration : L’étudiant et l’aumônier
Une histoire vraie qui m’a été racontée. Un étudiant est renversé par une voiture alors qu’il était en vélo. Comme il n’avait pas de casque, il est touché à la tête et il perd connaissance. Quand le SAMU arrive, il a repris connaissance et il est conduit à l’hôpital. Au médecin qui l’ausculte, il demande s’il y a un aumônier à l’hôpital et s’il peut le voir. La médecin le rassure : « N’ayez pas peur, vous n’allez pas mourir ! » L’étudiant répond : « Je ne veux pas voir l’aumônier parce que j’ai peur de mourir, mais je veux rendre grâce avec lui parce que je ne suis pas mort. »
L’épisode de la guérison des dix lépreux (Luc 17, 11-19) est l’un des récits les plus saisissants de l’Évangile : entre Samarie et Galilée, dix hommes exclus du monde crient leur détresse à Jésus. « Maître, prends pitié de nous ! » lancent-ils de loin, car la loi leur interdit toute proximité. Jésus ne les touche pas, ne prononce aucun mot de guérison ; il leur dit simplement : « Allez vous montrer aux prêtres. » C’est sur le chemin, en obéissant à cette parole, qu’ils découvrent qu’ils sont purifiés.
Le texte souligne la charge symbolique de la lèpre : maladie redoutée, synonyme du mal qui défigure et exclut. À cette époque, toutes les affections de peau (psoriasis, eczéma, gale) pouvaient être assimilées à la lèpre. Le lépreux est alors mis à part, vivant aux marges de la société, dans un « no man’s land » entre humanité et nature sauvage. Jésus ne se contente donc pas de guérir un mal physique : il restaure des vies brisées, réintègre ces êtres dans la communauté humaine.
Mais l’essentiel du récit réside dans la réaction des dix guéris. Neuf poursuivent leur route vers les prêtres pour faire constater leur guérison. Un seul, un Samaritain, c’est-à-dire un étranger, rebrousse chemin, glorifie Dieu à pleine voix, tombe aux pieds de Jésus et lui rend grâce. À lui seul, Jésus déclare : « Lève-toi et va, ta foi t’a sauvé. »
La nuance est décisive. Tous ont été guéris ; un seul a été « sauvé ». La différence ne réside pas dans la santé retrouvée, mais dans la reconnaissance. Ce Samaritain comprend que la guérison n’est pas seulement un fait médical ou religieux, mais un don reçu et qu’il faut remercier le donateur.
Ainsi, la foi n’est pas seulement confiance ou obéissance : elle est mémoire et gratitude. Rendre grâce devient le signe même de la foi. Les neuf autres ont sans doute été « raisonnables », obéissants ; mais seul celui qui revient sait à qui dire merci. Dans cette reconnaissance, il retrouve non seulement la santé, mais la joie et la plénitude d’une vie restaurée.
La deuxième épître à Timothée du dimanche 12 octobre (2 Timothée 2.8-13)
Le combat de la foi
Le contexte – La deuxième épître à Timothée
La deuxième épître à Timothée est adressée à un responsable d’une Église qui doit affronter le défi de la durée. Si les grandes épîtres pauliniennes étaient tendues vers la venue imminente du Christ, les épîtres pastorales témoignent d’une Église qui doit s’équiper pour résister à l’usure du temps.
Pour encourager son serviteur, Paul – ou un disciple qui parle en son nom – invite Timothée à l’imiter dans sa communion avec le Christ.
Que dit le texte ? – Vivre en Christ
Dans ces quelques versets, l’épître évoque quatre thèmes pour entretenir notre fidélité.
La mémoire. Souviens-toi de Jésus-Christ, qui s’est réveillé d’entre les morts. Chaque fois que je me sens menacé par le doute, je m’arrête, je m’assoie et je relis mon histoire et je me souviens. À chaque fois j’observe le même résultat : je me relève et je reprends ma marche à la suite de l’Évangile.
La liberté. Même si Paul est en prison, la parole de Dieu n’est pas prisonnière. On peut emprisonner des humains pour délit d’opinion, il n’est pas possible d’emprisonner une parole, surtout quand c’est une parole de grâce et de liberté.
L’espérance. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. La foi nous assure que notre vie est plus grande que les limites de notre existence. Si nous perdons notre vie à être fidèle, cette perte est précieuse au regard de l’éternité de Dieu.
La grâce. Si nous manquons de foi, lui demeure digne de foi. Si notre foi en Christ est fragile, sa foi en nous est solide. La vérité du Christ ne dépend pas du nombre de personnes qui la professent, elle est plus sûre que nos doutes, plus solide que nos hésitations et nos reniements.
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – La guérison des dix lépreux
Le passage de l’évangile de ce dimanche évoque pour nous une définition de la foi qui repose sur notre capacité à rendre grâce pour toutes les guérisons et les bénédictions de notre histoire.
À tous les conseils de ce passage de la seconde épître à Timothée pour nous encourager dans notre chemin de foi, nous pouvons ajouter la reconnaissance et l’action de grâce. La louange comme nourriture de la foi.
Comme le disait un sage : « Si toutes les mers étaient de l’encre, tous les étangs plantés de calames et si les cieux étaient des parchemins, cela ne suffirait pas pour écrire tous nos sujets de reconnaissances. »
Le livre des Rois du dimanche 12 octobre (2 Rois 5.14-17)
Que faire de nos guérisons ?
Le contexte – Le cycle d’Élisée
La première partie du deuxième livre des Rois rapporte le cycle d’Élisée, le disciple et successeur d’Élie. Il accomplit un certain nombre de miracles dont plusieurs trouvent des parallèles dans les évangiles : guérison d’un lépreux, multiplication des pains, relèvement d’un enfant. D’autres miracles peuvent être qualifiés de secondaires, voire inutiles, comme de maudire deux enfants qui ont été dévorés par une ourse, de donner du goût à une soupe insipide ou de faire flotter une cognée. Le récit de la guérison de Naaman relève de la première catégorie non en ce qu’on retrouve un récit parallèle dans les évangiles, mais en ce le message de cette guérison fait écho au message de Jésus.
Que dit le texte ? – La conversion de Naaman
Naaman est un chef syrien qui est affecté par la lèpre. Une petite servante israélienne lui parle d’un prophète dans son pays qui est capable de le guérir. Le général va trouver son roi qui l’envoie en Israël avec une lettre qui demande au roi de le guérir. Le roi d’Israël craint un piège, mais Élisée fait savoir à Naaman qu’il est prêt à le recevoir. Le prophète lui propose de se déshabiller et de se baigner sept fois dans le Jourdain. Naaman s’attendait à des invocations religieuses plus sophistiquées, mais il finit par accepter et se trouve libéré de sa lèpre.
Une fois guéri, le voyage de Naaman en terre d’Israël a atteint son but : c’est une pleine réussite. Il pourrait décider de rentrer dans son pays pour profiter de sa guérison, mais il veut d’abord retourner auprès d’Élisée pour témoigner de sa guérison. Comme le prophète refuse l’argent qu’il lui propose, il demande la possibilité d’emporter avec lui un peu de terre d’Israël pour faire mémoire du Dieu qui l’a guéri.
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – La guérison des dix lépreux
Dans le récit de la guérison des dix lépreux, seul celui qui est retourné sur ses pas pour rendre grâce à Dieu est guéri par la foi. Comme Naaman, il ne s’est pas contenté de profiter de la grâce reçue, il a voulu y répondre dans une action de grâce de sa part. Dans les deux récits, la foi réside dans la réponse apportée aux grâces reçues.
Ces deux récits peuvent inspirer notre témoignage. Dans le dialogue avec celles et ceux qui se déclarent athées, on peut leur suggérer de revisiter les moments où, dans leur existence, ils ont vécu des moments de grâce, de beauté et de bonté. Qu’en ont-ils fait ? Ils ont pu penser que c’était des coups de chance, mais comme Naaman ou le lépreux samaritain, ils peuvent aussi s’interroger sur l’origine de la grâce et chercher à qui et comment rendre grâce.
Production : Fondation Bersier – Regards protestants
Intervenants : Antoine Nouis, Christine Pedotti