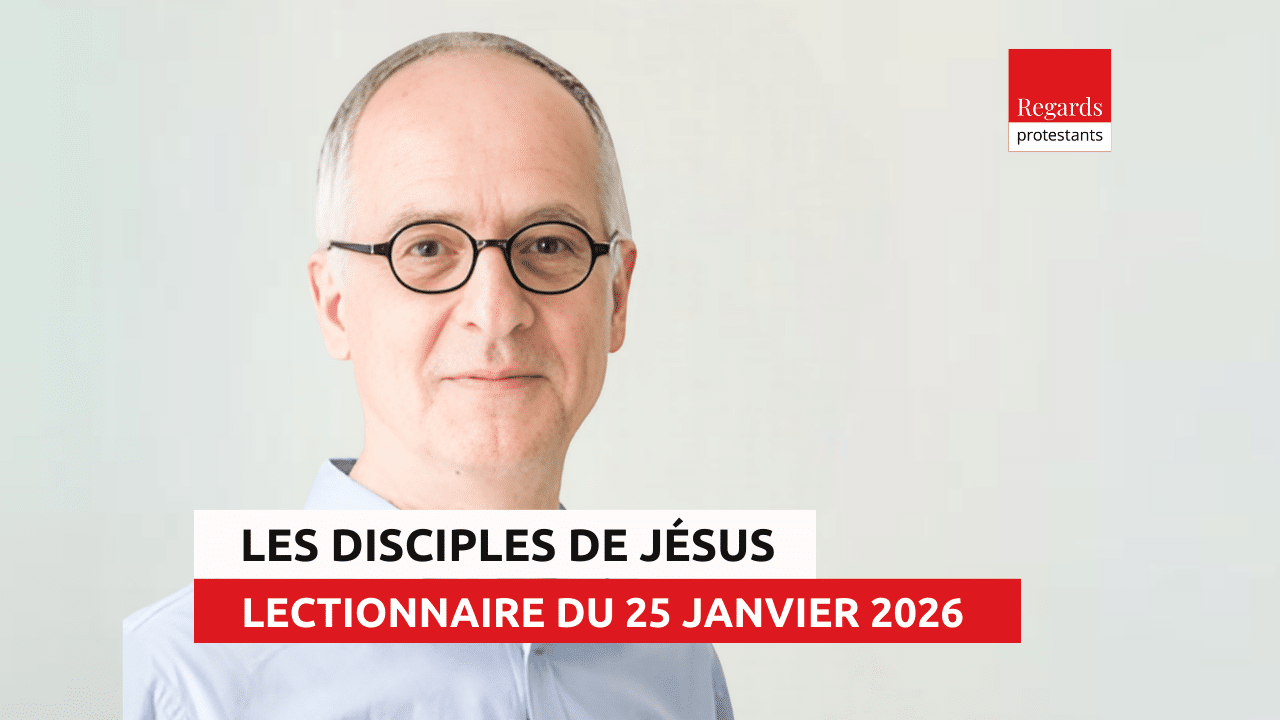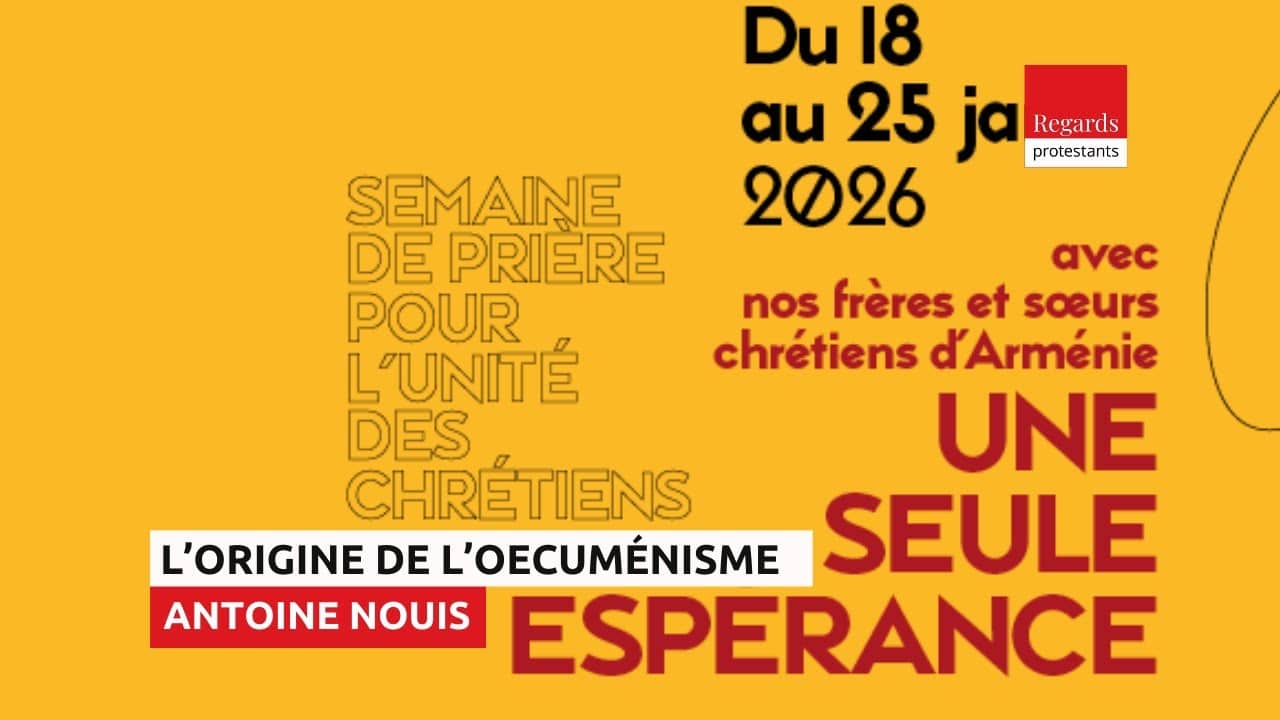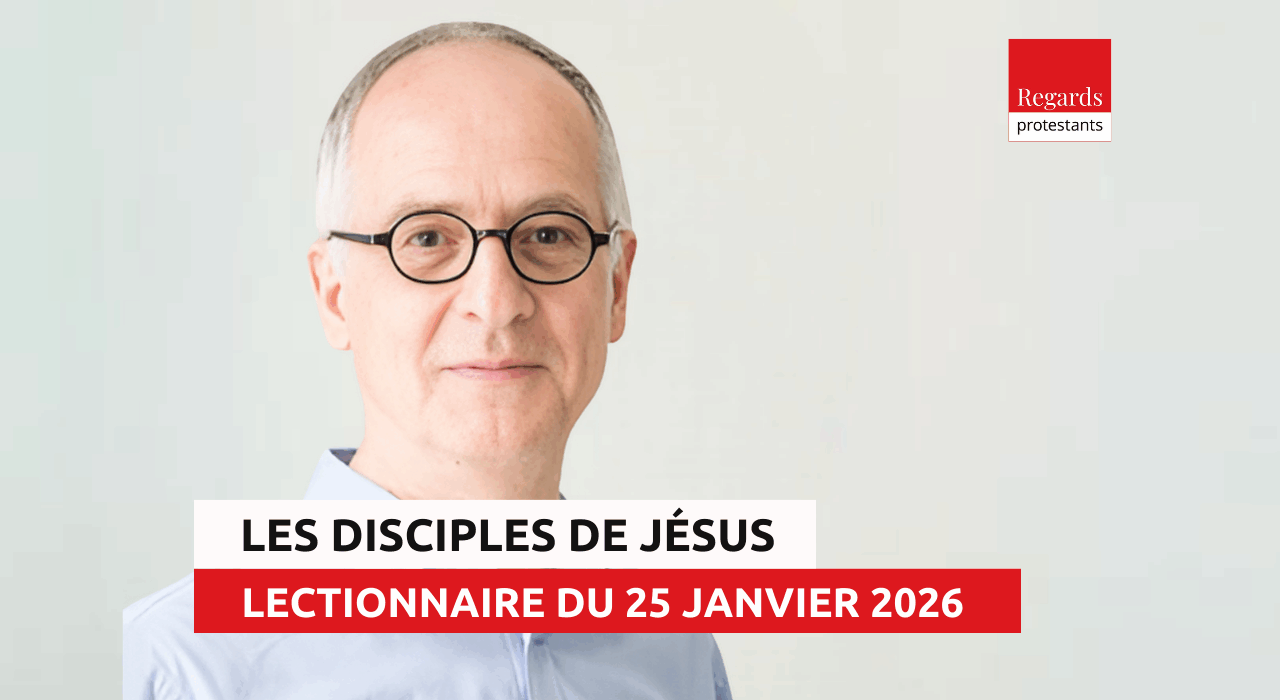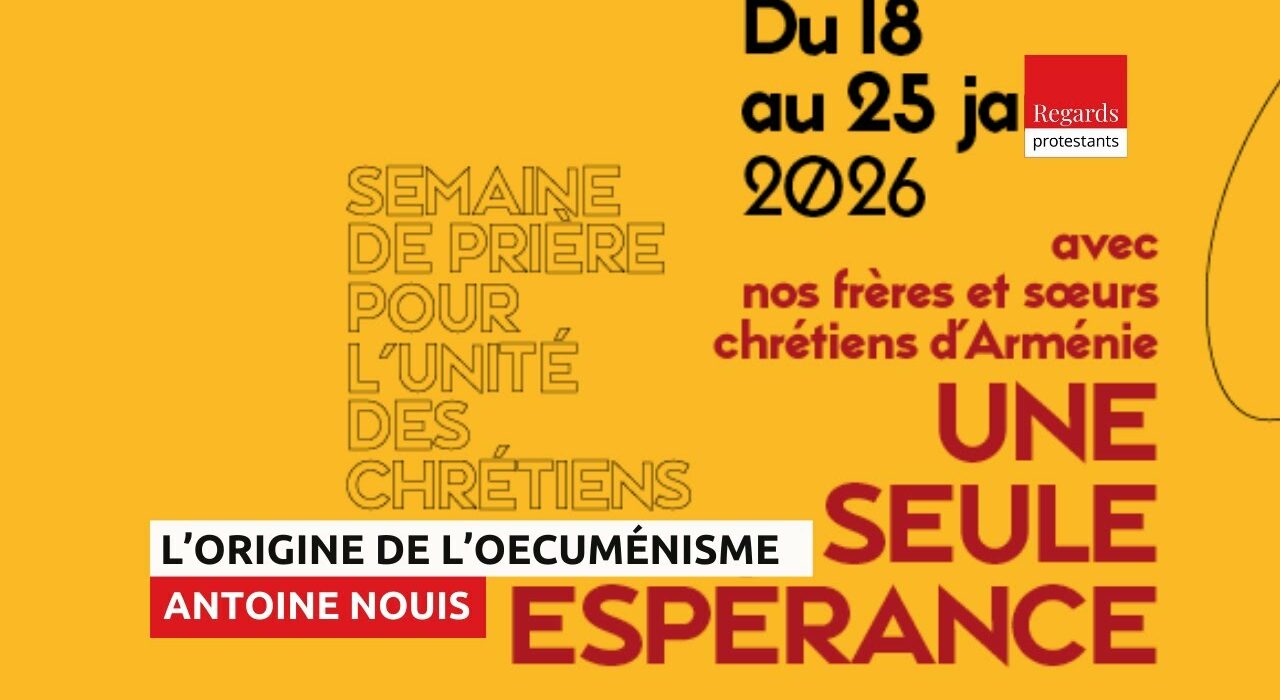L’évangile du dimanche du 14 septembre (Jean 3, 13-17)
Pour que le monde soit sauvé
Introduction
Nous connaissons le verset qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu’il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le protestantisme en a fait la clef de voute de sa théologie. Ce qu’on sait moins, c’est qu’il s’inscrit dans le dialogue entre Jésus et Nicodème à propos de la nouvelle naissance. Naître de nouveau – ou naître d’en haut – c’est entendre que Dieu est amour et laisser cette annonce reconstruire toute notre compréhension de Dieu.
Points d’exégèse
Attention sur deux points.
Serpent au désert
Comme Moïse a élevé le serpent au désert. Jésus fait référence à un passage du livre des Nombres. Parce que le peuple s’est plaint contre Dieu et contre Moïse, beaucoup ont été mordus par des serpents et sont morts. Le peuple se repent et Dieu demande à Moïse de faire un serpent d’airain et de le fixer en haut d’une perche. Quand un Israélite était mordu par un serpent, s’il levait les yeux et regardait le serpent d’airain, il était sauvé.
Le serpent est donc une figure ambivalente, il est porteur de mort et de vie. Ce qui est intéressant, c’est que c’est le même serpent, pour dire que notre compréhension de Dieu peut être porteuse de mort ou de vie selon le regard qu’on porte pour lui. Pour reprendre le vocabulaire de cette séquence, il peut être vu comme un Dieu de jugement ou de vie éternelle.
Vie éternelle
Dans le quatrième évangile, la vie éternelle n’est pas la vie perpétuelle comme on le croit souvent, c’est une vie inscrite dans l’éternité de Dieu. Le meilleur verset qui la qualifie est celui qui dit : « La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ[1]. »
Quand Jésus parle de vie éternelle, il ne parle pas d’une vie après la mort, mais d’une vie qui traversée, éclairée, habitée par le Dieu de toute éternité. Nous comprenons qu’elle dépasse le cadre de notre vie terrestre, mais c’est aujourd’hui que nous devons la vivre.
Pistes d’actualisation
Dieu a tant aimé le monde
Jésus ne dit pas que Dieu a aimé ceux qui croient en lui, mais qu’il a aimé le monde. Or dans le quatrième évangile, le monde n’est pas le monde gentil, mais le monde qui n’a pas accueilli la lumière dans le prologue[2] et même qui déteste Jésus[3], autrement dit, le monde hostile. Si Dieu aime le monde, ce n’est pas que le monde est aimable, mais parce que Dieu est amour. Le monde n’aime pas Dieu, mais Dieu aime le monde.
Nous comprenons que ce verset soit le cœur de l’évangile. L’amour que Dieu nous porte ne dépend pas de notre foi ni de nos bonnes œuvres, il est inconditionnel.
L’amour comme un don
L’amour de Dieu n’est pas une promesse, mais un acte qui a été posé : Dieu a tellement aimé le monde qu’il a envoyé son fils unique. Il y a une chose que même Dieu ne peut pas faire, c’est revenir sur le passé. Il ne peut plus décider de ne pas donner son fils : c’est un fait, il a habité parmi nous.
Nous retrouvons ce thème dans l’épître aux Romains dans le verset qui dit : « Voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous : le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs[4]. » L’amour dans le Nouveau Testament n’est pas une question de sentiment, ce n’est pas un élan de sympathie, mais un acte, un don. Aimer, c’est donner de sa vie pour permettre à son prochain de grandir dans toutes les dimensions de son existence.
La libération du jugement
L’amour de Dieu libère du jugement. Nous trouvons cette idée dans le verset qui dit que Dieu n’a pas envoyé son fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé et que celui qui met sa foi en lui n’est pas jugé car il est dans la lumière, alors que celui qui ne croit pas est jugé car il est dans les ténèbres.
En dehors de la foi, notre compréhension de Dieu est celle d’un juge qui tient une comptabilité de nos bonnes et nos mauvaises actions. Quand on comprend que Dieu est amour, nous sommes libérés de cette vision : Dieu ne nous juge pas, il nous a tout donné dans son fils. Nous sommes alors invités à entrer dans cette économie de la grâce.
Une illustration : Fils unique
Dieu a donné son fils unique. Comment comprendre cet adjectif alors que nous sommes tous enfants de Dieu ? Quand Dieu a donné son fils unique, il n’en a plus, il n’a plus que les humains pour dire son amour au monde.
Un apologue raconte que lorsque le Christ ressuscité est monté au ciel, il a jeté un coup d’œil à la terre pour voir une dernière fois ses apôtres. La terre était plongée dans l’obscurité, sauf quelques petites lumières sur la ville de Jérusalem.
Un ange lui a demandé ce qu’étaient ces lumières et il a répondu que c’était ses apôtres à qui il a envoyé l’Esprit pour embraser le monde.
L’ange lui a demandé ce qu’il ferait si son plan échouait. Après un temps de silence, Jésus a répondu : Je n’ai pas de plan B.
[1] Jn 17.3.
[2] Jn 1.10.
[3] Jn 7.7.
[4] Rm 5.8.
La première épître à Timothée du dimanche 14 septembre (1 Timothée 1.13-17)
Paul témoigne de la compassion de Dieu à son égard
Le contexte – La première épître à Timothée
Il est régulièrement admis que les épîtres pastorales ne sont pas de la main de Paul, mais de l’un de ses disciples. La raison de cette hypothèse est que le vocabulaire, le style et les thèmes abordés ne correspondent pas à ceux des grandes épîtres pauliniennes. Les arguments sont incontestables, mais on ne peut exclure un Paul qui aurait évolué dans son style et son ecclésiologie. D’autant que le passage de cette semaine insiste sur la biographie de Paul.
Les épîtres pastorales portent la marque d’une Église installée et s’adressent aux dirigeants de l’Église. Elles insistent moins sur l’émerveillement de la foi que sur la fidélité et la résistance à l’usure du temps.
Le livre des Actes nous apprend que Timothée était un proche compagnon de l’apôtre et qu’il était à cheval sur deux cultures puisque son père était grec (Ac 16.1) et que sa mère juive l’avait instruit dans les Écrits sacrés (2 Tm 3.15). En outre il n’était pas circoncis puisque Paul l’a fait pour éviter les problèmes avec les Juifs (Ac 16.3).
Que dit le texte ? – Le cœur de la foi
Paul rappelle le cœur de la foi chrétienne : C’est une parole certaine et digne d’être pleinement accueillie : Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs ; je suis, moi, le premier d’entre eux. Cette confession rappelle la parole de Jésus qui dit : Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.
Jésus ne nous a pas rejoints parce que nous étions justes, mais parce que nous étions pécheurs. Paul est bien placé pour déployer cet argument car il rappelle que lui-même était le premier des pécheurs en ce qu’il était persécuteur de l’Église. Si nous voulons entendre toute la force de cet argument, nous devons considérer l’épître comme écrite par Paul.
Si Paul, qui était auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un insolent, a trouvé grâce aux yeux de Dieu, nous pouvons avoir confiance dans l’efficacité de l’Évangile et de sa miséricorde pour tous.
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – Les paraboles de la brebis perdue et de la drachme perdue
La parabole de la brebis perdue parle d’un berger qui abandonne tout un troupeau pour aller chercher une seule brebis. Chaque croyant doit se considérer comme une brebis qui a elle seule est plus importante que l’ensemble des autres réunis.
Dieu ne cesse de nous chercher même quand nous sommes blasphémateurs, persécuteurs, et insolents : il nous appartient de nous laisser trouver.
Le livre de l’Exode du dimanche 14 septembre (Exode 32.7-14)
Moïse sauve les Hébreux de la destruction
Le contexte – Le livre de l’Exode
Au lieu de disserter sur la façon dont Dieu est libérateur, le livre de l’Exode raconte la façon dont les Hébreux ont été libérés de l’esclavage sous la conduite de Moïse. Cette libération est devenue emblématique de toutes les libérations de l’histoire. Ce récit fonde l’identité du judaïsme si bien qu’un philosophe contemporain à qui on demandait ce que cela signifiait pour lui d’être juif a répondu : « J’ai été libéré de l’Égypte. »
Pour évoquer la libération, le livre raconte la vie de Moïse qui est l’homme de la Bible dont la vie est la mieux connue. Il a été le libérateur qui a conduit les Hébreux sur les chemins de la liberté, le prophète qui a reçu la Torah et qui l’a transmise, le chef qui a organisé le peuple en le dotant d’institutions avec l’établissement de juges et de prêtres, mais aussi, dans le texte proposé à notre méditation, l’intercesseur qui a défendu les Israélites devant Dieu.
Que dit le texte ? – La prière de Moïse
Le 27 juillet dernier, le lectionnaire avait proposé le récit de l’intercession d’Abraham en faveur de Sodome, et dans le commentaire j’avais insisté sur l’audace d’Abraham qui a osé opposer la justice de Dieu à Dieu lui-même.
Nous trouvons la même audace chez Moïse. Il avait lui-même de bonnes raisons de se plaindre des Hébreux qui n’ont cessé de maugréer depuis la sortie d’Égypte, mais quand le Seigneur a décidé que l’idolâtrie du veau d’or était le signe que les Hébreux ne pouvaient pas être le peuple de la liberté, il s’est heurté à l’intercession de son serviteur.
Moïse prend la défense des Hébreux en leur trouvant des excuses. Il avance deux arguments pour soutenir son plaidoyer. Le premier est assez humoristique : « Tu ne peux exterminer ton peuple, car les Égyptiens se moqueraient de toi et te prendraient pour une girouette, ou un Dieu pervers. » Dieu aussi aurait une réputation à tenir ! Ensuite, Moïse fait appel à la mémoire de Dieu et à la promesse faite à Abraham, Isaac et Israël de leur donner une terre. De même qu’Abraham avait opposé la justice de Dieu à Dieu lui-même, Moïse oppose la promesse de Dieu à Dieu-même.
La réponse de Dieu claque comme un coup de tonnerre dans le champ du religieux : « Alors le Seigneur renonça au mal qu’il avait parlé de faire à son peuple. » Qui est ce Dieu qui change d’avis suite à l’intercession de son serviteur ?
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – Les paraboles de la brebis perdue et de la drachme perdue
La parabole de la brebis perdue se termine par le verset qui dit : De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change radicalement que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin d’un changement radical. La joie de Dieu, c’est de retrouver la relation avec ses serviteurs, la joie de Dieu, c’est de pardonner.
Appliqué au récit de l’Exode on peut imaginer que Dieu n’attendait qu’une chose, c’est de pouvoir pardonner à son peuple, mais il a voulu dépendre de l’intercession de Moïse pour cela.
Production : Fondation Bersier – Regards protestants
Intervenants : Antoine Nouis, Florence Taubmann