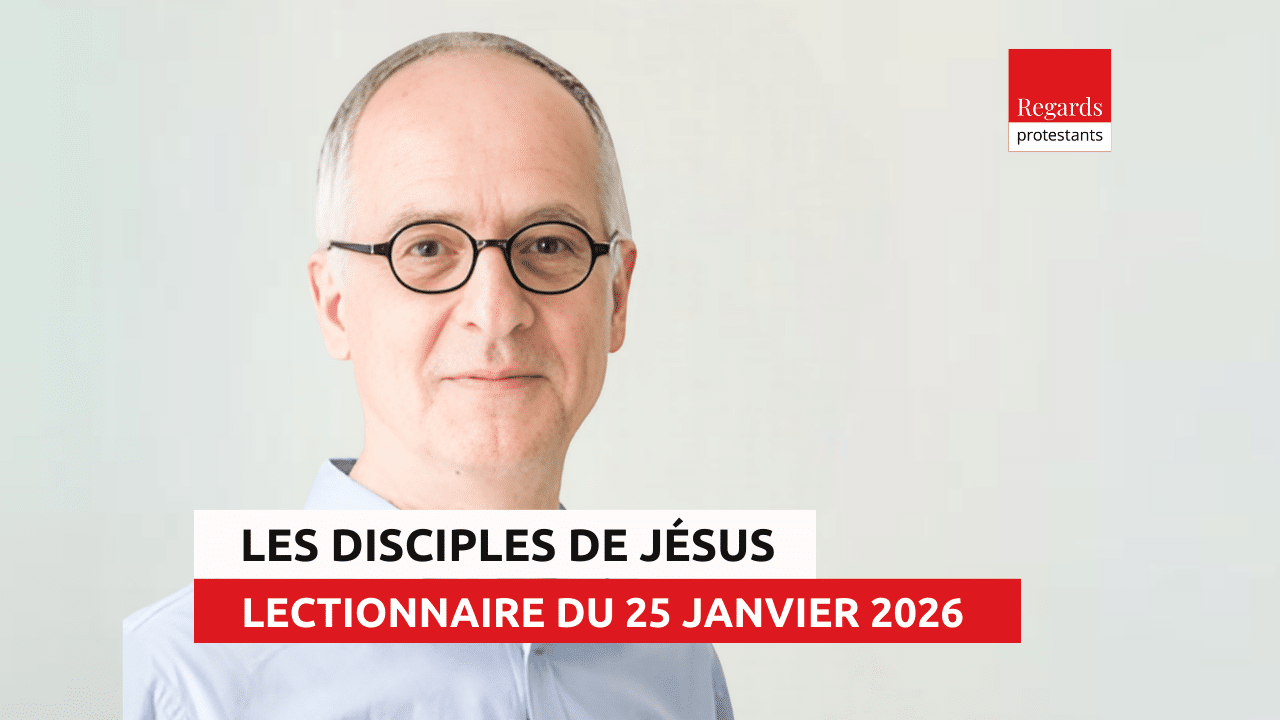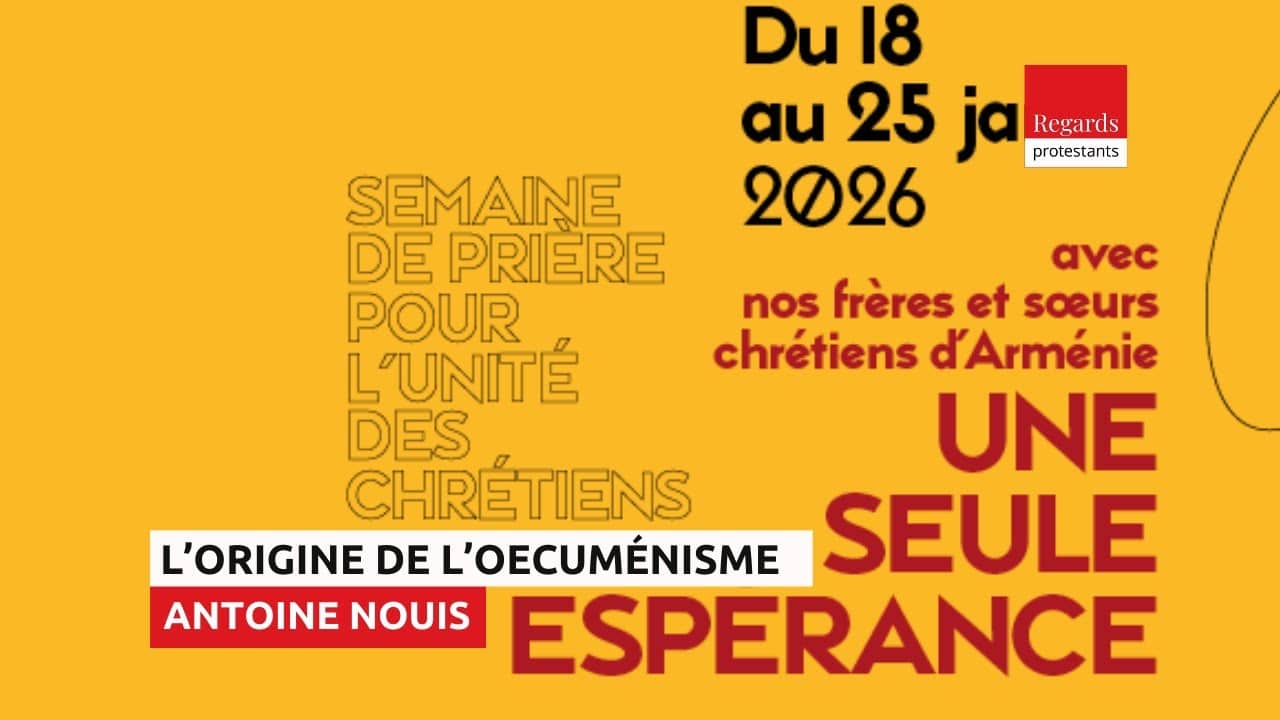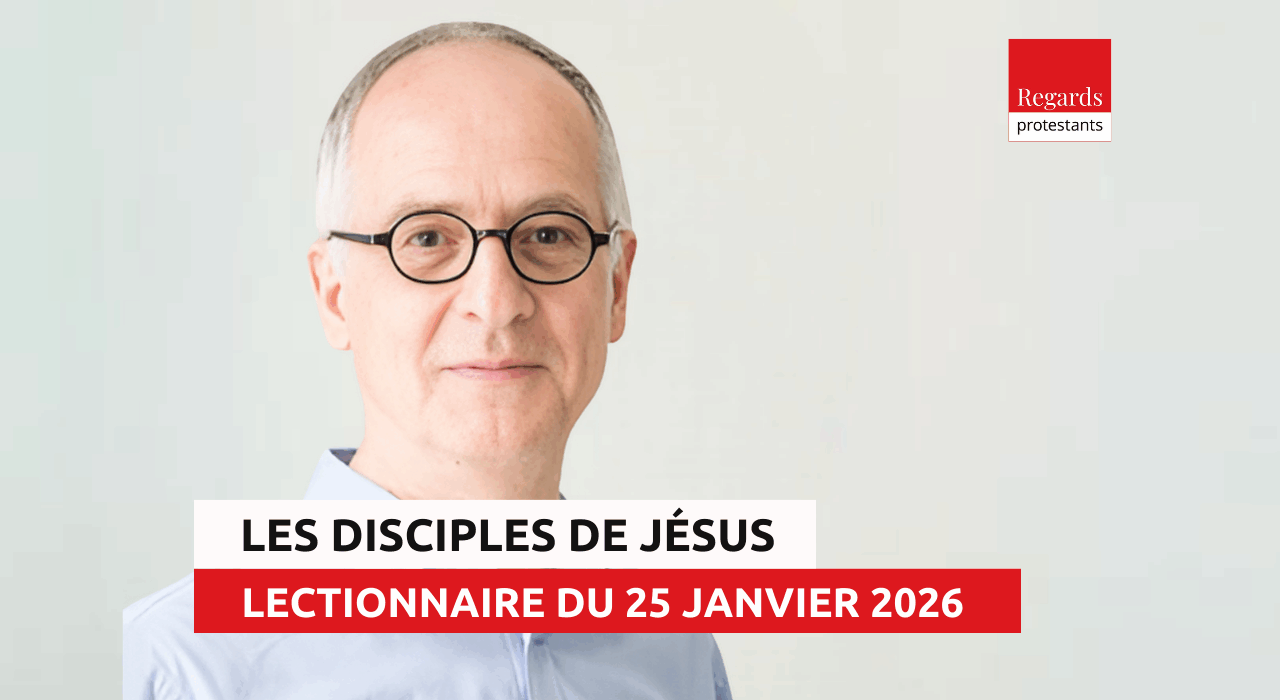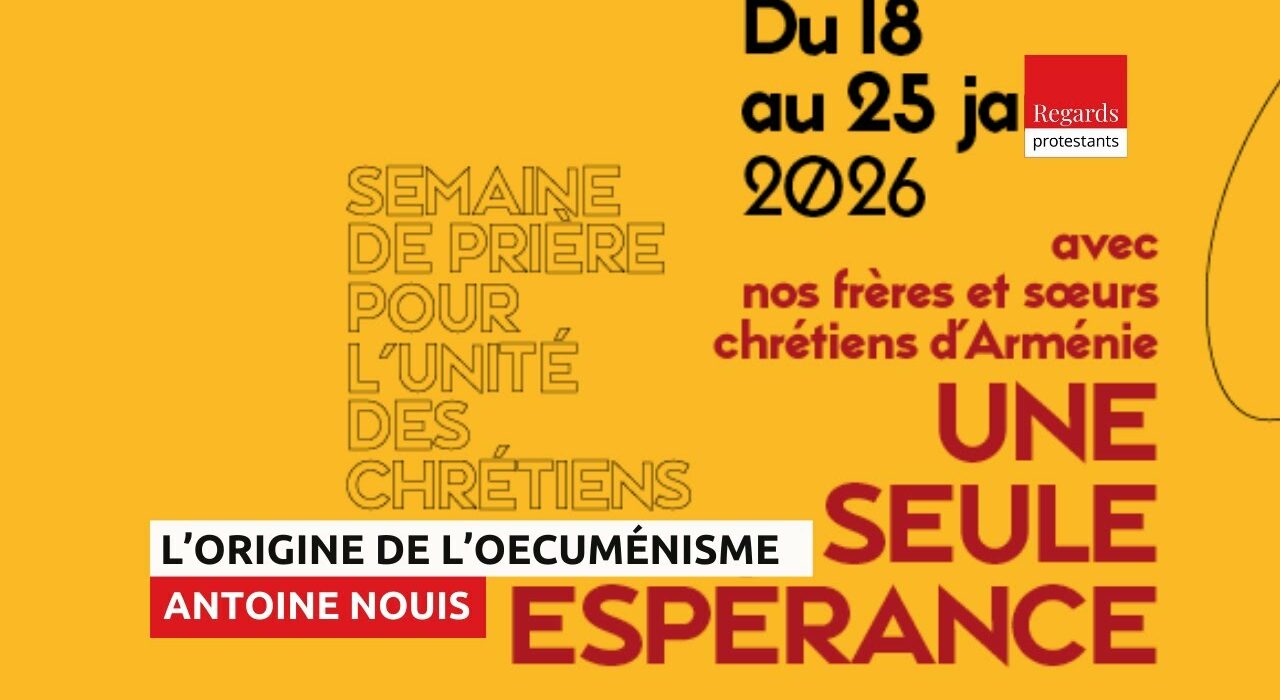L’évangile du dimanche du 2 novembre (Luc 19.1-10)
Quand la grâce fait scandale
Introduction
Dans l’épisode précédent, Jésus a guéri un aveugle qui se trouvait sur la route de Jéricho. Cette guérison a eu comme effet que tout le peuple se mit à louer Dieu. Tout le monde à Jéricho a été informé de la guérison, c’est pourquoi une foule l’attend. Comme c’est le soir, tout le monde espère que Jésus s’arrêtera chez lui.
Points d’exégèse
Attention sur deux points.
Zachée appelé par son nom
Zachée cumule les défauts, il est riche, c’est un collaborateur des Romains et il est petit. Quand il veut voir Jésus, la foule n’est pas prête à lui laisser une place. Derrière son bureau de collecteur des taxes, il suscite la crainte, mais quand il se mélange à la foule, il est méprisé, c’est pourquoi il s’isole en montant sur un arbre.
Lorsque Jésus s’arrête devant lui, il l’appelle par son nom : Zachée, descends vite ; il faut que je demeure aujourd’hui chez toi. Pour Jésus, il n’est pas un collecteur des taxes, c’est Zachée. Je t’ai appelé par ton nom, dit le Seigneur par la bouche de son prophète (Es 43.1).
Il faut que je demeure chez -toi
Il faut que je demeure chez toi. L’expression il faut évoque l’urgence du salut. Dans l’évangile de Luc, il faut que Jésus annonce le règne de Dieu, il faut qu’il monte à Jérusalem, il faut qu’il souffre beaucoup (Lc4.43, 13.33, 17.25). Il faut maintenant qu’il réside chez Zachée, comme si c’était une question de vie et de mort.
Zachée était méprisé par la foule, il est honoré par Jésus, et c’est cela qui va tout changer. Ce n’est pas la parole d’accusation, mais la parole de reconnaissance qui l’a conduit au changement de comportement.
Pistes d’actualisation
1er thème : Qui voit quoi
Zachée veut voir Jésus, c’est pourquoi il monte sur un arbre. Quand Jésus arrive à sa hauteur, il lève les yeux et le voit, et en voyant cela, la foule maugrée. Nous trouvons dans ce passage le regard de curiosité de Zachée, le regard de foi de Jésus et le regard de suspicion de la foule.
La foi est une question de confiance, mais aussi de regard, poser un regard positif sur un prochain et le voir comme Dieu le voit. La foi est une conversion de la pensée, mais aussi une conversion du regard.
2e thème : La justice et la générosité
Jésus a demandé à Jésus de demeurer chez lui. Le verbe demeurer évoque la foi, notamment dans le quatrième évangile. Jésus appelle ses disciples à demeurer en lui, comme lui demeure en eux.
Cette demeure n’est pas restée sans effet puisque Zachée change de comportement : il donne aux pauvres la moitié de ses biens et il rend au quadruple ce qu’il a usurpé. La première mesure relève de la générosité et la seconde de la justice. Zachée n’est pas que généreux, il est aussi juste ; il n’est pas que juste, il est aussi généreux.
3e thème : Fils de l’homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus
Au début du récit, Zachée cherchait Jésus, mais en fait c’est Jésus qui le cherchait comme le berger cherchait la brebis perdue, comme il ne cesse de chercher ceux qui ont besoin de changement.
Ce verset rejoint beaucoup d’autres que nous trouvons dans les évangiles, notamment celui de Luc. Jésus n’est pas venu pour les justes, car les justes n’ont besoin de personne, mais pour les perdus. L’Église n’est pas la réunion des justes, mais des éclopés qui se sentent rejetés, des mendiants qui ont été anoblis, des perdus qui ont été trouvés, et qui ont trouvé dans l’Évangile une parole d’accueil inconditionnel.
Une illustration : Le lieu de la miséricorde
Une sentence du Talmud déclare : « À l’endroit où les repentis se tiennent, les justes parfaits ne peuvent pas se tenir. » Celui qui a péché et qui a été pardonné et plus près de Dieu que celui qui n’a jamais fauté.
En commentaire de cette citation, nous pouvons raconter l’histoire soufie d’un maître particulièrement vénéré qui était sur son lit de mort. Ses disciples lui ont demandé où il désirait être enseveli. Ils pensaient qu’au regard de sa sainteté, il pourrait reposer dans la grande mosquée, là où sont enterrés les plus grands maîtres. « Non, répondit le sage, déposez-moi au cimetière en dehors de la ville, dans le quartier des femmes de mauvaise vie et des criminels, car c’est là que réside la miséricorde. »
La deuxième épître aux Thessaloniciens du dimanche 3 novembre (2 Thessaloniciens 1.11-2.1)
Rester ferme dans la fidélité
Le contexte – La deuxième épître aux Thessaloniciens
L’authenticité paulinienne de la deuxième épître aux Thessaloniciens est interrogée, mais ce qui est sûr c’est que nous devons la lire en lien avec la première épître à cette Église qui est considérée comme l’ouvrage chrétien parvenu jusqu’à nous le plus ancien.
Dans la première épître, Paul avait parlé de l’imminence de la venue du Seigneur, mais la réalité de l’Église est celle de l’épreuve et de la persécution. Dans le passage qui précède la lecture de cette semaine, l’auteur de l’épître encourage les Thessaloniciens dans leur fidélité en les assurant qu’ils seront récompensés pour leur persévérance et que leurs persécuteurs connaîtront un juste jugement.
Que dit le texte ? – La prière en faveur des Thessaloniciens
L’auteur de l’épître prie pour que les Thessaloniciens restent fermes et fidèles dans leur foi malgré les persécutions de sorte que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous.
Dans le langage du Nouveau Testament, la gloire est la révélation de la vérité d’une personne. Par leur fidélité, les Thessaloniciens sont les témoins de la fidélité de Dieu qui accompagne ses enfants jusque dans leurs épreuves. Jésus n’a jamais promis à ses disciples qu’ils auront une vie facile, il leur a promis d’être à leurs côtés tous les jours.
Ensuite, l’apôtre évoque une situation particulière. À Thessalonique circule une lettre venant prétendument de nous, comme quoi le jour du Seigneur serait déjà là. Il répond à cette fausse information en appelant ses interlocuteurs à la vigilance : Ne vous laissez pas trop vite ébranler dans votre bon sens ni alarmer par un message inspiré. La foi n’exclut pas la sagesse et la prudence. Dans la première épître, Paul avait écrit : Examinez tout, retenez ce qui est bien (1 Th 5.21), il leur demande maintenant de ne pas se laisser égarer par ce qu’on appelle de nos jours des infox.
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – La venue de Jésus chez Zachée
Le récit de la venue chez Zachée nous invite à toujours convertir nos pensées sur Dieu. De par notre nature, nous imaginons un dieu qui approuve les justes et qui rejette les pécheurs. Dans l’évangile de cette semaine, Jésus honore un péager en lui proposant d’habiter chez lui car pour lui la miséricorde est première.
Contre tous les discours sur un Dieu qui juge et qui rejette, nous devons toujours revenir au Dieu de l’Évangile qui ne cesse d’accueillir ceux qui sont loin et dont son amour dure à toujours.
Le livre d’Esaïe du dimanche 2 novembre (Esaïe 45.22-24)
L’appel aux enfants d’Israël
Le contexte – Le livre d’Ésaïe
La deuxième partie du livre d’Ésaïe évoque la fin de la période de l’exil, au moment où la Perse a remplacé Babylone comme empire dominant du Moyen-Orient. Cyrus ordonnera le retour des exilés dans leur pays d’origine et la reconstruction du temple.
Ésaïe interprète cet événement comme dirigé par le Seigneur qui appelle le roi perse, mon berger, et même l’homme qui a reçu l’onction, ce qui signifie le messie. Le Seigneur peut utiliser un roi étranger car il est le Seigneur du ciel et de la terre, c’est lui qui donne la victoire aux vainqueurs. Quand il apporte le salut à son peuple, toutes les nations peuvent le reconnaître.
Que dit le texte ? – Tournez-vous vers moi
Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, Dieu se prépare à libérer son peuple, mais ce dernier doit se préparer à vivre la libération. Cet appel ne s’adresse pas qu’à ceux qui sont à Babylone, mais aussi à ceux qui sont aux extrémités de la terre. Ce sont tous les enfants d’Israël, où qu’ils soient, qui doivent revenir.
Je suis Dieu et il n’y en a pas d’autres. La foi consiste à refuser de s’incliner devant n’importe quel autre dieu que le Seigneur de l’histoire, du ciel et de la terre. Comme le disait l’écrivain anglais G. K. Chesterton : « Lorsqu’on cesse de croire en Dieu, ce n’est pas que l’on ne croit plus en rien, mais que l’on croit en n’importe quoi. »
Je le jure par moi-même, de ma bouche sort ce qui est juste. La justice de Dieu, c’est qu’il se prépare à libérer son peuple, de même que dans le Nouveau Testament, la justice de Dieu, c’est que Dieu nous voit justes en Jésus-Christ. La justice de Dieu, c’est sa libération et son pardon.
Dans le Seigneur… résident la justice et la force. Les deux sont associées selon l’aphorisme de Pascal : « La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique… Il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et pour cela faire que ce qui est juste soit fort ou que ce qui est fort soit juste. »
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – La venue de Jésus chez Zachée
Un qui était loin et qui s’est tourné vers le Seigneur parce qu’il a entendu une parole de justice, c’est Zachée. C’était aussi un enfant d’Abraham. Il était loin, mais Jésus a déclaré qu’il était venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Parce qu’il a entendu la parole de justice d’un Dieu qui a compassion, il a répondu à cet appel en remboursant ce qu’il avait volé et en faisant preuve de générosité dans sa réparation.
Zachée est une belle réponse à l’appel qu’Ésaïe a adressé au nom de Dieu aux enfants d’Israël qui étaient en exil.
Production : Fondation Bersier – Regards protestants
Intervenants : Antoine Nouis, Christine Pedotti