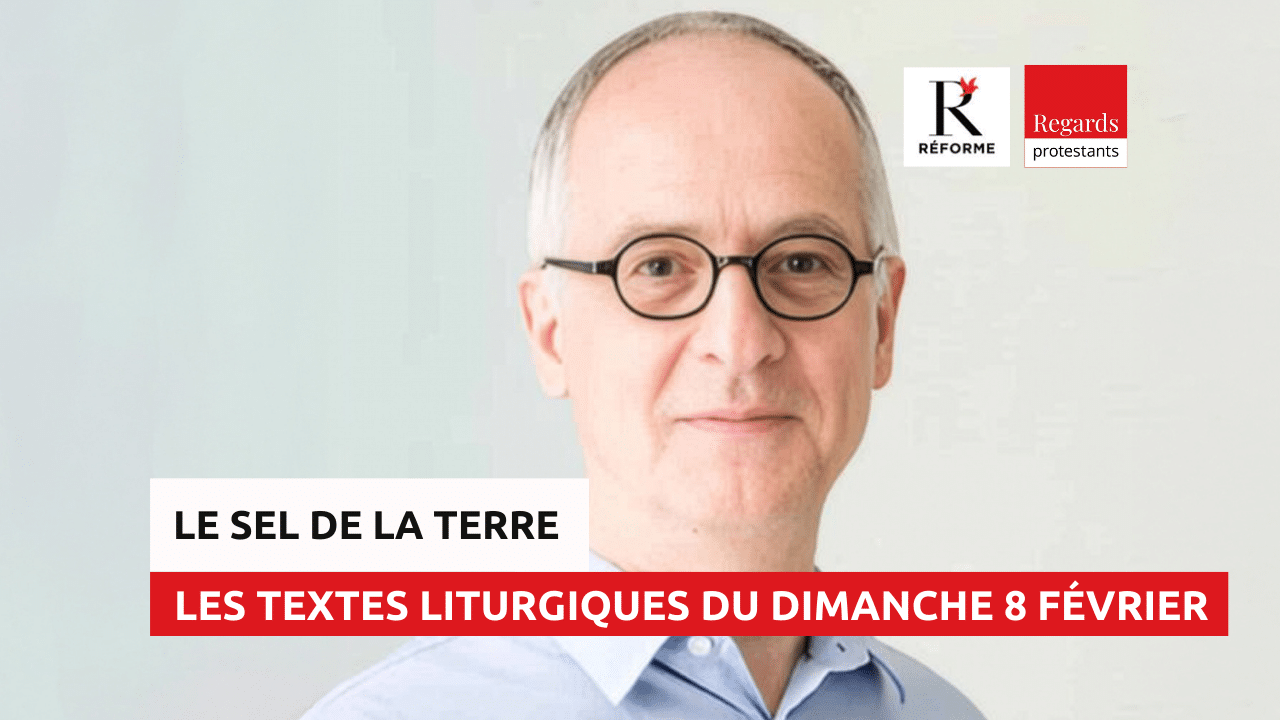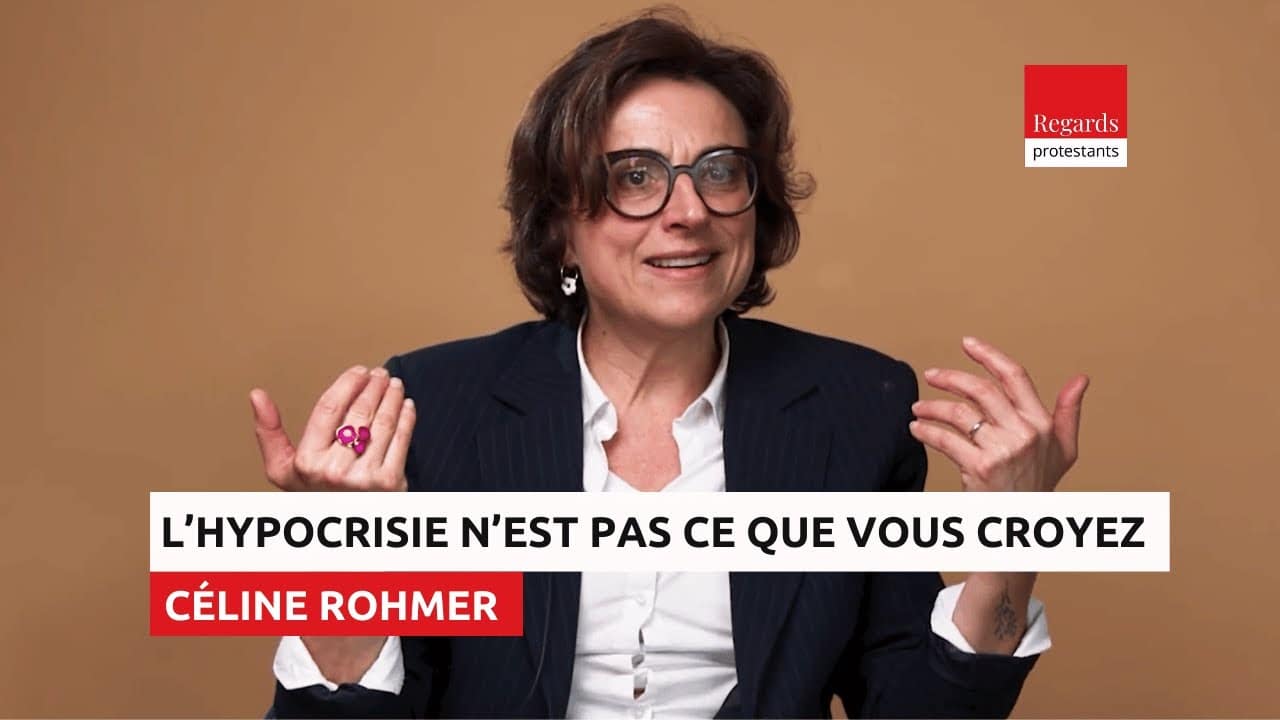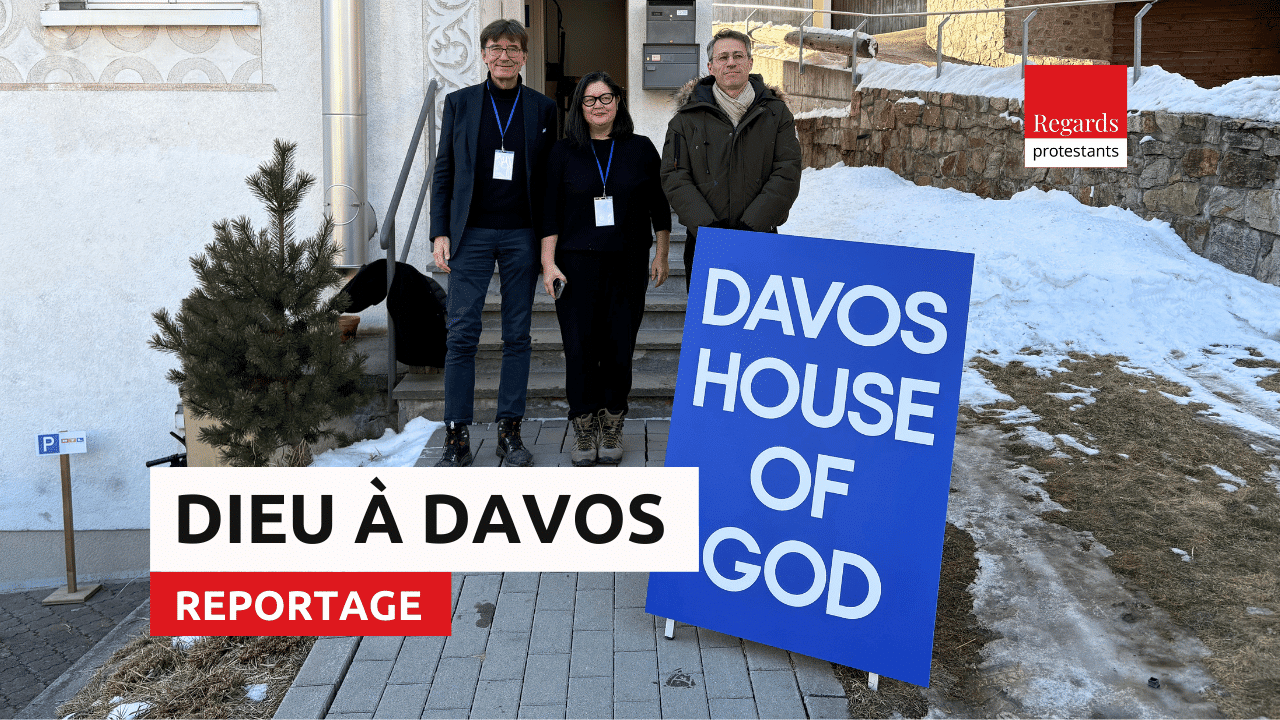L’évangile du dimanche du 21 septembre (Luc 16, 1-13)
La déconstruction de l’argent
Introduction
L’évangile de Luc est celui qui parle le plus d’argent. Habituellement les versets disent de ne pas s’attacher à nos possessions et à distribuer nos biens. Le passage d’aujourd’hui est surprenant et d’une tonalité totalement différente puisqu’il parle d’une pratique malhonnête qui est louée de la part de celui qui est floué. Le dernier verset qui rappelle qu’on ne peut servir Dieu et Mamon est une clef d’une parabole qui déconstruit notre relation à l’argent.
Points d’exégèse
Attention sur deux points.
À qui s’adresse la parabole ?
Le premier verset dit que Jésus parlait aux disciples, la parabole est une profanation de notre rapport à l’argent et le verset qui suit notre séquence dit que les pharisiens, qui aimaient l’argent, écoutaient tout cela et tournaient Jésus en dérision (16.14). Jésus parle à ses disciples, mais les pharisiens entendent son enseignement.
La différence entre les disciples et les pharisiens tient dans leur relation à l’argent. Dans quelle catégorie nous situons-nous ?
La théologie à coup de marteau
En racontant cette parabole, Jésus n’hésite pas à choquer ses interlocuteurs comme il l’a déjà fait en se permettant de remettre les péchés du paralysé (Lc 5.20), en faisant exprès de guérir des malades le jour du sabbat (Lc 6.2, 13.14) et en acceptant de se laisser essuyer les pieds par une femme pécheresse (Lc 7.38). Jésus veut provoquer chez ses interlocuteurs un choc pour ébranler leurs certitudes et souligner la nouveauté radicale de son Évangile.
Pistes d’actualisation
Comme toutes les paraboles, elles peuvent avoir plusieurs interprétations. Nous en proposerons trois qui peuvent être complémentaires.
1ère interprétation : Quelles sont nos dettes ?
L’intendant va trouver les débiteurs de son maître et leur demande combien il leur doit ? Le verbe utilisé (opheilô) a la même racine que la parole du Notre Père dans laquelle nous demandons à Dieu de remettre nos dettes (opheiléma) comme nous les remettons à nos débiteurs. Cette parole est habituellement priée en disant : Remets-nous nos offenses. Les dettes seraient des offenses.
Ce rapprochement est une des clefs d’interprétation de la parabole dans une lecture allégorique. Si le propriétaire est Dieu, les dettes représentent ce qui nous sépare de lui, en théologie cela s’appelle le péché. Si le propriétaire est Dieu, l’intendant représente l’Église des disciples, dont la mission première est de remettre les péchés des débiteurs.
Cette lecture nous rappelle que le règne de Dieu ne se gère pas comme une entreprise, c’est le règne et de la grâce et de la générosité, du pardon et de la remise des dettes.
2ème interprétation : La profanation de l’argent
Jésus appelle l’argent le Mamon de l’injustice. Le nom Mamon évoque la dimension diabolique de l’argent. L’argent a un pouvoir de fascination qui a tendance à enfermer les humains dans les filets de sa logique. Pour l’amour de l’argent, nous avons vu des humains transgresser les valeurs qui leur étaient les plus précieuses.
Cette parole démolit la fascination de l’argent en le profanant en parlant d’une utilisation contre-productive. À l’inverse de la lecture allégorique, une parabole peut s’interpréter à partir des points de rupture du récit. Ici dans l’annonce que l’argent doit être utilisé non pour le commerce, mais pour se faire des amis.
3ème interprétation : Les gens de ce monde et les fils de la lumière
La conclusion de la parabole dit que les gens de ce monde sont plus avisés dans leurs rapports à leurs semblables aux fils de la lumière. L’expression fils de la lumière fait penser aux Esséniens qui étaient une secte de purs qui se donnaient ce titre à eux-mêmes. Cette parabole se rapproche de celle du pharisien et du collecteur de taxes (Lc 18.9-14) pour nous rappeler que les pêcheurs sont parfois plus proches de Dieu que les religieux les plus scrupuleux.
La conclusion enfonce le clou en disant que ce sont ceux qui ont été au bénéfice du Mamon de l’injustice qui accueilleront les religieux dans les demeures éternelles.
Une illustration : Saint Pierre et le Monopoly
Sur la profanation de l’argent, une parabole raconte l’histoire d’un homme qui a beaucoup économisé au point de devenir riche. Quand il meurt, il demande le privilège d’emporter un peu de son argent au ciel. À force d’insister, il finit par obtenir satisfaction. Quand il arrive devant St Pierre, ce dernier regarde ce qu’il y a dans la valise de l’homme. Quand il voit tous les billets de banque, il s’écrie : « Chouette, j’ai toujours eu envie de jouer au Monopoly. »
La première épître à Timothée du dimanche 21 septembre (1 Timothée 2.1-8)
La prière pour les autorités
Le contexte – La première épître à Timothée
La première épître à Timothée est une épître tardive, ce qui signifie qu’elle a été rédigée à une époque où l’Église est installée et où son défi est celui de l’inscription dans le temps et de la fidélité. Elle est adressée à Timothée qui dans le livre des Actes est présenté comme un jeune compagnon de Paul qu’il appelle dans le premier verset mon enfant véritable dans la foi.
Que dit le texte ? – la prière pour ceux qui exercent une position d’autorité
Sur la relation avec les autorités le Nouveau Testament s’inscrit dans la tension entre l’épître aux Romains qui appelle à être soumis aux autorités car elles sont au service de Dieu, et le livre de l’Apocalypse qui présente les autorités dans le registre diabolique dans son opposition à Dieu et à son Église.
La clef se trouve dans l’épître aux Romains qui définit le rôle de l’autorité comme devant favoriser le bien et arrêter le mal. Quand elle assume cette fonction, elle est au service de Dieu ; en revanche quand elle se divinise et qu’elle veut prendre la place de Dieu, elle entre dans le registre diabolique.
Lorsque Paul demande à Timothée de prier pour les autorités, il s’inscrit dans le premier registre. Il précise la raison de cette prière : afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et en toute dignité. En arrêtant le mal, l’autorité permet aux humains de mener une vie paisible.
La prière pour les autorités appartient à la tradition liturgique des Églises, même si elle se fait plus rare de nos jours. On a tort de ne pas prier pour les autorités car nos responsables ont des décisions extrêmement difficiles à prendre alors que l’enjeu est la vie commune. Plus que d’autres, ils ont besoin d’inspiration dans leur mission.
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – L’intendant habile
L’évangile de ce dimanche est la parabole de l’intendant habile qui le jour où il apprend qu’il va être licencié remet la dette des débiteurs de son maître pour se faire des amis quand il sera dans le besoin. La parabole se termine par le verset qui dit : les gens de ce monde sont plus avisés dans leurs rapports à leurs semblables que les fils de la lumière.
Dans ce registre on peut considérer les autorités comme des gens de ce monde. On leur demande d’être avisés dans leur responsabilité de nous permettre de vivre une vie paisible.
La Bible ne se prononce pas sur le type de régime politique souhaitable, elle rappelle à l’autorité que sa responsabilité première est d’œuvrer pour le bien de ceux qui sont sous autorité.
Le livre d’Amos du dimanche 21 septembre (Amos 8.4-7)
Crier contre les injustices
Le contexte – Le livre d’Amos
Le prophète Amos se présente comme un éleveur de bovins et un cultivateur de sycomores dans la région de Teqoa, dans le territoire de Juda. Il n’est ni prêtre ni un prophète officiel, et pourtant il a été appelé par Dieu pour aller en Israël – une terre étrangère pour lui – afin d’adresser un message aux hommes de ce pays.
Son activité s’est déroulée au milieu du VIIIe siècle sous le règne du roi Jéroboam II qui a été une période de prospérité économique dans le royaume d’Israël. Le problème est que cette période d’expansion s’est accompagnée d’un accroissement des injustices. Le prophète a dénoncé l’avidité des riches qui oppriment les pauvres, des dames de Samarie vivent dans l’opulence et des marchands qui faussent leurs balances. Face à cette situation d’injustice, il a annoncé le jugement de Dieu qui prend deux formes. L’imminence d’un tremblement de terre et menace assyrienne : un pays qui connaît trop d’injustices est un pays qui se fragilise.
Amos est un personnage attachant, car on sent qu’il est aux prises avec une parole trop grande pour sa petite personne, mais c’est un vrai prophète, car il n’a pas transigé avec la vérité, cela a entraîné son expulsion du territoire d’Israël.
Que dit le texte ? – Contre l’avidité des marchands
Le message du prophète s’adresse principalement à ceux qui ne cherchent qu’à faire du commerce pour s’enrichir. Cela les conduit à regretter les jours chômés au cours desquels on n’a pas le droit de vendre ni d’acheter.
Pour accroître leurs profits, les marchands diminuent les mesures, augmentent le prix, faussent les balances… toutes les pratiques sont bonnes pour s’enrichir. Le commerce n’est plus un échange équitable, mais une guerre dans laquelle tous les moyens sont permis.
L’avidité des commerçants conduit au harcèlement des pauvres qui deviennent une marchandise et à l’élimination des déshérités. Un pays dans lequel il n’y a plus de solidarité est fragilisé, car personne n’est prêt à se battre pour le défendre.
Le passage se termine par la parole de Dieu qui dit : Je n’oublierai jamais aucune de leurs œuvres. L’espérance des opprimés est que Dieu sait et qu’un jour les mauvaises actions de leurs oppresseurs seront dévoilées.
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – L’intendant habile
Dans le passage de l’évangile de ce dimanche, l’intendant détourne l’argent de sa fonction en remettant la dette des débiteurs pour préserver son avenir.
Le but de l’argent n’est pas de faire plus d’argent, mais de se faire des amis. La parabole se termine par le proverbe qui dit qu’on ne peut servir Dieu et Mamon qui est une personnification de l’argent. Pour les marchands au temps d’Amos, l’argent n’est pas un serviteur, il est devenu un maître qui passe avant toute chose, ce qui les conduit à persécuter les petits.
Production : Fondation Bersier – Regards protestants
Intervenants : Antoine Nouis, Christine Pedotti