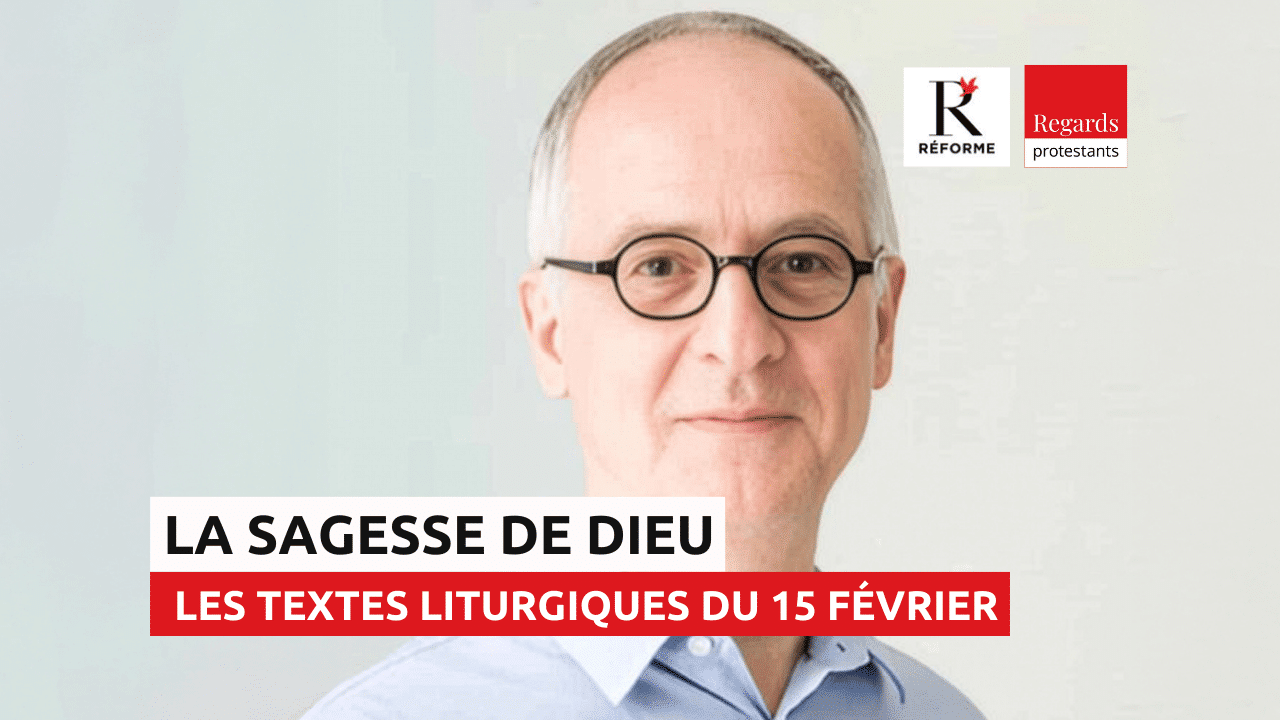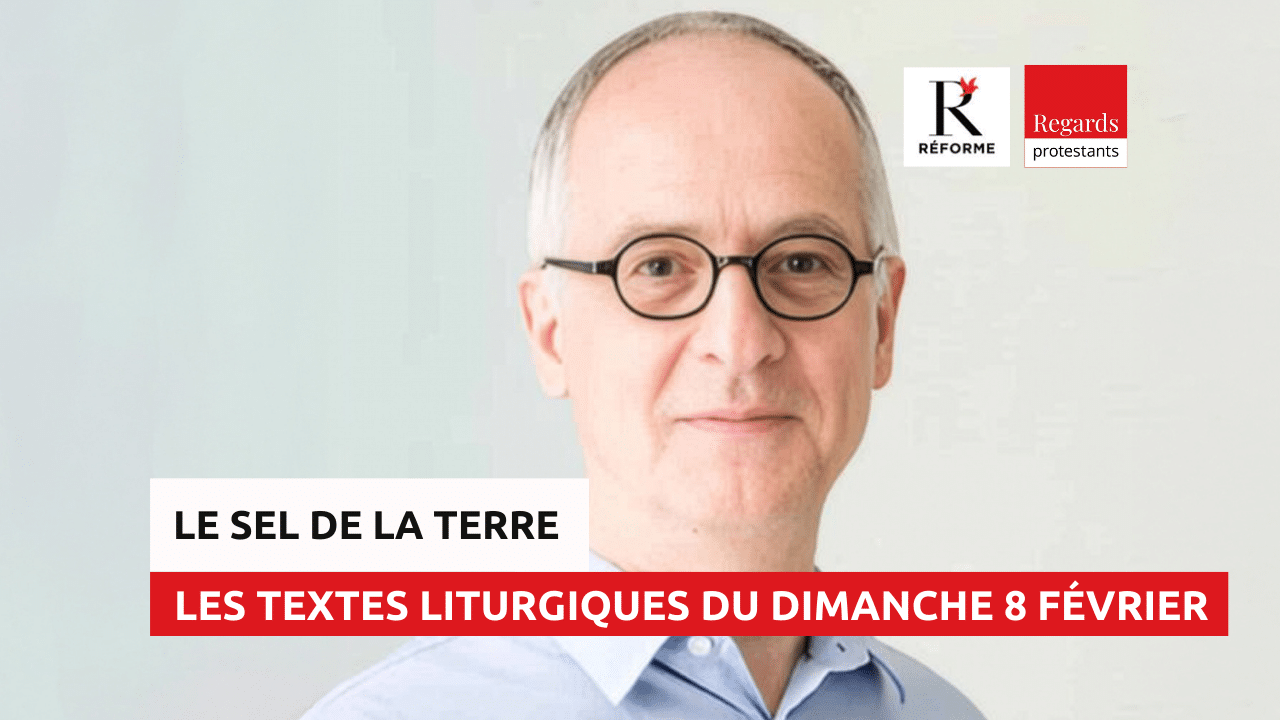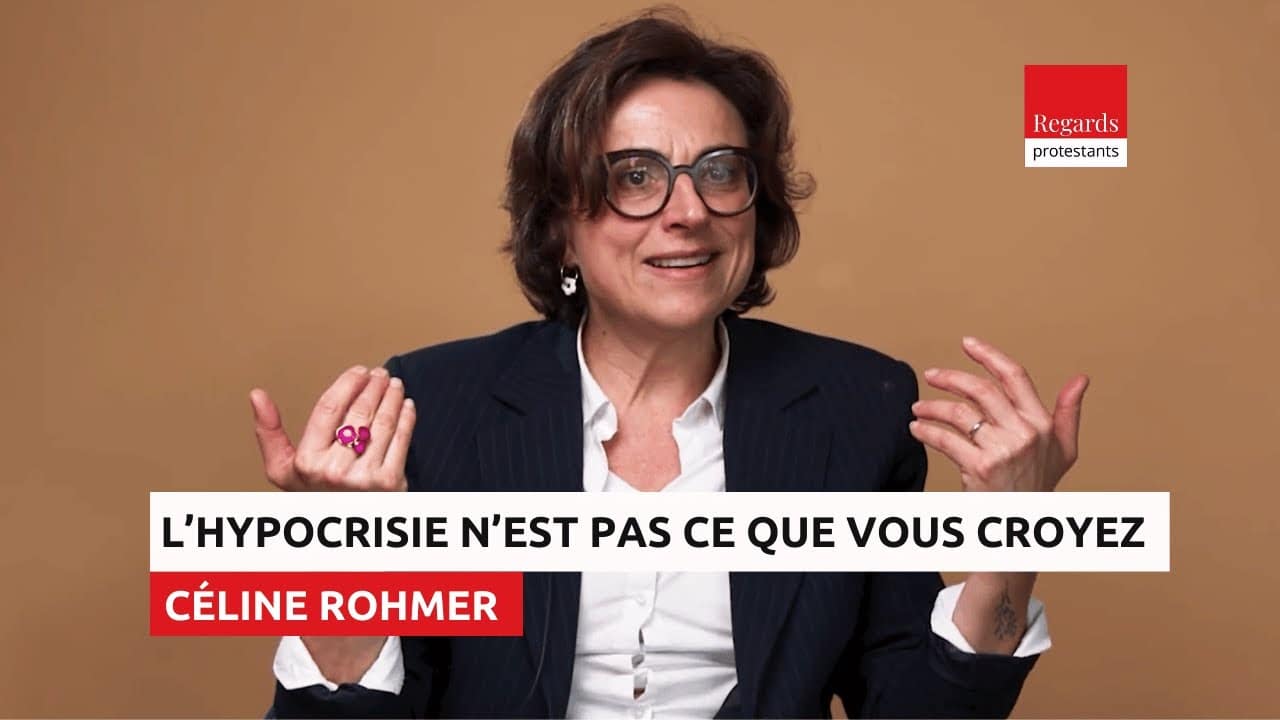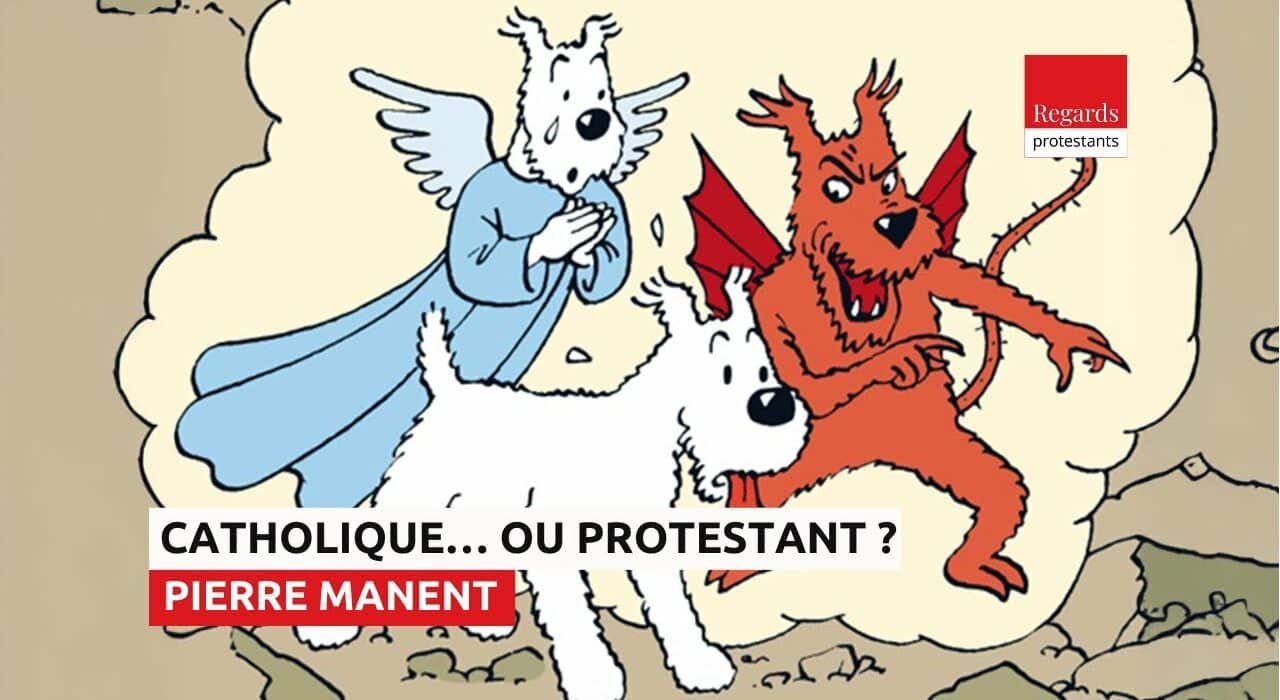L’évangile du dimanche du 28 septembre (Luc 16, 19-31)
Introduction
La semaine dernière, la parabole de l’intendant habile nous invitait à nous faire des amis avec l’argent injuste. Le texte de ce dimanche poursuit sur le même thème en soulignant combien l’argent peut nous rendre aveugles et sourds à la situation de ceux qui sont à notre porte.
Elle parle du ciel pour nous parler d’ici-bas en nous rappelant que nous n’avons qu’une seule vie : c’est aujourd’hui, maintenant que nous devons ouvrir les yeux sur ceux qui ont besoin de nous : l’urgence de la solidarité.
Points d’exégèse
Attention sur deux points.
Un riche et Lazare
Le riche est anonyme, on ne sait rien de lui sinon qu’il passe sa vie à faire la fête. Le pauvre, lui, a un nom, Lazare, qui signifie en hébreu Dieu vient en aide.
Lazare et pauvre et Lazare est malade si bien qu’on se demande si Dieu n’aurait pas oublié de lui venir en aide. Non, il a posé un riche sur son chemin. Si Lazare est pauvre, ce n’est pas la faute de Dieu, mais du riche.
Habituellement on connaît le nom des riches et ce sont les pauvres qui sont anonymes. La parabole inverse les habitudes pour nous dire que le pauvre est plus important que le riche.
Faire la fête
Le riche est décrit par des beaux vêtements et une vie oisive : chaque jour il faisait la fête et menait brillante vie. Faire la fête n’est pas répréhensible en soi : le père de la parabole du fils perdu et retrouvé a fait la fête pour célébrer le retour à la vie de son fils, de même qu’il l’a revêtu de sa plus belle robe (Lc 15.22-24). L’élément critiquable ici est le chaque jour. Comme si le seul but de la vie du riche était de faire la fête. Dans sa vie, la fête n’est plus une célébration, mais une soumission aux plaisirs et à la débauche.
Pistes d’actualisation
1er thème : Les deux riches de la parabole
Une première lecture nous laisserait penser qu’il est mal en soi d’être riche. Pourtant Lazare se trouve sur le sein d’Abraham qui, selon la Genèse, était très riche en troupeaux, en argent et en or (Gn 13.2).
Le mal, ce n’est pas d’être riche, c’est d’être enfermé dans sa richesse au point de ne plus voir ceux qui sont à sa porte. C’est ce qu’a affirmé l’apôtre Paul lorsqu’il a écrit à son disciple Timothée : Enjoins à ceux qui sont riches dans le monde présent de ne pas être orgueilleux (1 Tm 6.17).
2e thème : Un grand gouffre a été mis entre nous
Lorsque dans le séjour des morts, le riche interpelle Abraham, ce dernier répond qu’un gouffre a été mis entre eux. Le gouffre entre le riche et Lazare a été creusé de leur vivant. Ce n’est pas dans la mort qu’ils vont établir ce qu’ils n’ont pu faire de leur vivant.
La parabole nous rappelle qu’il y a parfois des injustices, des ruptures, des humiliations sur lesquelles on ne peut revenir. Elle nous alerte sur l’urgence de la justice, l’urgence de la compassion… avant que le gouffre ne devienne infranchissable.
3e thème : Moïse et la résurrection
Abraham répond en faisant appel à Moïse et aux prophètes. Tout ce que les frères du riche ont besoin de savoir pour mener une vie juste se trouve dans les Écritures. Parfois nous cherchons des révélations extraordinaires pour savoir comment nous comporter alors que tout est dans les Écritures. La foi est une question d’obéissance, pas de révélation surnaturelle.
Lorsqu’Abraham déclare : S’ils n’écoutent pas Moïse et les Prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu’un se relevait d’entre les morts, il répond à une question que se posait la première Église. La résurrection du Christ ne nous épargne ni l’écoute des Écritures, ni la foi, ni l’obéissance.
Une illustration : La fenêtre et le miroir
À propos des richesses du riche qui l’empêche de voir le pauvre couvert d’ulcères qui est couché à sa porte, une histoire raconte qu’un riche est allé voir un sage pour le questionner sur ses richesses.
Le sage lui a demandé de regarder par la fenêtre et de lui dire ce qu’il voit. « Je vois une rue avec des hommes, des femmes et des enfants. » Ensuite le sage a recouvert la fenêtre avec une feuille d’argent, puis il a demandé au riche de regarder. L’argent a fait miroir et il ne se voyait plus que lui-même.
La première épître à Timothée du dimanche 28 septembre (1 Timothée 6.11-16)
Le combat de la fidélité
Le contexte – La première épître à Timothée
À la différence des premières épîtres de Paul qui insistait sur l’urgence de la foi parce que la venue du Christ était imminente, les épîtres pastorales s’adressent à une Église installée en insistant moins sur l’émerveillement de la foi que sur la fidélité et la résistance à l’usure du temps. Elles témoignent d’une Église qui se dote de structures, on pourrait presque parler d’institutionnalisation, pour s’inscrire dans la durée.
Dans le récit qui précède le texte de ce dimanche, l’auteur de l’épître alerte Timothée sur le risque de l’amour de l’argent qui est la racine de tous les maux. Il risque d’éloigner les riches de l’Évangile : Quelques-uns, pour s’y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligé à eux-mêmes bien des tourments.
Parmi les risques de l’installation dans le temps se trouve celui de rechercher les biens matériels au détriment de ce qui fonde la foi et l’Évangile. Dans son histoire, l’Église a succombé trop souvent à l’amour de l’argent au détriment de la foi.
Que dit le texte ? – Le beau combat de la foi
Contre la tentation de l’argent, Timothée est invité à cultiver la justice, la piété, la foi, l’amour, la persévérance, la douceur.
Théologiquement, la justice est le regard de bienveillance que Dieu porte sur sa vie ; la piété est l’enracinement dans les paroles de l’évangile ; la foi est la vie de l’Évangile ; l’amour est le travail pour faire grandir son prochain ; la persévérance est la résistance à l’usure du temps ; et la douceur est la bienveillance à l’égard du prochain. Si on se concentre sur ces attitudes, on n’a plus le temps pour chercher à s’enrichir ou à dépenser son argent de manière ostentatoire.
L’auteur de l’épître appelle cette attitude le combat de la foi. Une façon de nous rappeler que ce n’est pas naturel. L’enjeu de la spiritualité est de s’enraciner dans la vie de foi pour orienter ses paroles, ses pensées et ses actions selon la perspective de l’Évangile.
Cette exhortation à Timothée qui est un responsable de la première Église est une parole adressée à toutes les Églises de tous les pays et de tous les temps.
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – Le riche et Lazare
La tentation qui menace Timothée comme tous les croyants est celle de l’habitude, de l’embourgeoisement, de réduire l’Évangile à un vernis de spiritualité. On se dit chrétien et on en vient à ne plus voir le pauvre couvert d’ulcères qui se tient à la porte de sa maison.
La parabole nous rappelle que l’adresse à Timothée n’est pas une question secondaire, elle concerne notre foi et notre salut. La parabole utilise l’image de l’éternité (une vie de tourment ou une vie dans le sein d’Abraham) pour nous parler de ce monde-ci. Ne plus voir le pauvre creuse un fossé qui nous éloigne de l’Évangile de Jésus-Christ.
Le décalage auquel nous appelle la parabole est l’impératif éthique qui nous invite à replacer notre comportement au regard de l’éternité. Au regard de l’essentiel qu’est-ce qui est le plus important : faire la fête tous les jours ou prendre soin des pauvres ?
Le livre d’Amos du dimanche 28 septembre (Amos 6.1-7)
Les richesses qui enferment
Le contexte – Le livre d’Amos
Le livre d’Amos le présente comme un éleveur de bovins et un cultivateur de sycomores (7.14) dans le territoire de Juda (1.1). Il n’a pas de fonction religieuse, il a pourtant été appelé par Dieu pour aller dénoncer les injustices sociales qui se développent en Israël, une terre étrangère pour lui.
Il s’en prend en particulier aux riches et aux puissants en imputant à leur avidité des malheurs qui vont tomber sur le pays : il parle d’un tremblement de terre et de la menace assyrienne qui assouvira la Samarie quelques décennies plus tard. Un pays où règne l’injustice est un pays fragile, peu apte à se défendre face aux menaces climatiques et politiques.
Comme sa parole dérange les puissants, ces derniers vont se débrouiller pour qu’il soit expulsé du pays. Au lieu d’écouter la parole de Dieu, ils préfèrent la verrouiller.
Que dit le texte ? – L’insouciance des riches
Amos commence son discours sur les riches par l’expression : Quel malheur pour ceux qui sont satisfaits. Le prophète s’en prend aux riches qui vivent dans le luxe et multiplient les festins. Ils pensent que leur argent les protégera au jour de l’épreuve alors que par leur attitude ils accélèrent la venue du jugement. Ils seront les premiers exilés, et ce jour-là, leurs banquets ne seront plus que des souvenirs.
Ce passage est illustration de la parole de Jésus qui dit qu’il est difficile à un riche d’entrer dans le royaume des cieux… il est plus facile à un chameau de passer par un trou d’aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu (Mt 10.24-25). Pourquoi est-ce difficile à un riche ? Parce que ses richesses hurlent à ses oreilles : Confie-toi en nous ? Il est très difficile d’être riche et de rester humble. Comme le disait Péguy : « À moins d’avoir du génie, un homme riche ne peut pas imaginer ce qu’est la pauvreté. »
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – Le riche et Lazare
Un exemple du nanti qui vit dans l’opulence et qui est incapable de voir le pauvre qui est à la porte de sa maison est le riche de la parabole qui ignore le pauvre Lazare couvert d’ulcères qui était couché à son porche. La loi et les prophètes lui rappellent qu’il ne peut ignorer ce qui est devant ses yeux, mais le riche est trop préoccupé par faire la fête et mener une brillante vie.
Lazare était couvert d’ulcères, il était sale et devait sentir mauvais, mais c’est lui qui repose dans le sein d’Abraham. Dans une autre parabole, Jésus dira que c’est dans l’indigent, le malade et l’étranger qu’il est présent dans le monde (Mt 25.31-40).
Production : Fondation Bersier – Regards protestants
Intervenants : Antoine Nouis, Christine Pedotti