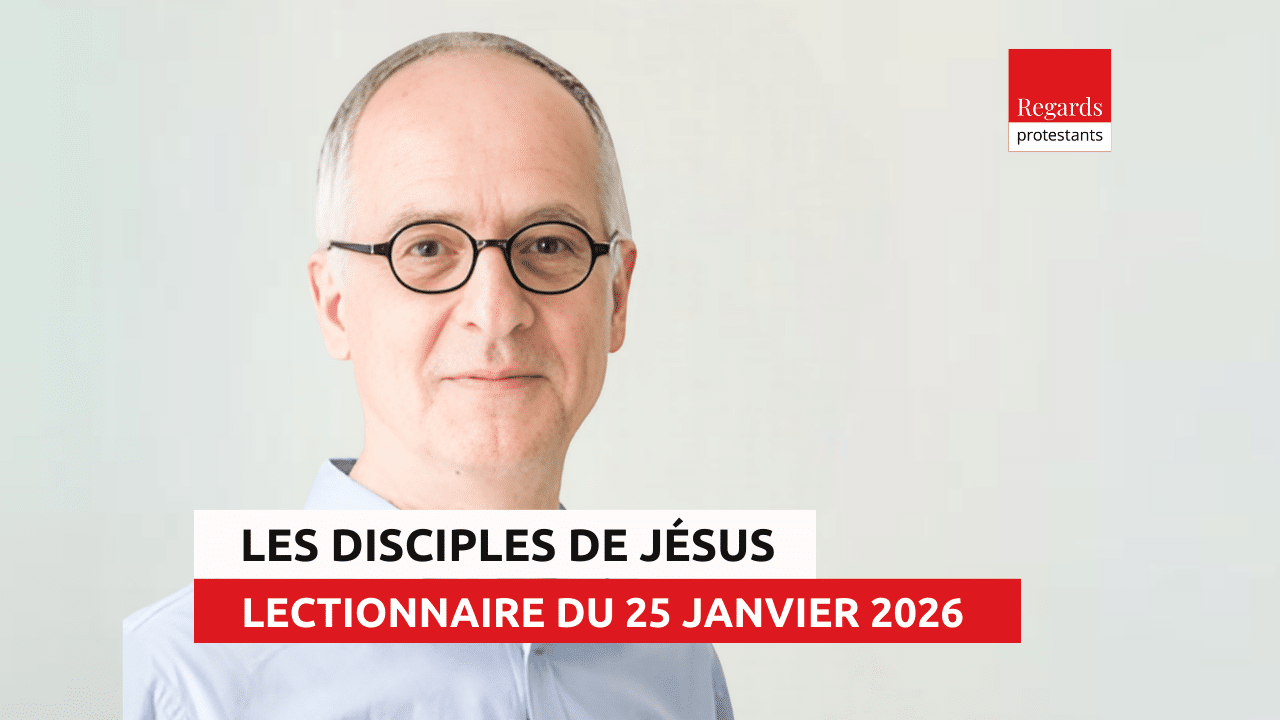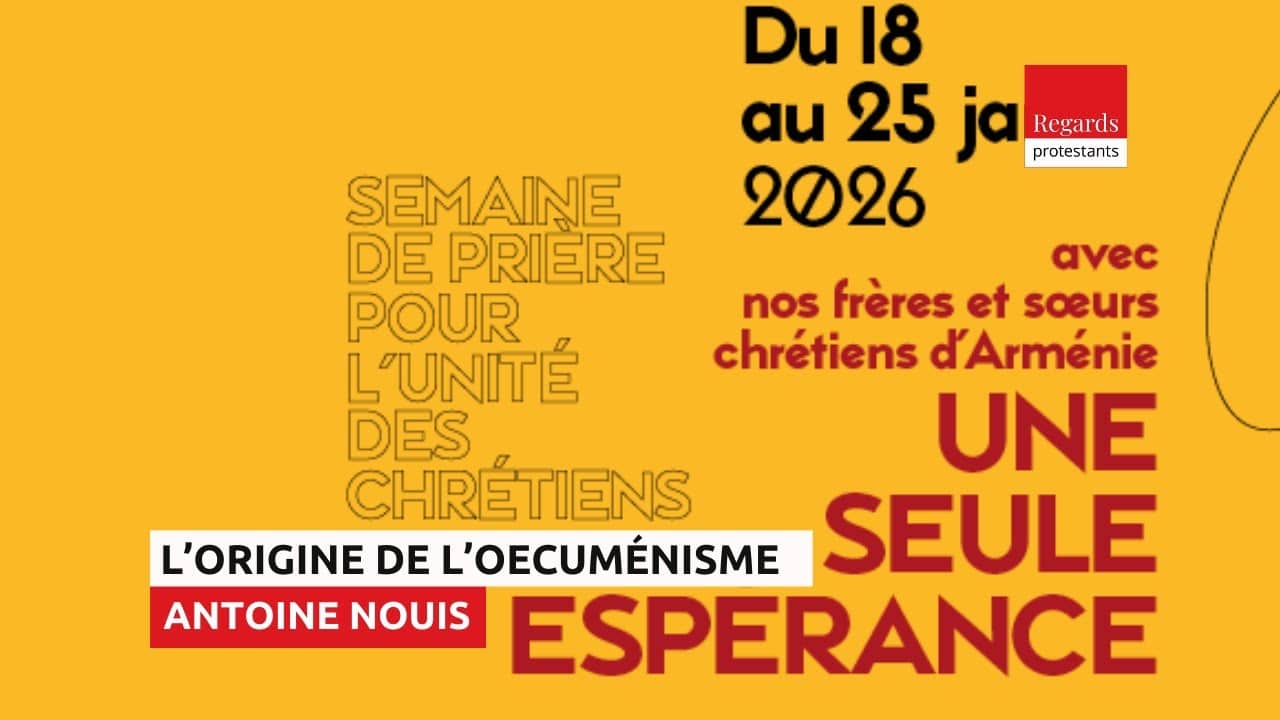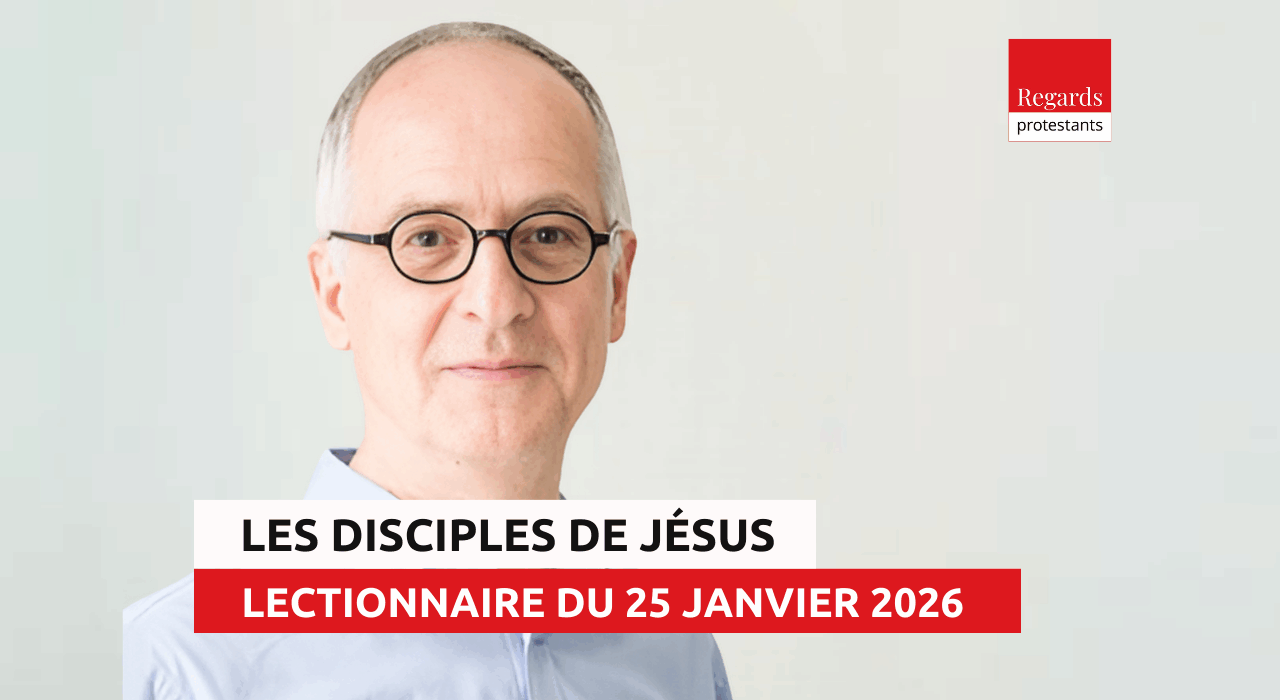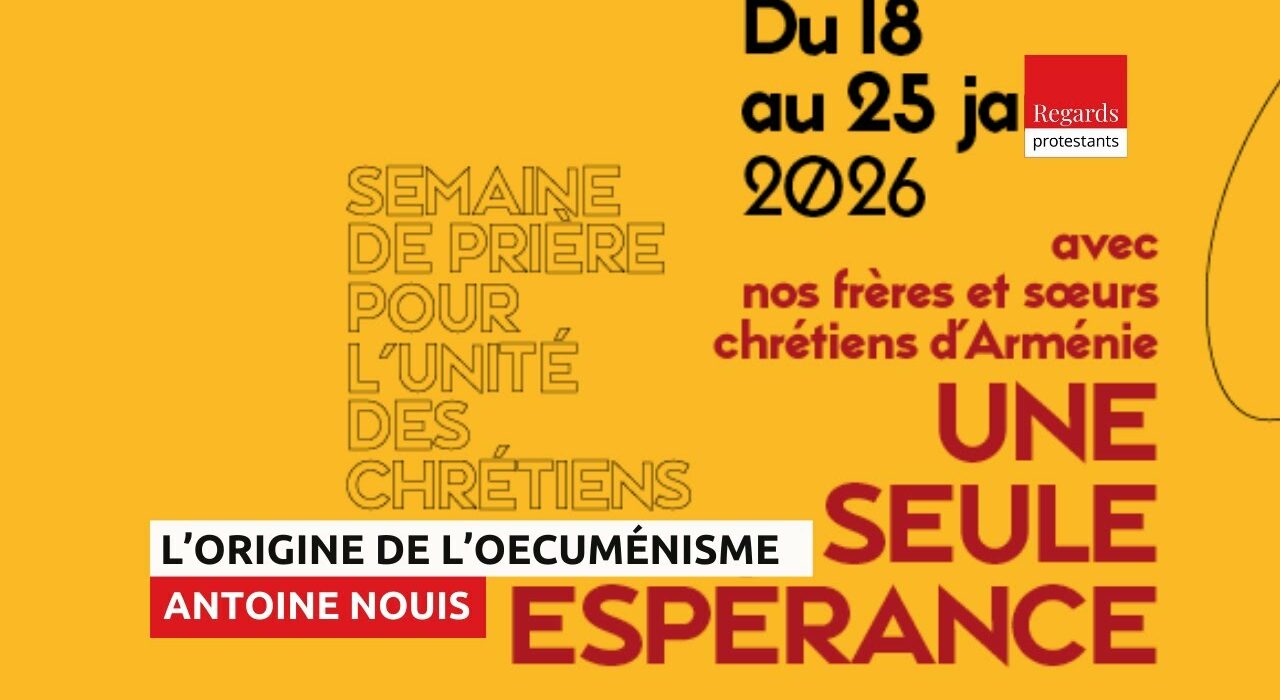L’évangile du dimanche du 31 août (Luc 14, 1.7-14)
Les arts du repas
Introduction
Dans la séquence précédente, des pharisiens ont conseillé à Jésus de fuir car Hérode voulait le tuer. Dans le texte d’aujourd’hui, un autre pharisien l’invite à manger, mais on a l’impression que c’est pour le piéger. Il n’est pas invité pour lui-même, mais pour voir comment il réagit face à un hydropique.
Points d’exégèse
Attention sur deux points.
Titre : Les repas chez Luc
Cela fait le quatrième repas de l’évangile de Luc. Jésus a déjà partagé la table de Lévi le collecteur de taxes, ce qui lui a donné l’occasion de préciser sa mission (Lc 5.29-39). Il a répondu à l’invitation de deux pharisiens : Simon chez qui il a accueilli l’offrande d’une femme pécheresse (Lc 7.36-50), et il a parlé de l’amour, à une autre occasion, il a dénoncé l’hypocrisie des religieux (Lc 11.37-54). À tous ces repas, nous pouvons ajouter la multiplication des pains et le repas pascal qu’il partagera avec ses disciples. Dans le troisième évangile, Jésus a annoncé le royaume à l’occasion des rassemblements de la vie quotidienne.
Titre : L’hydropique
L’hydropisie est une maladie qui se manifeste par des gonflements. Un enseignement de la tradition rabbinique dit que l’homme est composé de sang et d’eau. S’il est vertueux, les deux sont en équilibre ; s’il se laisse aller au péché, soit l’eau domine et il devient hydropique, soit c’est le sang et il devient lépreux. Comme souvent, la maladie est comprise comme une conséquence du péché.
Le texte dit que les pharisiens observent Jésus lorsqu’on a placé un hydropique en face de lui. Le malade n’est pas un sujet, c’est un objet qui est placé là pour piéger Jésus.
Pistes d’actualisation
1er thème : Le sabbat
Le sabbat est un marqueur identitaire très fort dans le judaïsme. C’est le commandement qui est répété le plus grand nombre de fois dans le livre de l’Exode. La tradition orale disait qu’on devait soigner un humain s’il était en danger de mort, mais que si ce n’était pas le cas il fallait attendre la fin du sabbat.
En guérissant le jour du sabbat, Jésus transgresse cette interprétation. Dans les évangiles, plus de la moitié des guérisons sont faites sont un jour de sabbat, ce qui veut dire que Jésus ne considère pas le sabbat comme un jour quelconque – si c’était le cas, le septième des guérisons aurait lieu ce jour-là – mais que le fait de guérir était une bonne façon de vivre le sabbat. Le sabbat comme jour de grâce, un jour privilégié pour guérir, pour sauver et libérer.
2e thème : Choisir la dernière place
Dans les repas, il y a ceux qui se mettent devant pour qu’on les voit, et ceux qui acceptent de prendre la dernière place pour laisser les autre dans la lumière.
L’humilité dans la Bible n’est pas une invitation à se diminuer, mais à élever les autres. Le Père de l’Église Dorothée de Gaza a écrit en pensant à la même origine entre les mots humilité et humus : « Le bâtisseur doit poser chaque pierre sur du mortier, car s’il mettait les pierres les unes sur les autres sans mortier, elles se disjoindraient et la maison tomberait. Le mortier, c’est l’humilité, car il est fait avec la terre, que tous ont sous les pieds. Une vertu sans humilité n’est pas une vertu. »
3e thème : Logique de l’échange ou de la générosité
La coutume qui veut qu’on ne partage le repas qu’avec ceux de son groupe s’inscrit dans la logique de l’échange : « Je t’invite parce qu’on appartient au même monde et que tu m’inviteras. »
Jésus appelle à une autre logique : « Invite ceux qui ne te rendront pas ». À la logique de la réciprocité, il oppose la logique de la générosité comme il l’a dit dans le sermon dans la plaine : Donnez, et l’on vous donnera ; on versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, serrée, secouée et débordante ; car c’est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu’on mesurera pour vous en retour (Lc 6.38).
Une illustration : Jésus et les repas
Dans l’antiquité, le repas est un événement social et un marqueur identitaire. On mange avec ceux de son groupe. Le repas trace les limites, les frontières, du groupe auquel on adhère. Dans un premier temps on a le sentiment que Jésus conteste ce principe. Dans une deuxième lecture, on peut entendre que Jésus adhère à cette compréhension, mais qu’il affirme que ceux de son groupe, ce sont les malades, les pauvres, les estropiés, les infirmes et les aveugles.
Nous retrouvons le renversement de la parabole du jugement dernier qui dit que Jésus est dans le malade, l’affamé, le prisonnier et l’indigent.
L’épître aux Hébreux du dimanche 31 août (Hébreux 12.18-24 )
Un Dieu qui se laisse approcher
Le contexte – L’épître aux Hébreux
L’épître aux Hébreux est originale dans le Premier Testament en réinterprétant le ministère du Christ à partir des catégories religieuses du Premier Testament.
Après avoir relu la mort du Christ dans les catégories du sacrifice pour le pardon, elle montre comment des hommes et des femmes du Premier Testament ont vécu dans la fidélité et la persévérance même s’ils n’ont pas vu l’accomplissement de ce qu’ils attendaient.
Dans le passage de cette semaine l’auteur montre en quoi la nouvelle alliance surpasse la première parce qu’elle permet un accès direct au divin
Que dit le texte ? – La proximité de Dieu
Dans le livre de l’Exode, Dieu se révèle dans des manifestations cosmiques impressionnante : Le troisième jour, au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne, avec un fort son de trompe ; tout le peuple qui était dans le camp se mit à trembler… Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que le Seigneur y était descendu dans le feu ; sa fumée montait comme celle d’un fourneau, et toute la montagne tremblait avec violence (Ex 19.16-18).
Cette description souligne par contraste la simplicité de la révélation de Dieu dans la nouvelle alliance. Il ne se révèle plus dans des manifestations effrayantes, mais dans la simplicité d’un homme qui est mort sur une croix et qui est le médiateur d’une nouvelle alliance marquée par la proximité d’un Dieu qui se laisse trouver.
À la manifestation du livre de l’Exode qui multiplie les manifestations cosmiques, l’épître aux Hébreux s’inscrit plutôt dans la tradition du passage du Deutéronome qui dit : Car ce commandement que j’institue pour toi aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de ta portée. Il n’est pas dans le ciel, pour que tu dises : « Qui montera pour nous au ciel afin de nous l’apporter et de nous le faire entendre, pour que nous le mettions en pratique ? » Il n’est pas de l’autre côté de la mer, pour que tu dises : « Qui passera pour nous de l’autre côté de la mer afin de nous l’apporter et de nous le faire entendre, pour que nous le mettions en pratique ? » Cette parole, au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique (Dt 30.11-14).
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – L’humilité possible
Lorsque Jésus appelle ses disciples à ne pas chercher la première place au nom du principe selon lequel celui qui s’élève sera abaissé et celui qui s’abaisse sera élevé, il les appelle à l’humilité. Cette humilité est possible quand on sait qui on est.
Quand on vit en Christ, on n’a plus besoin de se mettre en avant car notre identité ne repose sur le regard que les autres posent sur nous, mais sur notre statut d’enfant d’un Dieu qui a tout donné pour que nous puissions vivre.
Nous pouvons alors développer une éthique du retrait : accepter de ne pas prendre toute la place pour permettre au prochain d’occuper la sienne.
Le livre des Proverbes du dimanche 31 août (Proverbes 4.1-9)
La vraie sagesse
Le contexte – Le livre des Proverbes
Le livre des Proverbes est attribué au roi Salomon dont la sagesse est réputée. Dans la Bible la sagesse est plus que la prudence, car dit le livre de Roi à propos de Salomon : « II a parlé des arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu’à l’hysope qui sort du mur ; il a aussi parlé des bêtes, des oiseaux, des bestioles et des poissons » (1 R 5.12-13). La sagesse ici est la connaissance du monde et des humains et de leur fonctionnement.
L’origine de la sagesse de Salomon se trouve dans un épisode fondateur. Au début de sa royauté, une nuit, Dieu lui est apparu pour lui demander ce que son cœur désirait. Salomon qui se sentait trop petit pour la tâche qui l’attendait a demandé un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bon du mauvais ! Dieu lui a répondu : Puisque c’est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie, que tu ne demandes pas pour toi la richesse, que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, puisque tu demandes pour toi de l’intelligence afin d’être attentif à l’équité, j’agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu’il n’y aura jamais eu avant toi et qu’il ne se lèvera jamais plus après toi personne de semblable à toi. Je te donnerai, en outre, ce que tu n’as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire (1 R 3.5-13).
Salomon a été sage parce qu’il a eu l’intelligence de demander la sagesse.
Que dit le texte ? – Parole d’un père à un fils
Un père s’adresse à ses fils dans une chaîne de transmission. Il se souvient qu’il a lui-même reçu l’enseignement de son propre père qui l’invitait à la sagesse. Dans ses vieux jours, il peut témoigner que ce fut pour lui un chemin de vie comme ce le sera pour ses enfants.
On retrouve le thème qui est au début du livre : Mon fils… si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur vers l’entendement ; oui, si tu appelles l’intelligence, et si tu élèves ta voix vers l’entendement, si tu cherches cela comme l’argent, si tu le recherches comme des trésors, alors tu comprendras la crainte du Seigneur et tu trouveras la connaissance de Dieu (Pr 2.1-5).
Socrate disait à propos d’un de ses interlocuteurs : « Ni lui ni moi ne connaissons quelque chose de beau et de bon, mais il pense qu’il en connaît alors qu’il n’en connaît pas, tandis que je n’en connais pas et ne pense pas en connaître. Je suis plus sage uniquement sur ce point que je ne pense pas savoir ce que je ne sais pas. » Autrement dit, il n’y a que deux sortes de gens en ce monde : Les sages qui savent qu’ils ne sont pas, et les sots qui se croient sages.
À partir de ce commandement, le judaïsme a cultivé la mystique de l’étude : ne jamais cesser de chercher.
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – Choisir la dernière place
Si la première marque de la sagesse est de savoir qu’on ne sait pas, cela conduit à l’humilité. C’est cette humilité que Jésus met en avant en conseillant de ne pas chercher les premières places au nom du principe que celui s’élève sera abaissé et que celui qui s’abaisse sera élevé.
La vraie sagesse ne fait pas de bruit, elle ne se met pas en avant. Nous pouvons dire de la sagesse ce que Paul dit de l’amour : L’amour est patient, l’amour est bon, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d’orgueil… il ne se réjouit pas de l’injustice, mais il se réjouit avec la vérité ; il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout (1 Co 13.4-7).
Production : Fondation Bersier – Regards protestants
Intervenants : Antoine Nouis, Christine Pedotti