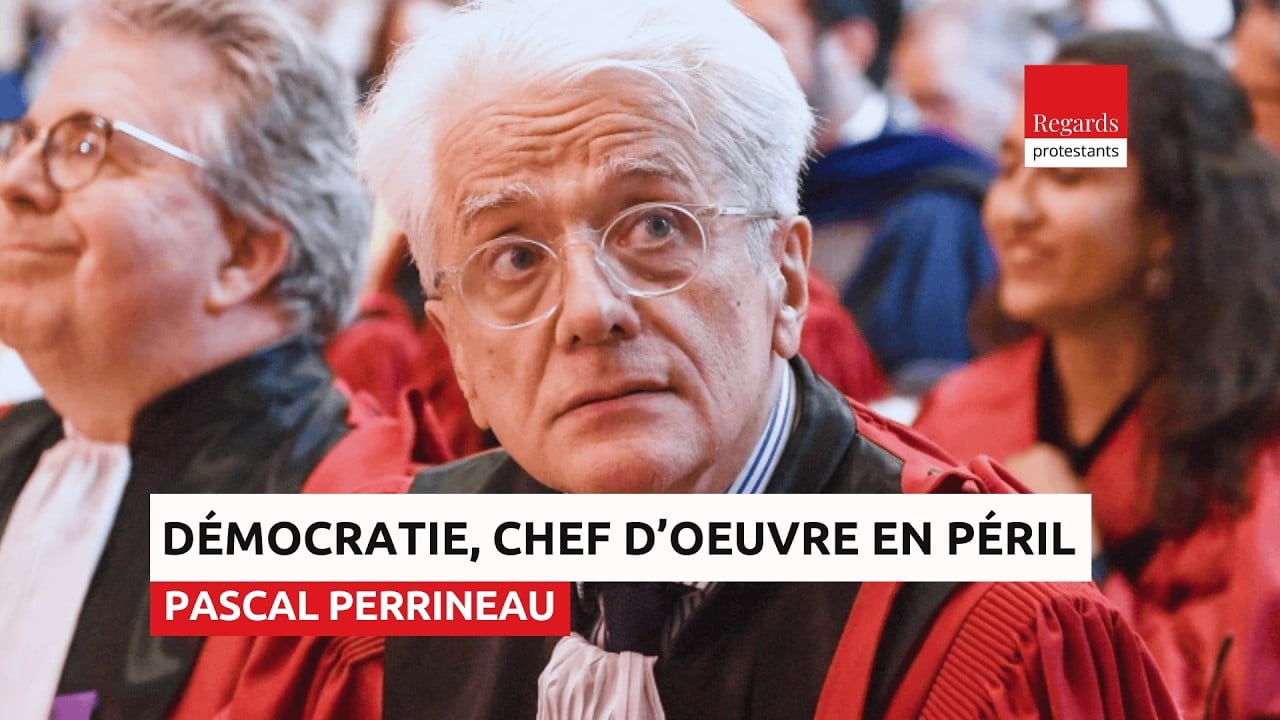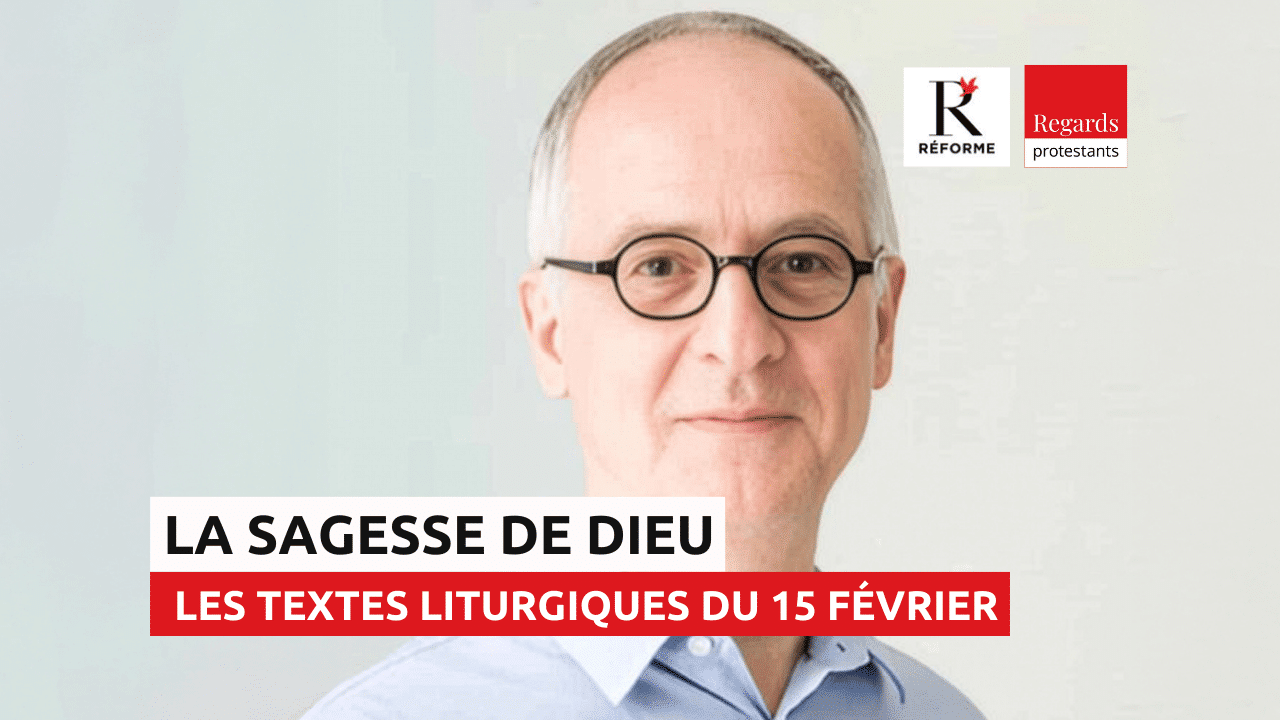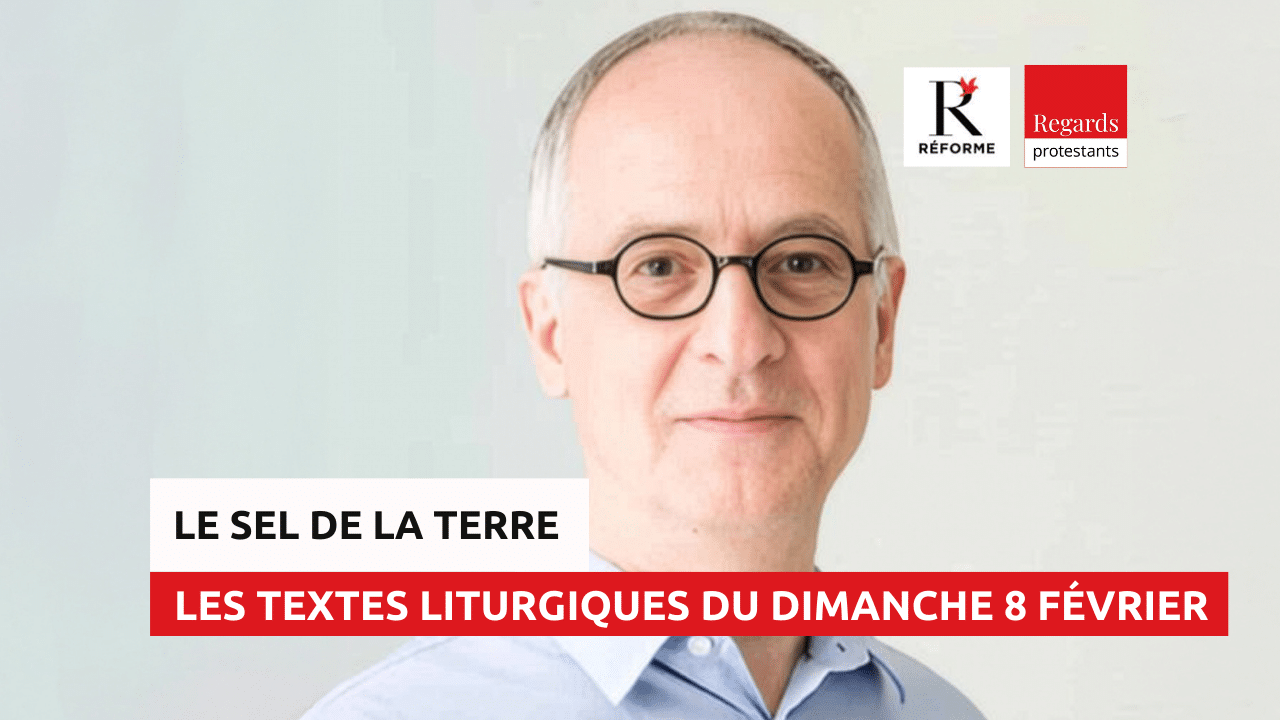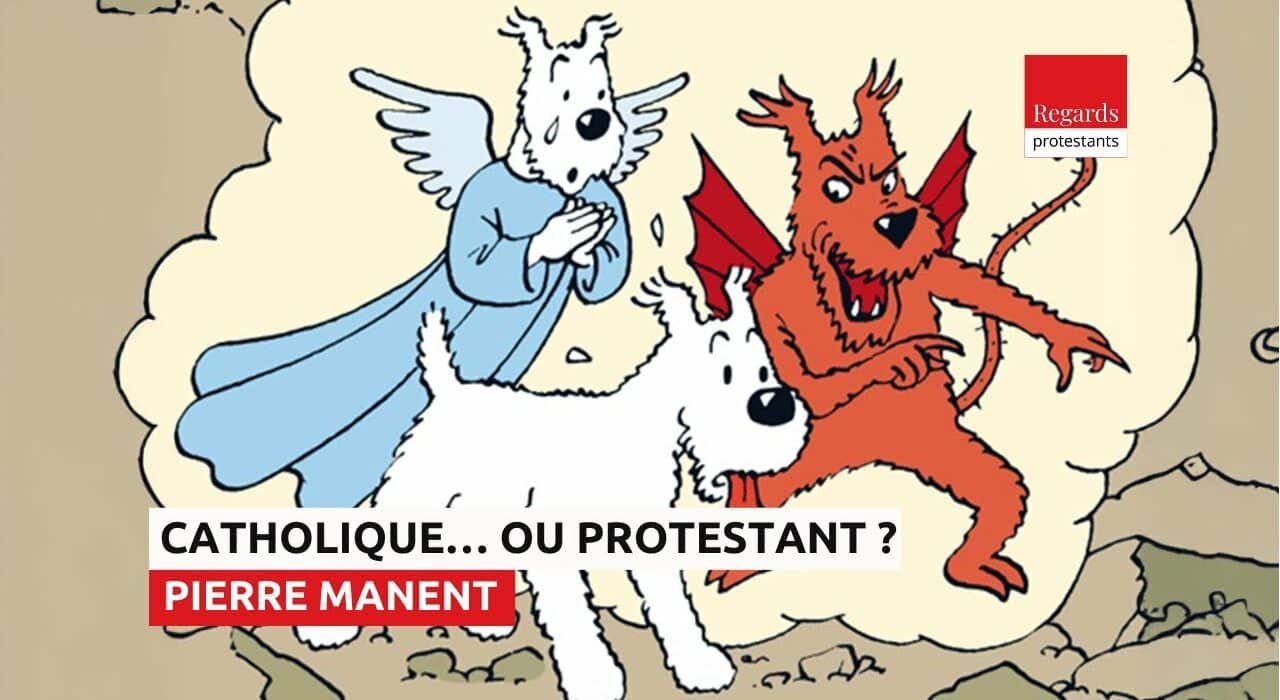L’évangile du dimanche du 5 octobre (Luc 17, 5-10)
Introduction
Le verset qui précède l’évangile de ce dimanche est un appel au pardon, un pardon inconditionnel puisque Jésus déclare que si ton frère… pèche contre toi sept fois par jour, et que sept fois il revienne à toi, en disant : « Je vais changer radicalement », tu lui pardonneras. Le chiffre sept fait sortir le pardon de notre comptabilité : Jésus ne dit pas combien de fois il faut pardonner, il dit qu’il faut toujours pardonner. Devant la radicalité de l’enseignement, les disciples posent la seule vraie question que nous devons poser lorsque nous nous présentons devant le Seigneur : Donne-nous plus de foi.
La première demande que nous pouvons exprimer dans notre prière est la demande de la foi.
Points d’exégèse
Attention sur deux points.
Le grain de moutarde
À la demande de la foi, Jésus répond par une pirouette : Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier : « Déracine-toi et plante-toi dans la mer », et il vous obéirait.
Jésus avait déjà utilisé l’image de la graine de moutarde pour évoquer la foi lorsqu’il avait annoncé que le règne de Dieu est semblable à une graine de moutarde qu’un homme a prise et jetée dans son jardin ; elle pousse, elle devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches (Lc 13.19). Ici, l’arbre n’accueille pas les oiseaux du ciel, mais va se planter dans la mer !!! Même si on ne comprend pas très bien l’intérêt pour un arbre d’aller se planter dans la mer, le disciple peut entendre que sa foi n’a pas encore atteint la taille d’un grain de moutarde, ce qui rend d’autant plus légitime la question du verset précédent.
Situation de la première Église
L’Église qui a reçu l’évangile de Luc était une toute petite communauté, pas plus grande qu’un grain de moutarde face à l’Empire romain. Elle pouvait se demander comment elle pouvait témoigner de la victoire de l’Évangile alors que son influence était ridicule dans le monde qui était le sien.
Jésus répond qu’un petit grain de moutarde peut déraciner les arbres les plus majestueux.
Tous ceux qui pourraient se décourager devant la petitesse de l’Église actuelle peuvent entendre qu’un tout petit grain d’Évangile peut venir à bout des arbres les mieux plantés.
Pistes d’actualisation
1er thème : Parabole du serviteur : Qu’est-ce que la foi ?
Ces versets sont choquants au regard des mœurs sociales de notre temps, mais tout à fait ordinaire pour l’époque. Le rôle d’un serviteur est de servir son maître toute la journée, et pas seulement dans les champs. La première façon d’augmenter notre foi est de vivre l’obéissance à l’Évangile toute la journée. Comme dans la parabole des deux maisons (Lc 6.48-49), la foi n’est pas d’abord une question de croyance ou de sentiment, mais de mise en pratique, et de service.
La foi est un pari, le pari du service, de la grâce, de l’espérance, de la prière, de la confiance… Lorsque nous osons faire ce pari, notre vie apparaît plus grande, plus belle et cela alimente notre foi.
2e thème : Nous n’en avons jamais fini avec la foi
Un des grands thèmes de la parabole est que nous n’en avons jamais fini avec la foi, jamais nous pouvons dire : J’ai fait ce que je devais, je suis quitte avec la foi. Seuls les hypocrites disent cela et au fond d’eux ils savent bien qu’ils se mentent à eux-mêmes.
Cela ne veut pas dire qu’il faut passer sa vie à faire de bonnes œuvres mais que nous devons vivre toute notre vie devant Dieu. C’est comme lorsque l’apôtre Paul exhorte : Priez sans cesse (1 Th 5.17), Paul ne nous demande pas de passer toutes nos journées àgenoux, mais d’avoir en tout temps conscience que nous nous tenons devant Dieu.
3e thème : Le serviteur inutile
Au disciple qui demande à Jésus d’augmenter sa foi, ce dernier répond que le plus dévoué des serviteurs ne sera jamais qu’un serviteur inutile, ou quelconque, ou ordinaire. Avoir une grande fois ne fait pas de nous des héros, mais des serviteurs quelconques. Inversement, nous pouvons entendre que les serviteurs de l’Évangile les plus ordinaires et les plus humbles sont ceux qui ont la plus grande foi.
Jésus ne nous demande pas d’être des héros de la foi, mais des serviteurs de tous les jours. La vraie foi ne se repère pas dans notre capacité à déraciner des arbres pour les envoyer se planter en mer, mais par une humble fidélité quotidienne.
Dans l’hymne de 1 Co 13, l’amour ce n’est pas de distribuer tous ses biens et livrer son corps par fierté, c’est pardonner tout, croire tout, espérer tout, endurer tout.
Une illustration : Une foi radicale
Pour évoquer la foi qui déplace les montagnes, Zvi Kolitz est un auteur juif qui a écrit un petit récit de fiction qui rapporte les propos de la lettre qu’un des derniers combattants du ghetto de Varsovie écrit à Dieu. Elle se termine de la façon suivante : « Quand j’étais jeune, mon rabbi m’a maintes fois raconté l’histoire d’un Juif qui, avec sa femme et leur enfant, a fui l’inquisition espagnole. Il a pris la mer à bord d’un petit bateau, et réussi malgré la tempête à gagner un îlot rocailleux. Là, un éclair foudroie sa femme. Puis une tornade emporte l’enfant dans les flots. Seul, malheureux comme les pierres, les mains levées vers le ciel, le Juif s’adresse à Dieu : « Dieu d’Israël, j’ai fui jusqu’ici pour pouvoir te servir librement, pour observer tes commandements et sanctifier ton nom. Mai toi, tu fais tout pour m’empêcher de croire en toi. Cependant, si tu penses réussir à me détourner du droit chemin par ces épreuves, je te crie : Tu en seras pour ta peine. Tu as beau m’offenser et me fustiger, je croirai toujours en toi ».
La première épître à Timothée du dimanche 5 octobre (2 Timothée 1.6-14)
Souffrir pour l’Évangile
Le contexte – La deuxième épître à Timothée
Comme la première épître à Timothée, la deuxième évoque le contexte d’une Église installée qui ne vit plus dans l’imminence de la venue du Christ en gloire, mais qui doit affronter l’inscription dans le temps et l’usure de la fidélité.
Beaucoup d’exégètes que cette épître n’est pas de la main de Paul mais d’un de ses disciples. Si c’est le cas, l’auteur se met dans la peau de son maître en multipliant les références à sa situation particulière en disant qu’il est en prison et qu’il annonce sa mort à venir : Le temps de mon départ est arrivé (2 Tm 4.6)… j’ai mené le beau combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi (2 Tm 4.7).
Cette épître se présente comme un testament en invitant Timothée à prendre le relais de son maître et à tenir ferme dans la foi.
Que dit le texte ? – Le carburant de la fidélité
Pour encourager son disciple à la fidélité, l’épître avance trois arguments.
Ranime la flamme du don de la grâce, du don de Dieu, que tu as reçu par l’imposition de mes mains. Timothée est invité à faire mémoire de ce qui fonde sa vocation. Quand on ne sait plus où est Dieu, on peut faire mémoire de ces temps où il nous a construit. J’aime beaucoup cette définition de Louis Evely : « La foi est un mélange de lumière et d’obscurité. Croire, c’est être fidèle dans les ténèbres à ce qu’on a vu dans la lumière. »
Paul évoque sa propre situation alors qu’il est en prison pour l’Évangile : Souffre avec moi pour la bonne nouvelle, par la puissance de Dieu. Quand on est dans le combat de la fidélité, il est bon de savoir qu’on n’est pas seul. La fidélité des autres encourage la nôtre comme on peut être un encouragement pour son prochain : l’Église comme un rassemblement de frères et de sœurs qui s’encouragent les uns les autres dans leur chemin de fidélité.
Enfin ne jamais oublier que le fondement de la foi ne réside pas dans nos propres forces, mais dans la grâce du Christ qui a réduit à rien la mort et mis en lumière la vie et l’impérissable par la bonne nouvelle. Si nous sommes invités à nous enraciner dans ce qui nous fonde, nous pouvons aussi tendu vers l’espérance d’un évangile impérissable qui est plus fort que la mort et qui nous appelle à l’éternité.
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – la parabole du serviteur qui n’a fait que son devoir
La parabole de l’Évangile de ce dimanche nous renvoie à notre fidélité la plus quotidienne. Si nous sommes enracinés dans l’assurance que nous avons été appelés par le Christ et que nous sommes appelés à la résurrection, nous sommes libérés du devoir de donner un sens à notre existence et nous pouvons vivre la fidélité au quotidien.
Il ne nous appartient pas de faire venir le royaume de Dieu sur terre – cela relève vu du Christ – il nous appartient de poser des signes de ce royaume en vivant dans la fidélité, l’amour et la pondération comme un fidèle serviteur.
Le livre d’Habacuc du dimanche 5 octobre (Habacuc 1.2-3, 2.2-4)
Rester fidèle en tout temps
Le contexte – Le prophète Habacuc
Le livre d’Habacuc est un prototype des livres prophétiques en ce qu’il cherche à dire une parole sur Dieu dans une époque particulièrement tourmentée. Où est Dieu quand l’histoire est tragique, quand le royaume d’Israël est tombé sous le coup des Assyriens, quand le royaume de Juda est menacé et qu’il va chuter à son tour sous le coup des Chaldéens ? Où est Dieu quand le peuple est envoyé en exil ?
La réponse d’Habacuc est que le temps de Dieu n’est pas celui de ses serviteurs. Le prophète appelle ses lecteurs à prendre du recul et à analyser les événements sur le temps long.
Les serviteurs du Seigneur ne sont pas maîtres de l’Histoire avec un grand H. Leur responsabilité est de vivre la fidélité dans le temps qui est le leur.
Que dit le texte ? – Le juste vivra en tenant ferme
Le texte de ce dimanche est en deux parties. Dans la première partie, le prophète lance à Dieu un cri pathétique : Jusqu’à quand Seigneur. Quand il ne peut que constater le déferlement des ravages et de la dévastation, il n’a que ses mots pour dire le sentiment de déréliction dans lequel il se trouve. Ce cri expose une situation dramatique et toute la suite du livre peut être considérée comme une réponse à cet appel.
La suite du premier chapitre déclare que Dieu envoie les Chaldéens pour se venger des Assyriens qui ont soumis le royaume de Samarie, sauf que cette vengeance se fait dans la violence et qu’elle se soldera par la conquête du royaume de Juda et le massacre de ses habitants.
Dans la seconde partie du texte de ce dimanche, le Seigneur demande à son prophète d’écrire sur tablette la vision du jugement des Chaldéens pour soutenir l’espérance des fidèles et qu’en attendant le terme de l’histoire, ils sont invités à rester ferme dans la justice. Le Chaldéen est orgueilleux, mais ceux qui restent intègres tiendront dans la fidélité. Autrement dit, la marche de l’histoire ne nous appartient pas, ce qui nous appartient c’est notre fidélité aujourd’hui.
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – Le serviteur qui n’a fait que son devoir
Aux disciples qui demandent au Seigneur d’augmenter leur foi, ce dernier leur répond avec une parabole qui les invite à rester fidèles dans le service du maître.
La foi ne nous appartient pas. Qu’est-ce qui fait qu’on a la foi ? La théologie la présente comme un don, donc comme quelque chose qu’on ne maîtrise pas. En revanche, ce qui relève de notre responsabilité, c’est notre fidélité. La parabole de ce dimanche nous rappelle que la fidélité nourrit la foi. Être fidèle quand la vie est facile est une chose, mais le livre d’Habacuc nous appelle à la fidélité même quand les vents sont contraires et qu’on se pose des questions sur ce que fait Dieu.
La fidélité au temps d’Habacuc alors que l’histoire connaissait un véritable effondrement ne devait pas être facile, c’est pourtant par le petit reste qui a été fidèle que l’histoire s’est poursuivie. Une parabole pour notre temps.
Production : Fondation Bersier – Regards protestants
Intervenants : Antoine Nouis, Christine Pedotti