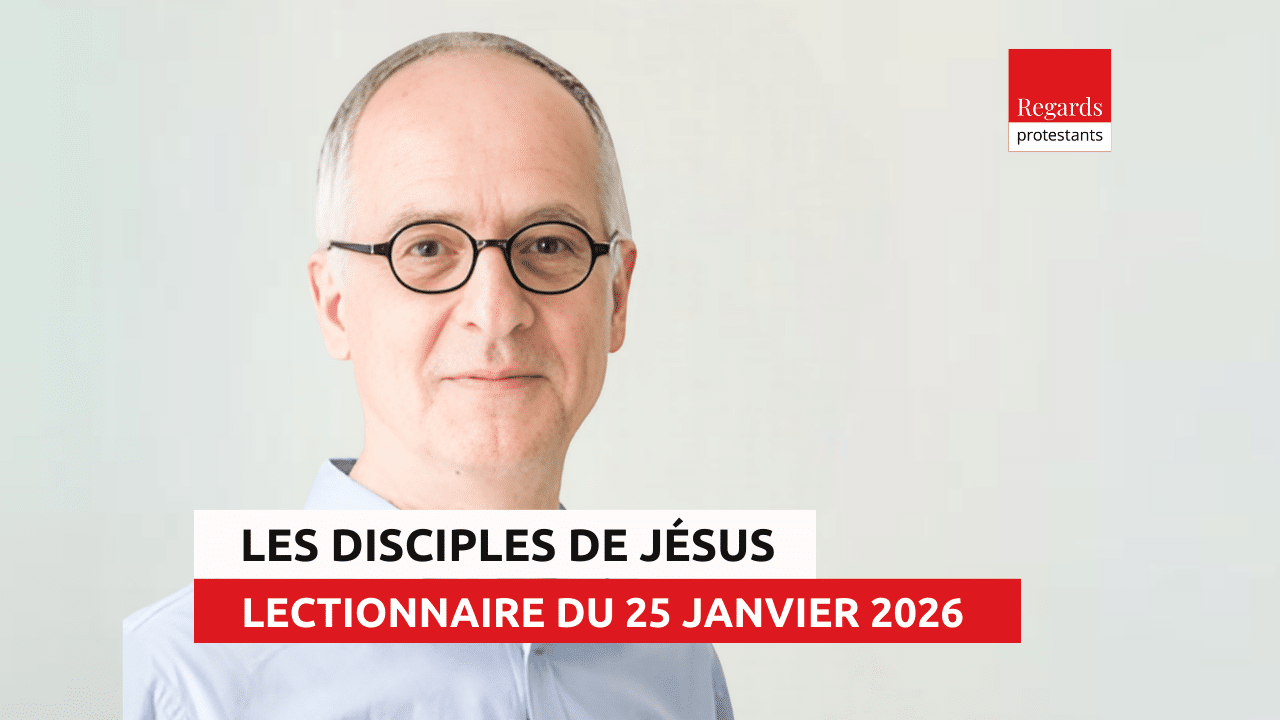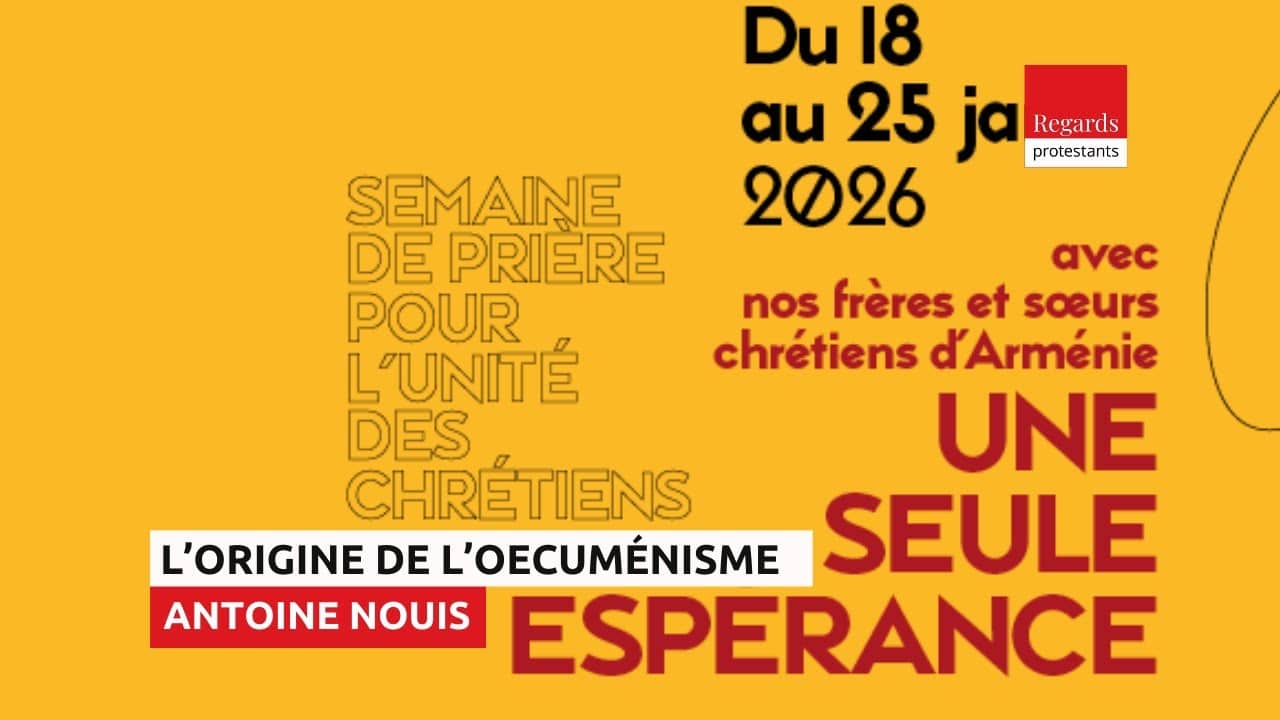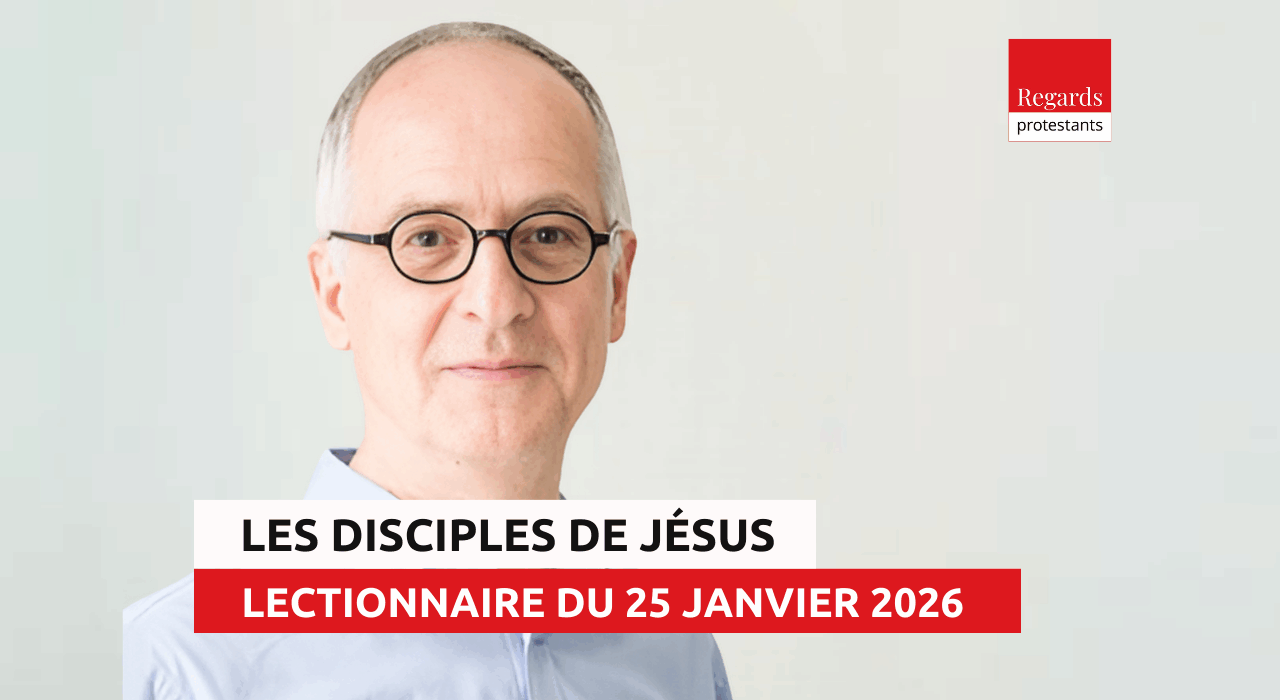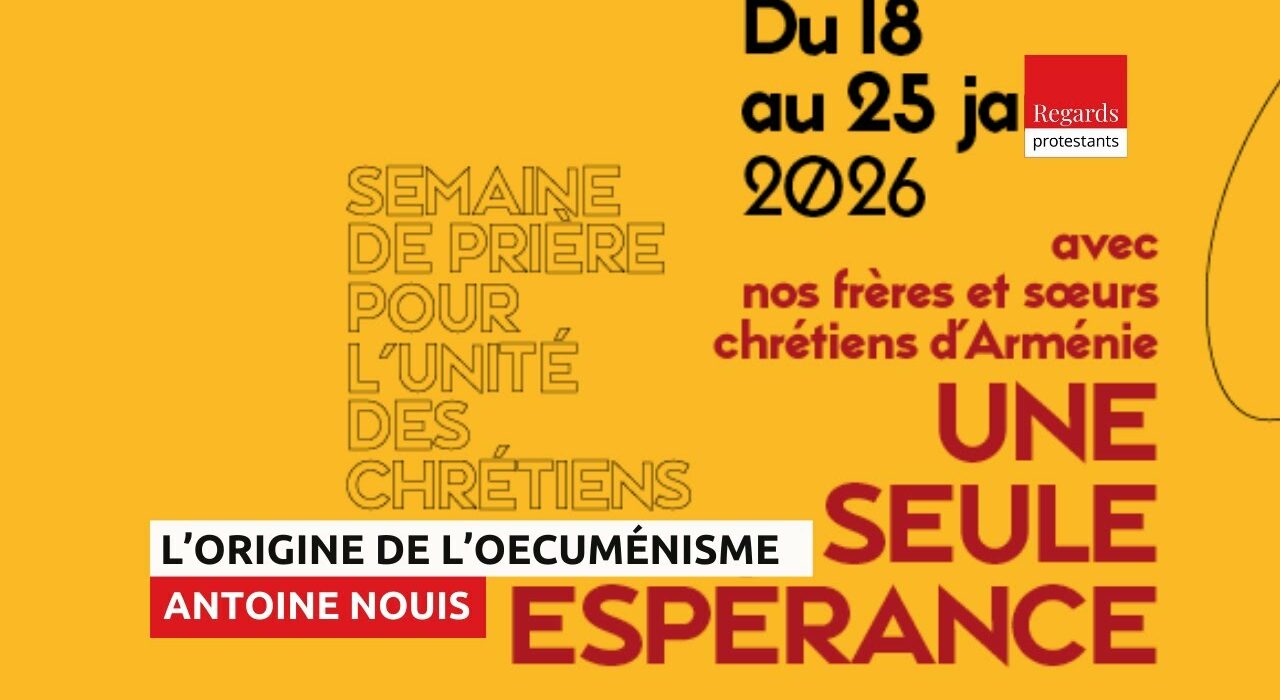L’évangile du dimanche du 7 septembre (Luc 14, 25-33)
Le livre de Philémon du dimanche 7 septembre (Philémon 9-17 )
De l’esclave au frère
Le contexte – L’épître à Philémon
Le billet à Philémon est la plus courte des épîtres pauliniennes, mais c’est une vraie lettre qui occupe toute sa place dans le canon du Nouveau Testament. Si l’épître est adressée à Philémon, elle l’est aussi à l’Église qui est dans sa maison et, dans la conclusion, Paul associe un compagnon de captivité et des collaborateurs aux salutations finales. Ces détails attirent notre attention sur le fait que cette épître a aussi une dimension universelle.
L’épître aborde la question de l’esclavage qui est importante pour la première Église. La position de Paul sur cette question est résumée dans le verset qui dit : Vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ (Ga 3.27-28). Pour Paul, l’Évangile est une identité plus importante que les distinctions religieuses, sociales ou économiques. Au nom de ce principe, il proposera aux esclaves qui le peuvent de s’affranchir, mais il dira aussi aux esclaves qui le demeurent d’être loyaux envers leurs maîtres. Il faut dire qu’à cette époque, la notion d’esclavage recouvrait des réalités très diverses. Le sort de certains esclaves était plus enviable que celui des travailleurs journaliers.
Que dit le texte ? – Paul envoie Onésime à Philémon
Onésime est un esclave qui s’est enfui de chez son maître et qui s’est converti auprès de Paul. Peut-être se sont-ils rencontrés en prison. Paul doit renvoyer Onésime à son maître afin de ne pas être complice d’une infraction, mais il le fait avec une lettre, car il s’avère que ce dernier est un chrétien de l’Église de Colosse bien connu de l’apôtre. Paul le supplie d’accueillir son esclave comme un frère, ce qu’il est en Jésus-Christ, et si possible, de le lui renvoyer, car il lui est utile dans son ministère.
Pour Paul, la structure économique est seconde par rapport aux relations interpersonnelles. En suppliant Philémon de recevoir Onésime non plus comme un esclave, mais comme un frère dans la foi, il n’est pas révolutionnaire au sens politique du terme, mais il apporte un changement de regard qui, s’il avait été entendu par les lecteurs du Nouveau Testament, aurait entraîné l’abolition des structures d’oppression.
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – Le prix de la suivance
Dans le passage de l’évangile, Jésus oppose la logique de l’Évangile à celle du monde, que ce soient le rapport avec la famille, avec les projets de construction ou avec l’argent.
La foi induit un changement de comportement qui s’applique aussi un changement dans les relations sociales. La structure économique du monde repose sur un rapport de domination entre un maître et un esclave alors que le renversement de l’évangile nous rappelle que les vrais maîtres sont les serviteurs.
Le livre des Proverbes du dimanche 7 septembre (Proverbes 8.32-36)
Le bonheur d’être sage
Le contexte – Le livre des Proverbes
Le livre des Proverbes se présente comme un recueil de sentences de sagesse d’un père à un fils. Le thème principal est l’appel à chercher, cultiver et vivre de la sagesse, en sachant que la sagesse ne réside pas dans quelques conseils de prudence pour mener une vie paisible, mais qu’elle concerne la totalité des savoirs. La sagesse est la connaissance du monde et des humains, de l’univers et des animaux.
La sagesse ne se réduit pas à la connaissance, elle induit aussi un certain comportement. Il ne suffit pas d’acquérir la sagesse, il faut aussi la vivre, ajuster son comportement à ce que l’on sait.
Que dit le texte ? – Le vrai bonheur
Heureux celui qui écoute. La sagesse commence par l’écoute. L’écoute s’oppose à la suffisance et à l’indifférence. Le suffisant n’écoute pas car il pense qu’il sait tout et l’indifférent n’écoute pas car il pense qu’il n’y a rien à apprendre.
L’écoute est le premier mot de la confession de foi du Premier Testament : Écoute Israël ! L’épître aux Romains dit que la foi vient de ce qu’on entend. Pour la cultiver, il faut donc commencer par écouter. Le judaïsme a développé une vraie mystique de l’étude au point qu’une page du Talmud dit que le Seigneur lui-même passe ses après-midis à étudier la Torah.
Heureux ceux qui gardent mes voies. Le mot important est le verbe garder. Dans le quatrième évangile, Jésus parle souvent de la foi comme le fait de garder ses commandements. Le verbe est étonnant. On se serait plutôt attendu à suivre mes voies, ou respecter mes voies.L’expression suggère l’idée de conserver et de protéger la sagesse, comme si elle était en danger. Même si on n’est pas capable de vivre pleinement les voies de la sagesse, il faut continuer à la chercher, la protéger, la conserver dans son authenticité.
Celui qui suit la sagesse aime la vie alors que les ennemis de Dieu aiment la mort. Dans l’évangile, la Parole est la vie et elle est même le chemin de la vie éternelle, c’est-à-dire une vie inscrite dans l’éternité de Dieu, par opposition aux logiques du monde qui sont des logiques de mort.
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – Le prix de la suivance
Dans le passage de l’évangile de ce dimanche, il y a trois points qui s’opposent à la sagesse.
Les attachements familiaux ou tribaux qui nous empêchent de suivre le Christ. Quand l’attachement au Christ entre en conflit avec les fidélités familiales, il faut privilégier l’attachement au Christ qui nous permet d’aimer nos proches autrement, à partir de notre liberté avec plus de vérité.
L’insouciance de celui qui s’engage dans un service sans savoir s’il est capable d’aller jusqu’au bout de son engagement. La sagesse ne s’oppose pas à la prudence.
Enfin un attachement déplacé pour ses biens et ses richesses qui nous détourne de Dieu et du prochain.
Production : Fondation Bersier – Regards protestants
Intervenants : Antoine Nouis, Christine Pedotti