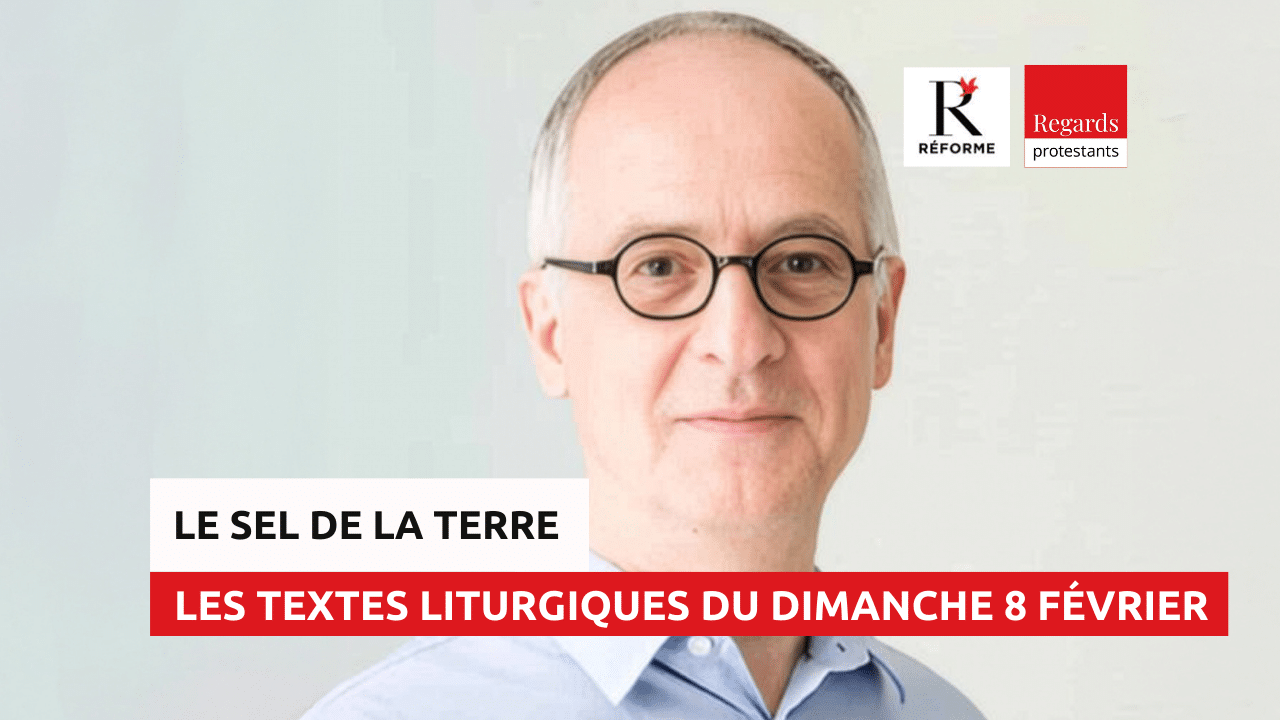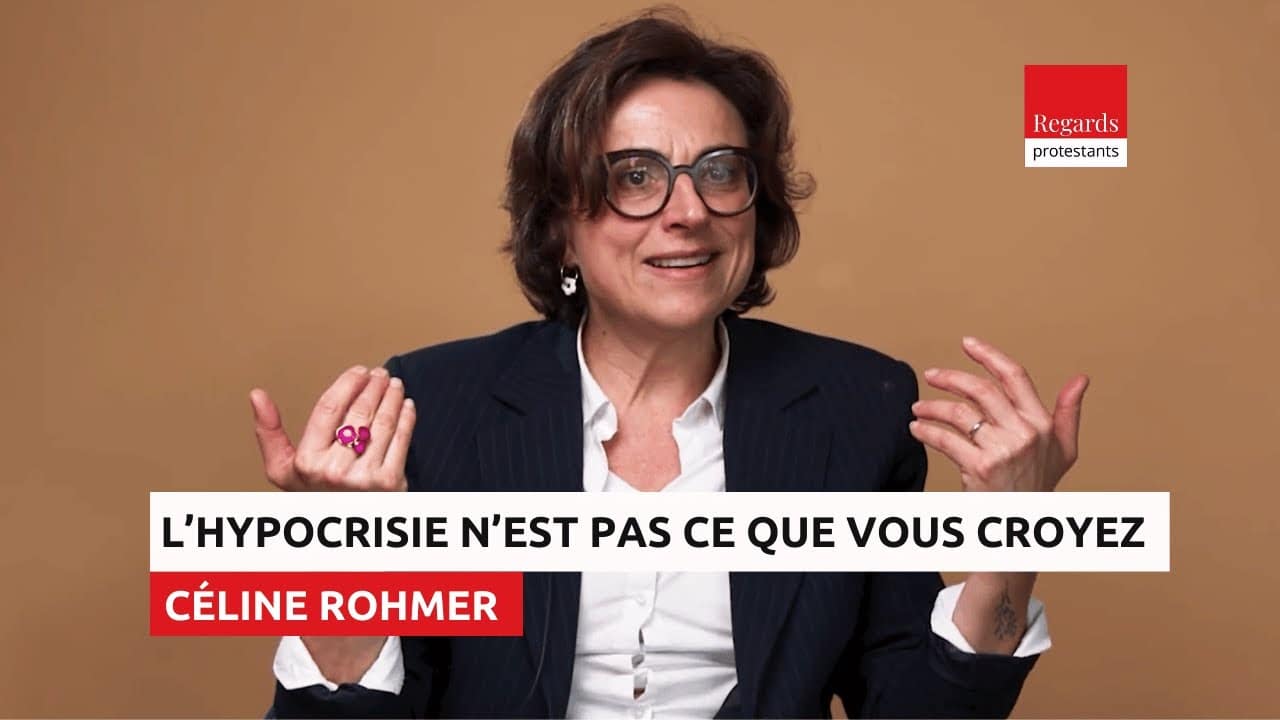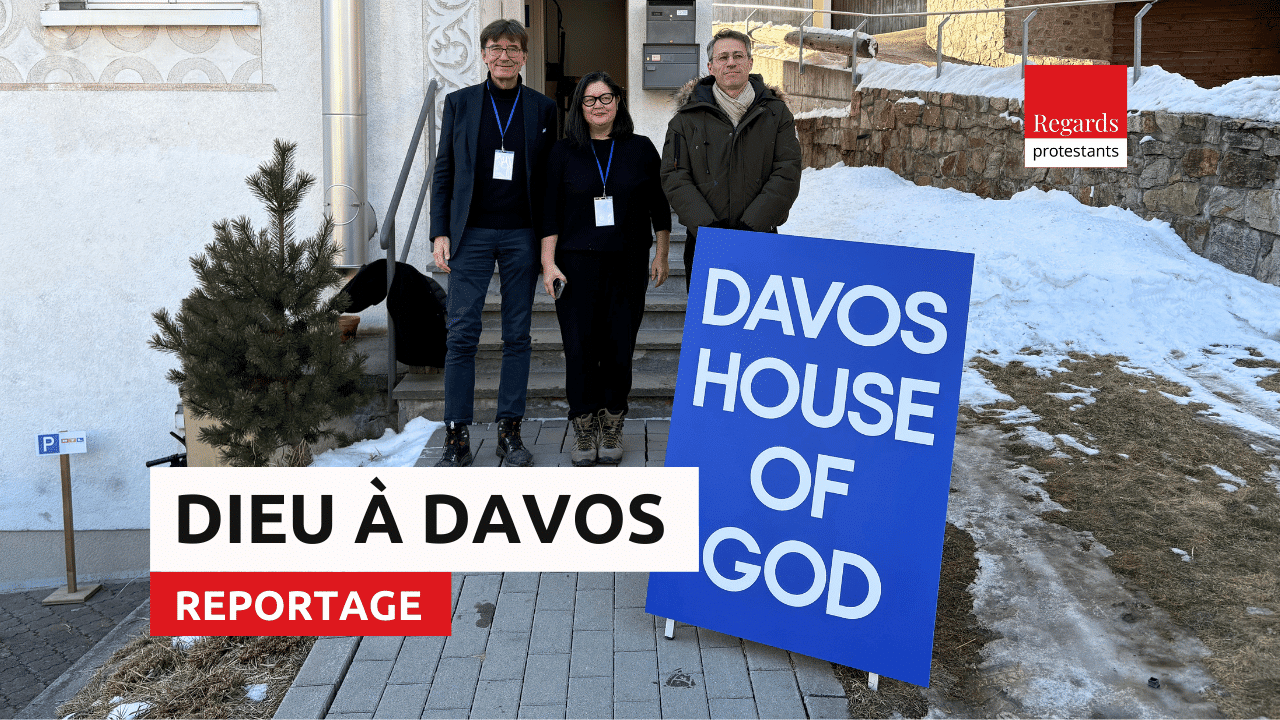L’évangile du dimanche du 9 novembre (Jean 2.13-22)
La Pâque des Juifs approchait. Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il trouva des marchands vendant bœufs, moutons et colombes, et des changeurs d’argent installés derrière leurs tables. Alors, il fit un fouet de cordes, renversa les étals, dispersa les pièces et lança : « Enlevez tout cela ! Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce ! »
Ce geste, rapporté par l’évangile de Jean, n’est pas un simple accès de colère. Il marque, dès le début du récit johannique, une rupture radicale avec le système religieux de son temps. Contrairement aux évangiles de Matthieu, Marc et Luc, qui situent cette scène à la fin du ministère de Jésus, Jean la place au commencement. Ce choix souligne une portée programmatique : dès son entrée en scène, Jésus annonce un bouleversement spirituel majeur.
Le Temple, centre du culte et de la vie religieuse juive, est alors le lieu des sacrifices et de l’autorité sacerdotale. En le traversant fouet à la main, Jésus conteste un système où la foi s’est transformée en économie. Il dénonce une religion enfermée dans ses rites et ses hiérarchies.
« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai », déclare-t-il. Les prêtres pensent au bâtiment. Lui parle de son corps. Jean souligne ainsi le déplacement : la présence de Dieu ne réside plus dans la pierre, mais dans la personne de Jésus, puis dans la communauté croyante.
Ce geste prophétique, à la fois colère sainte et annonce symbolique, inaugure une nouvelle compréhension du sacré. Jésus renverse plus que des tables : il renverse un monde.
La deuxième épître aux Thessaloniciens du dimanche 9 novembre (2 Thessaloniciens 2.16-3.5)
Encouragements pour le combat de la foi
Le contexte – La deuxième épître aux Thessaloniciens
Dans la première épître aux Thessaloniciens Paul répond à des questions qui lui ont été posées sur la venue du Seigneur. Elle témoigne d’une Église qui vit dans l’imminence de la fin des temps, c’est pourquoi Paul invite ses interlocuteurs à ne pas se détourner de leurs devoirs quotidiens (1 Th 4.11). Dans la seconde épître à cette Église, il revient sur ce thème car on apprend que certains ont abandonné leur travail dans l’attente de ce jour. Paul est sans indulgence pour ces soi-disant spirituels : Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus ! (2 Th 3.10). Il invite ses interlocuteurs à abandonner leurs spéculations sur la fin des temps pour les renvoyer à leur fidélité quotidienne.
Que dit le texte ? – Le combat de la foi
Dans le verset qui précède notre passage, Paul demande aux Thessaloniciens de tenir ferme et de rester attaché à ce qu’il leur a enseigné. Il dit ensuite son assurance que le Seigneur lui-même les encouragera dans ce chemin de fidélité en toute œuvre bonne comme en toute bonne parole !
Ensuite Paul ne veut pas se situer en position de surplomb par rapport à ses interlocuteurs, c’est pourquoi il leur demande de prier pour lui car il partage avec eux le combat de la foi. Le but de la prière n’est pas la protection des personnes, mais que la parole du Seigneur poursuivre sa course. Paul est tellement consacré à son ministère que sa motivation première est la proclamation de l’Évangile.
Paul demande dans la prière partagée avec les Thessaloniciens d’être délivré des gens méchants et mauvais qui sont ses persécuteurs. Il ajoute qu’il a la certitude que sa prière pour lui et pour les Thessaloniciens sera exaucée : Le Seigneur digne de confiance, il vous affermira et vous gardera du Mauvais. En grec, les mots foi et digne de confiance sont très proches. La fidélité du Seigneur est plus solide que l’opposition des gens méchants et mauvais.
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – Questions sur la résurrection
Les saducéens qui interrogent Jésus sur la résurrection veulent entrer dans un débat qui repose sur des spéculations sur l’au-delà. Jésus les renvoie à leur vie présente. La foi en la résurrection n’est pas une espérance qui nous détournerait de nos responsabilités humaines, elle est un encouragement pour enraciner notre vie en Christ afin de mener le combat de la foi.
La seconde épître aux Thessaloniciens transmet ce message d’une foi totalement incarnée dans les vicissitudes de notre temps.
Le livre de Daniel du dimanche 9 novembre (Daniel 3.1-30)
La fournaise ardente
Le contexte – Le livre de Daniel
La rédaction du livre de Daniel date du deuxième siècle avant notre ère, alors que les enfants d’Israël subissaient la persécution des Séleucides qui ont profané le temple et hellénisé la religion.
Les chapitres 1 à 6 racontent la fidélité de Daniel face à Nabuchodonosor et aux rois perses. Dans les premiers chapitres, Nabuchodonosor fait un rêve. Comme il a des doutes sur les capacités divinatoires des mages de son royaume, il les teste en leur demandant de deviner son rêve et d’en donner l’interprétation, sinon ils seront cruellement mis à mort. Les mages reconnaissent leur incapacité.
Daniel en appelle à la compassion de Dieu afin qui lui révèle le mystère qu’il communique au roi. Le rêve évoque une statue dont les parties évoquent différents empires qui se succéderont. Le dernier sera détruit par une pierre lancée par une main inconnue. Les commentaires ont vu dans ce rêve une description des empires qui se sont succédé au Moyen-Orient.
Daniel est nommé chef suprême de tous les sages de Babylone, ce qui va susciter la jalousie des conseillers du roi.
Que dit le texte ? – La vengeance des conseillers
Nabuchodonosor a fait ériger une statue immense à son honneur et convoque à son inauguration toutes les autorités et tous les peuples qu’il a soumis afin qu’ils se prosternent devant elle.
Les compagnons de Daniel sont dénoncés pour ne pas s’être prosternés devant la statue par les conseillers du roi qui étaient jaloux de leur promotion. Ils sont conduits devant Nabuchodonosor devant qui ils répètent leur refus. Ce dernier furieux demande qu’ils soient jetés dans une fournaise ardente.
Les trois compagnons sont envoyés au supplice dans la fournaise, et ils ne sont pas brûlés. Nabuchodonosor leur ordonne de sortir et demande que les Juifs soient respectés. Il restitue les compagnons dans leur responsabilité dans la province de Babylone.
Adressés à des juifs qui sont persécutés lorsqu’ils refusent de renoncer à leur particularité, les premiers chapitres du livre de Daniel sont un encouragement adressé à ceux qui résistent.
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – Questions sur la résurrection
La première apparition d’un texte clair sur une résurrection individuelle et différenciée dans le Premier Testament se trouve dans le livre de Daniel : Une multitude, qui dort au pays de la poussière, se réveillera – les uns pour la vie éternelle et les autres pour le déshonneur, pour une horreur éternelle(Dn 12.2).
Cette idée s’est imposée en période de persécution pour répondre au sentiment d’injustice face à ceux qui meurent martyrs par fidélité à leur foi. Dans le Nouveau Testament, cette espérance sera confortée par la résurrection du Christ.
L’évangile part d’une discussion rabbinique venant des saducéens sur les conditions de la résurrection, Jésus répond en renvoyant ses interlocuteurs à leur vie présente : Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. C’est au nom de ce Dieu vivant que Daniel et ses compagnons n’ont pas transigé avec leur fidélité.
Production : Fondation Bersier – Regards protestants
Intervenants : Antoine Nouis, Florence Taubmann