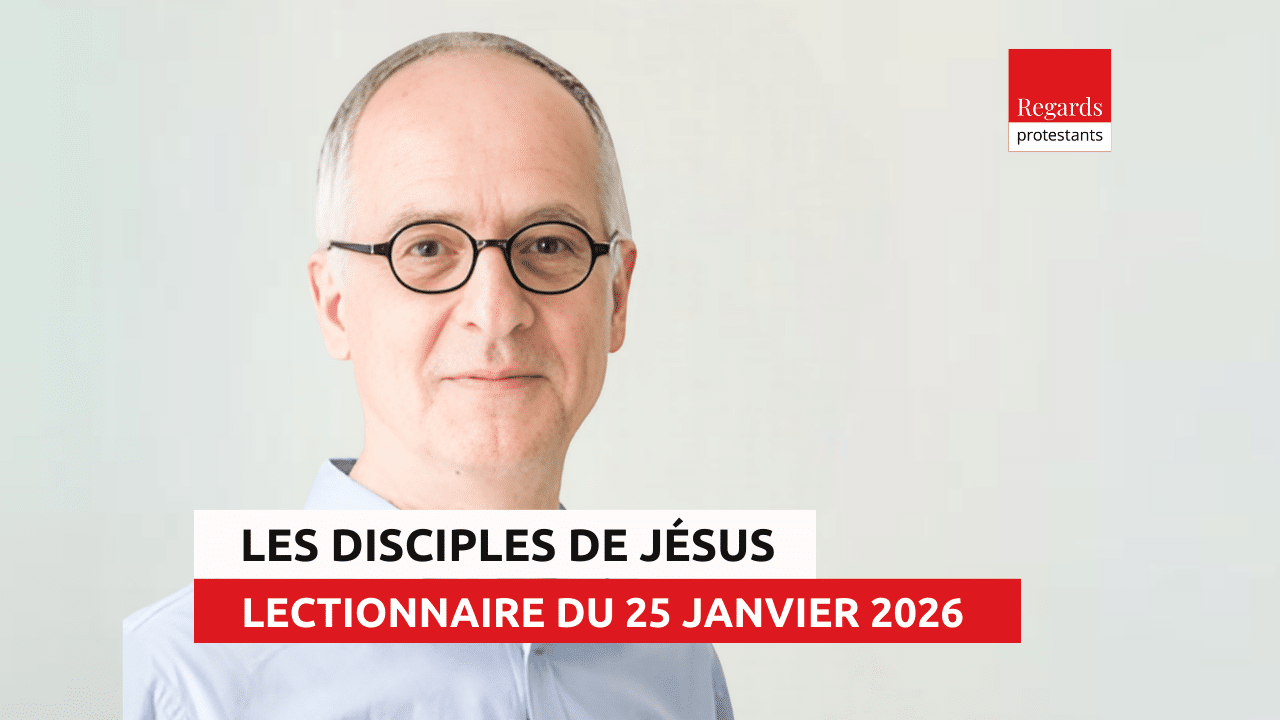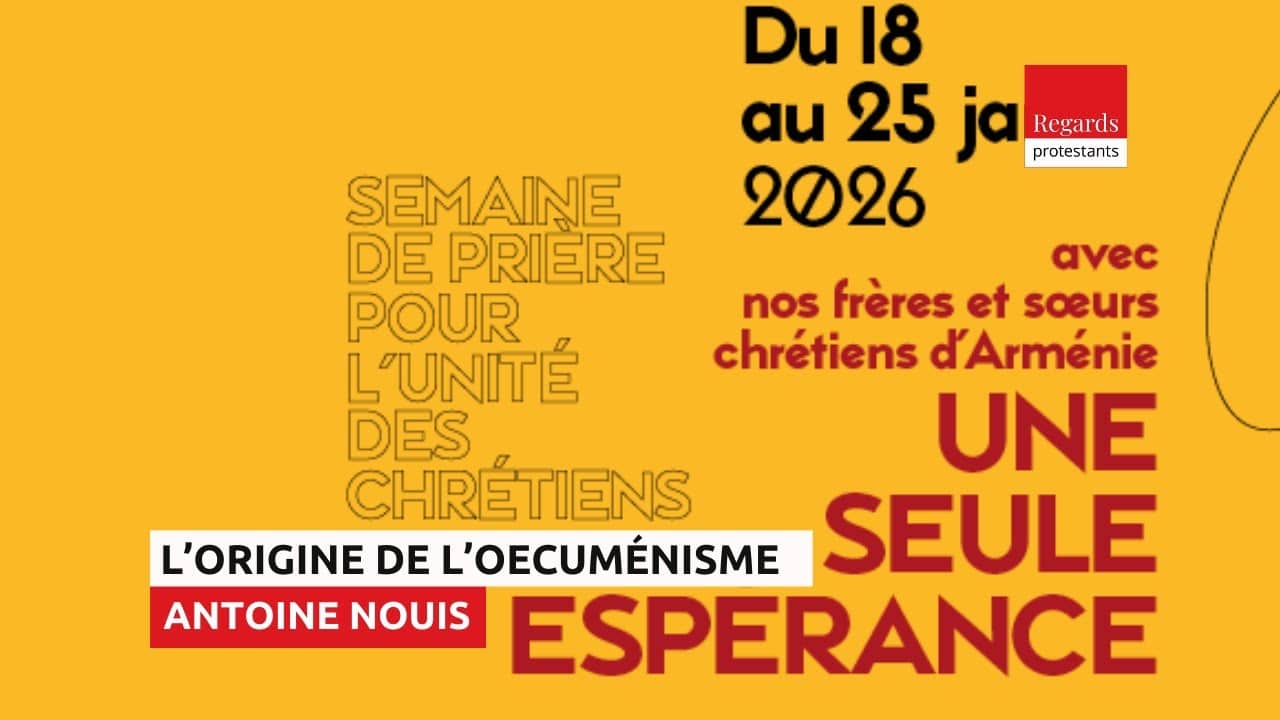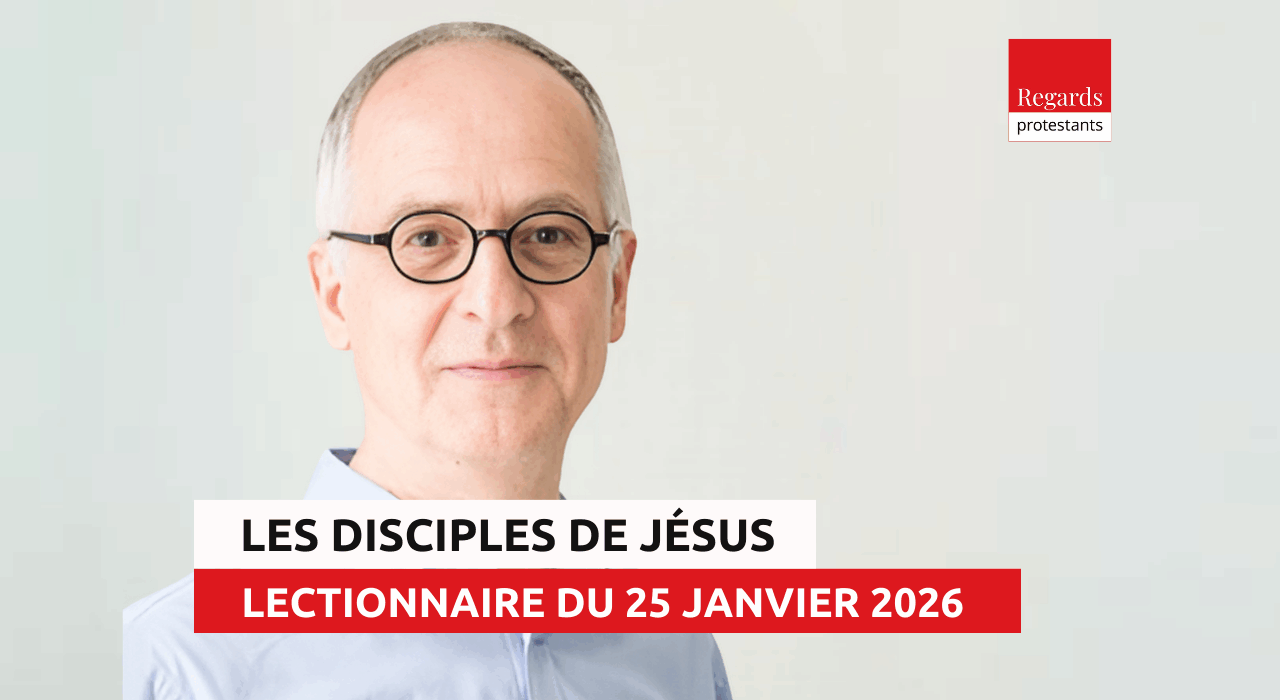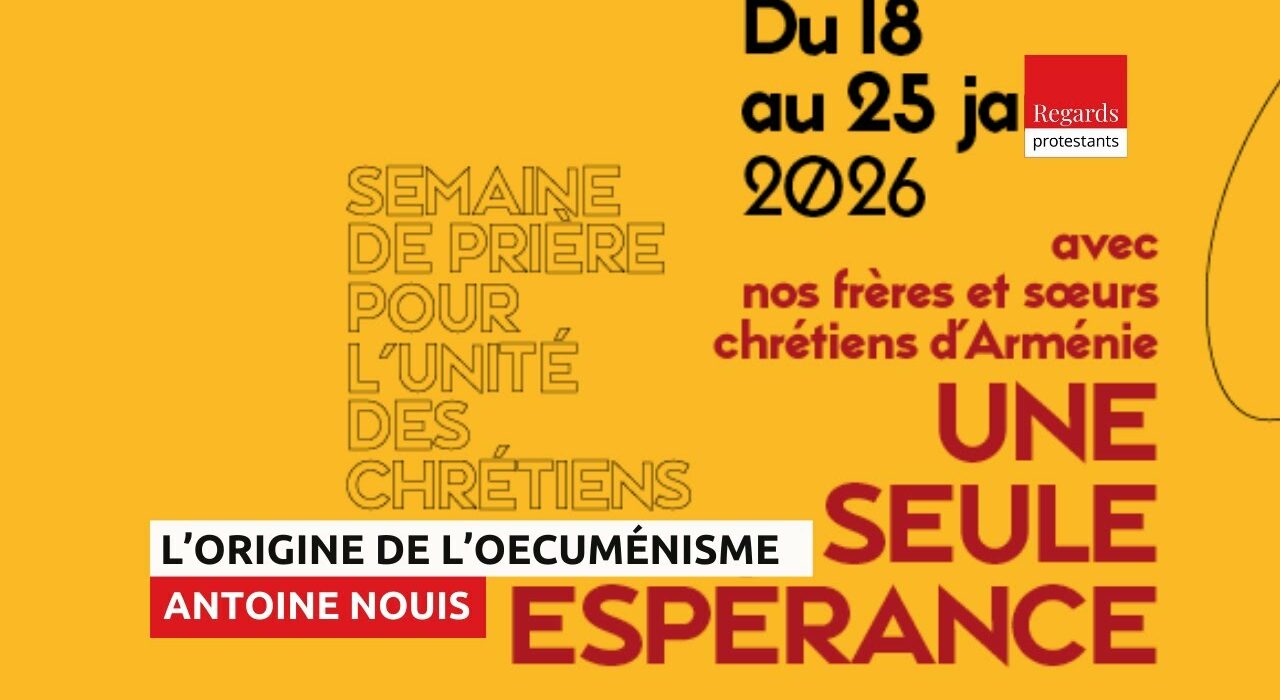L’évangile de Luc du 20 juillet (Luc 10.38-42)
En route vers Jérusalem, Jésus fait halte dans un village où il est accueilli par deux sœurs, Marthe et Marie. L’une s’agite aux fourneaux, l’autre s’assoit aux pieds du maître. La scène, simple en apparence, devient un moment de profonde remise en question des rôles traditionnels, notamment ceux assignés aux femmes.
Marthe, maîtresse de maison, s’active pour offrir à Jésus et ses disciples l’hospitalité qu’elle juge nécessaire. Mais l’attention de Jésus se porte sur Marie, assise à ses pieds, en posture de disciple, une place traditionnellement réservée aux hommes. Lorsque Marthe se plaint de ne pas être aidée, Jésus répond avec douceur mais fermeté : « Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. »
Ce passage, tiré de l’évangile de Luc, suit directement la parabole du Bon Samaritain. L’un prône l’action au service du prochain ; l’autre, l’écoute de la parole. Deux récits en tension, mais complémentaires : l’un souligne le soin, l’autre la contemplation. Ensemble, ils dessinent un équilibre entre faire et être, entre le souci de l’autre et l’attention à Dieu.
Jésus ne condamne pas Marthe pour son service, mais pour sa volonté d’imposer à Marie un rôle prédéfini. Il ne rejette pas l’utile, mais affirme que le nécessaire, l’écoute de la parole, donne sens à l’action. Ainsi, Jésus bouleverse les normes sociales et genrées, autorisant Marie à occuper une place de disciple, et à travers elle, toutes les femmes à recevoir et transmettre l’enseignement.
L’épisode, souvent interprété comme un éloge de la vie contemplative, est surtout une invitation à repenser nos priorités : l’activisme ne suffit pas sans enracinement spirituel. Les Pères du désert eux-mêmes rappelaient que l’on ne peut négliger le rôle de Marthe, mais que c’est Marie qui montre la direction.
L’épître aux Colossiens du 20 juillet (Colossiens 1.24-28)
Le mystère de l’ouverture
Le contexte – L’épître aux Colossiens
Paul, ou l’auteur de l’épître aux Colossiens si ce n’est pas Paul, écrit cette épître pour s’opposer à des judaïsants qui appelle les chrétiens de la première Église à mener une vie ascétique au nom d’une sagesse supérieure.
Pour contrer ces prédicateurs, il commence par reprendre un hymne, que nous avons médité la semaine dernière, qui souligne la grandeur du Christ qui était présent dès la fondation du monde et qui règne sur toutes choses. Cet hymne souligne que la réconciliation vient de Dieu et le verset qui suit déclare que le Christ est mort pour nous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche.
SI la réconciliation vient de Dieu, elle s’adresse à tous les humains, les juifs comme les non-juifs.
Que dit le texte ? – Le mystère de l’ouverture aux non-juifs
Paul évoque son ministère, sa vocation, qui est d’annoncer la grande nouvelle de l’ouverture du salut aux non-juifs. Cette annonce a suscité des oppositions, parfois des persécutions de la part des autorités juives comme le raconte le livre des Actes des Apôtres. Pour Paul, ses souffrances sont le prix à payer pour sa compréhension d’une Église ouverte.
Si Paul est prêt à souffrir pour porter son message, c’est parce l’ouverture aux non-juifs est un mystère. Chez Paul, un mystère n’est pas une énigme, c’est le fruit d’une révélation particulière. Quand on a résolu une énigme, elle cesse d’être énigmatique alors qu’un mystère, plus on l’approfondit, plus c’est un mystère. La grâce ou l’amour de Dieu pour tous les humains sont des mystères.
Le mystère ici est la présence du Christ dans le cœur des croyants, quelles que soient leurs origines. Cette présence est définie comme l’espérance de la gloire. Nous croyons que Christ règne. Si nous ne le voyons pas, nous l’espérons et cette assurance fonde le ministère de l’apôtre.
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – Marthe et Marie
Il est difficile de trouver un lien entre le passage de l’épître aux Colossiens et le récit du passage de Jésus chez Marthe et Marie. Nous pouvons entendre que lorsque Marie se tient aux pieds de Jésus, ce dernier lui délivre le cœur de son évangile qui est le mystère de l’amour de Dieu pour tous les humains.
Ce mystère est si grand, si important, que Marie en oublie de se préoccuper de la préparation du repas. Le mystère du règne du Christ est si fondamental qu’il devient premier par rapport à toute autre considération.
Le texte de la Genèse du 20 juillet (Genèse 18.1-10)
L’hospitalité d’Abraham
Le contexte – Le livre de la Genèse
Après les récits de création, le livre de la Genèse parle de Dieu en racontant l’histoire d’hommes et de femmes en prise avec une promesse.
Abraham est le premier à qui la promesse d’une descendance a été faite. Il est parti au nom de cette parole, mais les années ont passé et le couple est resté stérile. Pour forcer le destin, sa femme lui propose d’aller vers sa servante Hagar afin d’avoir un enfant avec elle, mais ce n’est pas lui qui est l’enfant de la promesse.
Alors qu’Abraham a 99 ans et qu’il peut considérer que la promesse était une illusion, Dieu lui propose de faire alliance et lui demande de porter le signe de cette alliance dans sa chair en étant circoncis. Il lui demande aussi de changer le nom de sa femme.
La circoncision n’a pas lieu sur le petit doigt ou le bout du nez, mais sur le sexe de l’homme. Symboliquement, elle représente le renoncement à la toute-puissance masculiniste, ce qui le conduit à changer le regard sur sa femme.
Il est maintenant prêt pour recevoir la grande annonce.
Que dit le texte ? – La visite des anges
Deux détails soulignent l’hospitalité d’Abraham.
La circoncision d’Abraham a eu lieu alors qu’il avait 99 ans et il en avait 100 à la naissance d’Isaac. Les commentaires en ont conclu qu’il était en convalescence de son opération quand il a accueilli les voyageurs qui passaient près de sa tente.
Le premier verset dit que Dieu lui apparut aux térébinthes de Mamré. Les commentaires en déduisent qu’Abraham était en conversation avec Dieu. Lorsqu’il a levé les yeux et qu’il a vu trois hommes qui passaient devant sa tente, il est alors sorti de son extase.
Abraham est en convalescence et Abraham est en prière, pourtant, dès qu’il voit les étrangers de passage, il renonce à son repos et à sa prière pour courir à leur rencontre et se prosterner devant eux afin de les supplier de s’arrêter dans sa tente. Pour lui l’hospitalité est plus importante que tout le reste.
Après avoir mangé, les étrangers se sont avérés être des anges qui ont été envoyés pour annoncer à Abraham la grande nouvelle qu’il n’attendait plus : Je reviendrai chez toi l’année prochaine ; Sara, ta femme, aura un fils.
En français le mot hôte est une énantiosémie, c’est-à-dire à dire qu’il a deux sens opposés, il désigne celui qui reçoit, mais aussi celui qui est reçu. Le miracle de l’hospitalité, c’est qu’il arrive que celui qui est accueilli devienne une grâce pour celui qui accueille.
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – Marthe et Marie
Le dialogue entre le récit d’Abraham à Mamré et de Jésus chez Marthe et Marie nous dit deux choses.
Dans le dialogue entre Abraham et les anges, Sara est absente. Le dernier verset de notre passage dit qu’elle écoutait à l’entrée de la tente. Dans le récit de Marthe et Marie, cette dernière est assise au pied du Seigneur, ce qui est l’attitude des disciples. Le message de l’Évangile s’adresse à tous les humains, les femmes aussi sont appelées à l’écoute et à devenir disciples.
Marthe et Marie représentent les deux volets de l’hospitalité : préparer à manger et écouter. Quand Jésus dit que Marie a choisi la bonne part, il souligne que d’être capable d’écouter une personne en profondeur et en vérité est parfois plus important que de lui préparer un bon repas.
Production : Fondation Bersier – Regards protestants
Intervenant : Antoine Nouis