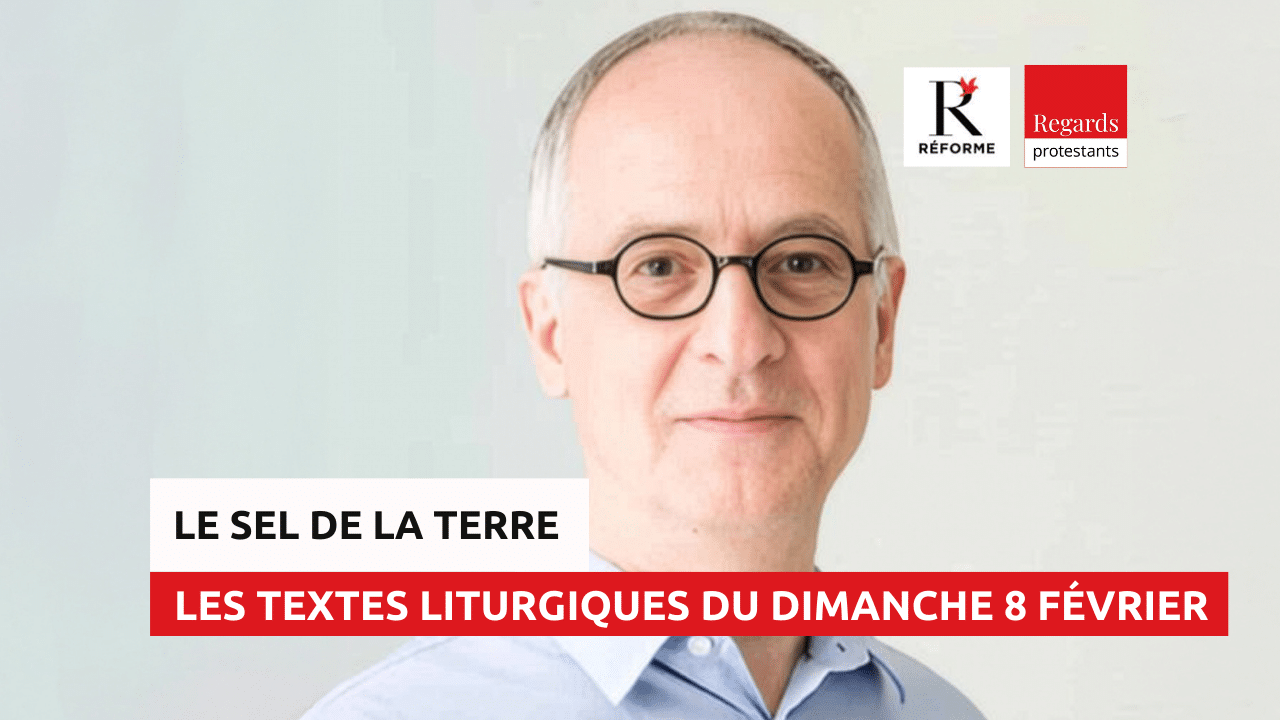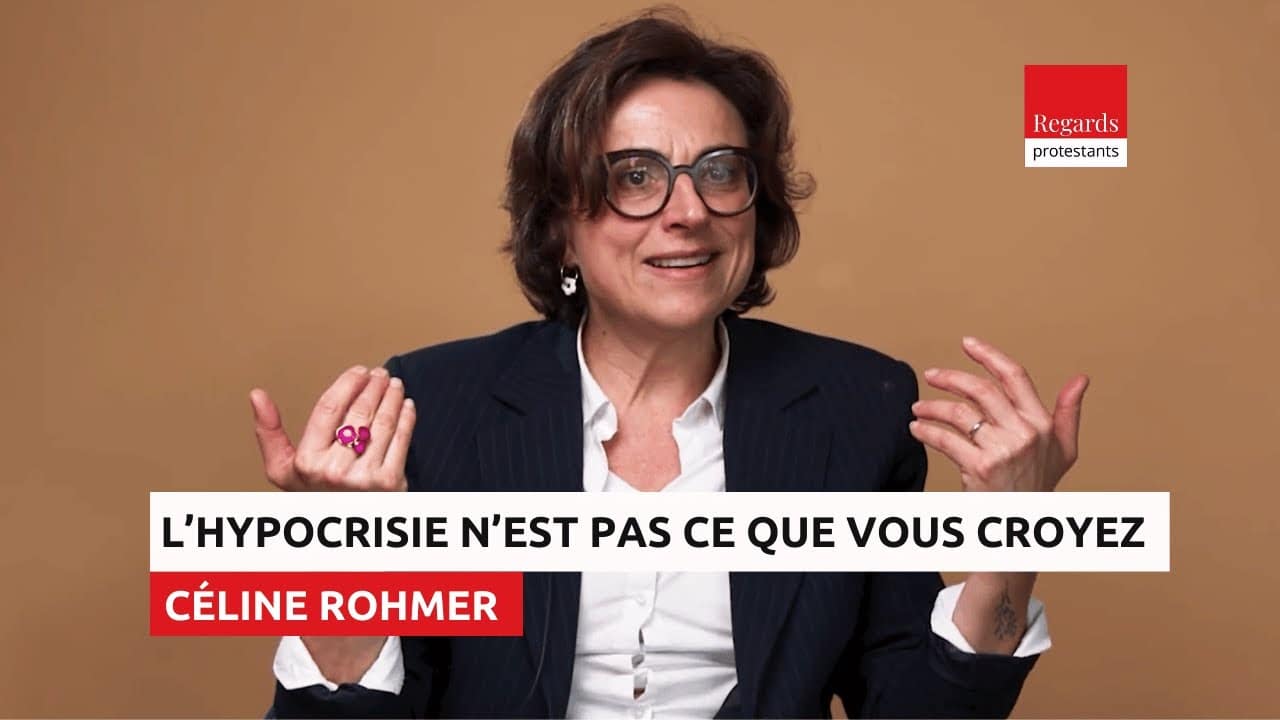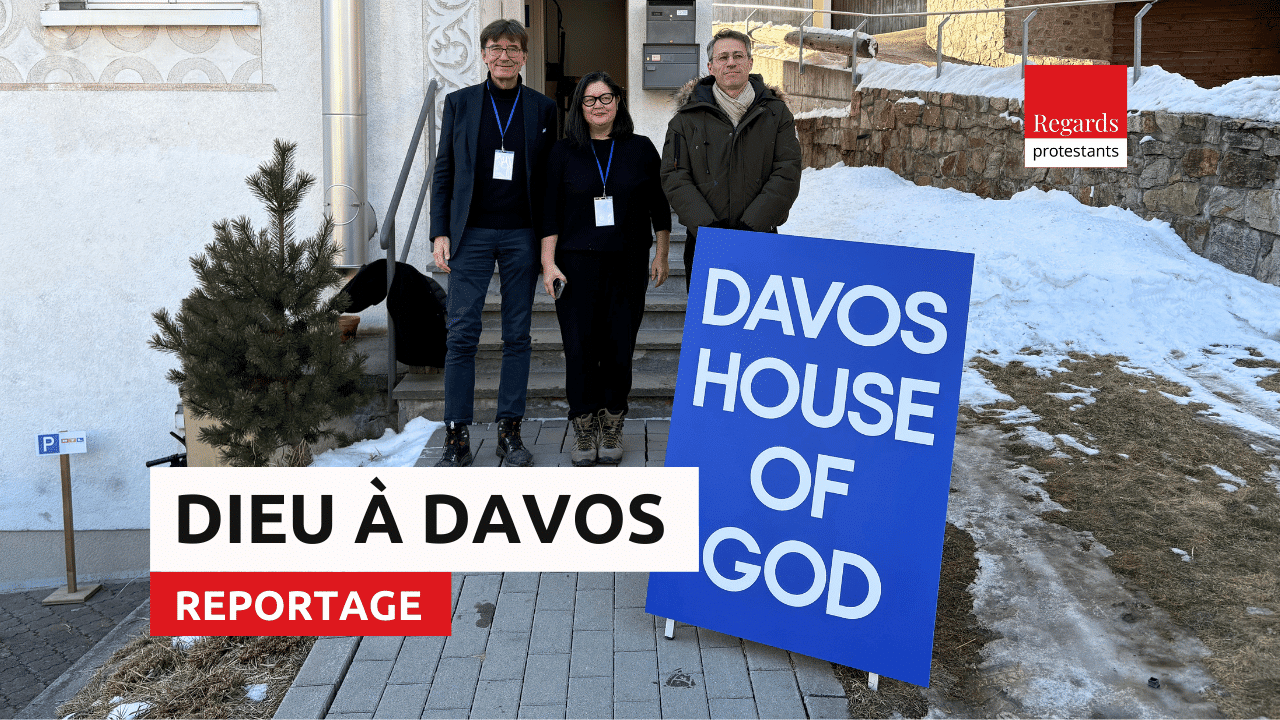L’évangile de Luc du 27 juillet (Luc 11.1-13)
La prière de Jésus, entre mystère, intimité et effronterie
La prière de Jésus reste enveloppée de mystère. On sait qu’il prie, souvent, longuement, parfois à l’écart. Mais ce qu’il dit réellement, ce qui se joue dans cet échange avec le Père, les Évangiles n’en révèlent que peu. L’épisode de Gethsémané, où Jésus s’en remet à la volonté du Père – « non pas ma volonté, mais la tienne » – en donne une clef : la prière est pour lui un ajustement de sa volonté humaine à celle de Dieu.
Jésus, en prière, s’expose. À la lumière divine, à l’appel du Père, à sa vocation. Cette disponibilité radicale est ce qui frappe les disciples, au point qu’ils lui demandent : « Apprends-nous à prier ». Et c’est là qu’il leur transmet le Notre Père.
Cette prière, commune aux Évangiles de Matthieu et de Luc, est d’une audace incroyable : appeler Dieu Abba, un mot familier, presque enfantin. Ce n’est pas « Père » au sens solennel, mais « papa » dans l’intimité du foyer. Une nouveauté radicale. L’apôtre Paul s’en émerveille dans ses lettres, rappelant que c’est l’Esprit qui nous pousse à crier Abba, à entrer dans cette relation de proximité confiante.
Les demandes du Notre Père – que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite – traduisent le désir de voir d’autres, au-delà de nous, entrer dans cette filiation. Une anecdote d’enfant catéchisé résume tout : « Que ta volonté soit fête ». Faute d’orthographe ? Peut-être. Mais magnifique raccourci spirituel.
La demande du pain quotidien rappelle aussi une réalité sociale : avoir du pain est une grâce, un privilège parfois. Il ne s’agit pas d’attendre une manne miraculeuse, mais d’exprimer ce que tout homme espère – vivre et nourrir les siens dignement.
Quant au pardon, il distingue le péché (qui concerne Dieu) de la dette (qui nous concerne, nous). On peut et on doit remettre les dettes : réparer, indemniser. Le péché, lui, ne peut être remis que par Dieu. Ce discernement est crucial, notamment à l’heure où l’Église est confrontée aux conséquences de graves abus.
Enfin, la parabole de l’ami importun enseigne une chose simple et forte : dans la prière, on peut être effronté. On n’a pas besoin d’être « bien comme il faut ». À deux heures du matin, déranger Dieu pour du pain, c’est légitime. La prière est cet espace où l’on expose tout : désirs, besoins, souffrances, sans fard. Le psaume 38 dit : « Tout mon désir est devant toi ».
Et cette prière, si sincère soit-elle, débouche sur une promesse : « Si vous, mauvais comme vous êtes, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? » La surabondance de Dieu dépasse toute mesure. C’est l’Esprit, ce don ultime, qui nous rend capables, à notre tour, d’être prodigues comme le Père.
La prière de Jésus
Introduction
Nous trouvons une autre version de la prière de Jésus dans le sermon sur la montagne de l’évangile de Matthieu. Chez Luc, Jésus n’a pas réuni ses disciples en leur disant : « Aujourd’hui, je vais vous enseigner sur un sujet important : la prière », il a répondu à une demande de ses disciples qui, en voyant Jésus prier, ont compris qu’il avait une relation singulière avec son père.
La prière, les disciples savent ce que c’est, depuis qu’ils sont tout petit on leur a appris comment on s’adresse à Dieu, et voici qu’en voyant Jésus prier, ils réalisent qu’ils ne savent pas prier, alors ils lui posent la grande question : Apprends-nous à prier.
Jésus profite de la question pour délivrer son enseignement sur la prière.
Points d’exégèse
Attention sur deux points.
Père !
La première parole de la prière est le mot Père. Les évangiles ne rapportent jamais une prière de Jésus sans qu’il appelle Dieu : Père ! (La seule exception est le cri sur la croix « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? », mais il cite le premier verset du Psaume 22.) Cette appellation ne devait pas être si fréquente puisqu’elle suscite l’étonnement et l’admiration de l’apôtre Paul (Rm 8.15, Ga 4.6). Derrière le mot Père – Paul dit Abba ! Père ! – se trouve une intimité peu courante.
C’est cette intimité qui a intrigué les disciples et qui a suscité leur question : Enseigne-nous à prier.
Que ton règne vienne !
L’évangile de Matthieu prolonge cette demande en ajoutant : Que ta volonté soit faite ! En priant cela, nous reconnaissant que son règne n’est pas là et que sa volonté n’est pas faite.
La prière se fait interpellation : Qu’est-ce que je fais pour que son règne vienne ?
La prière se fait intercession : Seigneur je te remets les blessures et les fractures de notre monde, tous ces lieux où ton règne n’est pas présent.
Pistes d’actualisation
1er thème : Le pain et le pardon
Donne-nous notre pain… pardonne-nous nos péchés. Pour vivre, nous avons besoin de pain et pour vivre nous avons besoin de pardon. Ces demandes rejoignent le verset des Psaumes qui dit : Seigneur, tout mon désir est devant toi, et mon soupir ne t’est pas caché (Ps 38.10). Prier, ce n’est pas réciter de belles paroles, prier c’est être la vérité de son intimité devant Dieu.
Si nous sommes vivants, c’est que nous avons reçu le pain et de ce jour, et si nous vivons au milieu de nos prochains, c’est que nous avons été pardonnés. La prière se fait alors reconnaissance pour le pain et le pardon.
2e thème : Les paraboles : Cherchez et vous trouverez
Luc s’adresse à un public de culture grecque, moins habitué à la prière, c’est pourquoi il ajoute à la présentation de la prière de Jésus quelques petites paraboles pour encourager ses lecteurs à la persévérance. Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira. Si l’on n’a pas encore trouvé, c’est qu’on n’a pas assez cherché, il ne faut jamais se lasser de demander, de chercher, de frapper à la porte.
Jésus enseigne à ses disciples qu’il n’y a rien de pire qu’un esprit habitué, un esprit qui a cessé de chercher soit parce qu’il pense avoir trouvé, soit parce qu’il pense qu’il n’y a rien à trouver. Prier, c’est garder vivante en nous la quête de Dieu, garder vivante la brûlure de son absence.
3e thème : La promesse d’une surabondance de l’Esprit
Aux différentes demandes de la prière, une est particulièrement précieuse, c’est celle de l’Esprit qui est associée à une belle promesse : Si… vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l’Esprit saint à ceux qui le lui demandent !
La promesse de l’Esprit, c’est la promesse d’une promesse habitée. Nous avons tous fait l’expérience de la prière sèche, dans laquelle nous avons l’impression de ne parler qu’à nous-mêmes. C’est pourquoi nous devrions commencer toutes nos prières par une invocation à l’Esprit : « Seigneur, je ne sais pas prier, je te demande ton Esprit pour que ma prière soit vivante afin de m’aider à mieux être ton enfant ! »
Une illustration
Les pères du désert ont été les premiers moines qui ont quitté la compagnie des hommes lorsque le christianisme est devenu la religion officielle de l’Empire romain. Ils se sont retirés dans des lieux désertiques afin de vivre la foi chrétienne dans toute sa radicalité. On raconte qu’un de ces pères mettait tellement de poids et d’intensité dans sa récitation du Notre Père, qu’un jour il a commencé à prononcer cette prière alors que le soleil se couchait et qu’il n’est arrivé à l’amen final que le lendemain, lorsque le soleil se levait
À nous pour qui la récitation du Notre Père ne prend pas plus d’une minute, cet apologue nous rappelle que le Notre Père est une prière bien plus riche, bien plus belle, bien plus grande que ce à quoi nous pensons lorsque nous la prions.
L’épître aux Colossiens du 27 juillet (Colossiens 2.12-14)
Une vie nouvelle par le baptême
Le contexte – L’épître aux Colossiens
Lorsque Paul ou un de ses disciples écrit à l’Église de Colosse, cette dernière est menacée par un danger de légalisme. Certaines personnes, dont nous ignorons tout, appellent les Colossiens à mener une vie ascétique au nom d’une sagesse supérieure. Paul a des propos très durs pour ses personnes en disant que, sous un couvert d’humilité et de culte des anges,ils sont gonflés de vanité par la pensée de leur chair (Col 2.18). Cela le conduit à un vibrant plaidoyer en faveur de la liberté chrétienne : Si vous êtes morts avec le Christ aux éléments du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous replacez-vous sous des prescriptions légales : « Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas… » (Col 2.20-21).
L’apôtre appelle ses interlocuteurs à construire leur foi sur la mort et la résurrection du Christ est non sur nos bonnes œuvres, pour cela il utilise l’image du baptême.
Que dit le texte ? – Vous êtes morts, vous êtes ressuscités
À la circoncision de la chair qui est une œuvre humaine, l’apôtre oppose le baptême qui est une mort (ensevelis avec lui par le baptême) et une résurrection (vous vous êtes aussi réveillés ensemble en lui). De cette image nous pouvons dire trois choses.
Les personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente, disent tous la même chose : depuis notre regard sur la vie a changé. Par analogie, on peut dire que mourir avec le Christ pour être réveillé avec lui change notre regard sur la vie, notre vie, et la mort, notre mort.
Ce qui a changé, c’est le pardon : il nous a fait grâce pour toutes nos fautes. Le pardon n’est pas une idée, c’est un acte qui a été posé. Personne ne peut rien changer au fait que par sa mort et sa résurrection le Christ nous a pardonné.
Il a enlevé l’acte d’accusation qui était rédigé contre nous. Quel est cet acte ? Nous sommes tous très fort pour faire la liste de tout ce qu’on pourrait être et que nous ne sommes pas. Paul nous libère de toutes ces attentes qui ont été clouées à la croix pour nous permettre d’être humblement ce que nous sommes.
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – la prière de Jésus
La prière de Jésus est une invitation de nous tenir devant Dieu dans toute la vérité de notre personne, avec nos attentes, nos désirs, nos peurs et nos angoisses. Si nous pouvons être ainsi devant lui, c’est parce que nous savons qu’il est un père bienveillant qui nous aime et nous écoute.
Assurés de son pardon, nous pouvons être authentiquement nous-mêmes devant Dieu et devant nos prochains.
Le texte de la Genèse du 27 juillet (Genèse 18.20-32)
L’intercession d’Abraham
Le contexte – Le livre de la Genèse
Pour nous parler de Dieu, le livre de la Genèse raconte l’histoire d’hommes en proie avec la promesse d’avoir un jour une terre et une descendance.
Le premier de ces hommes est Abraham avec qui Dieu a décidé de faire alliance. L’alliance est le mode de relation entre Dieu et le monde dans la Bible. Elle repose sur un partage des tâches entre la responsabilité des humains et celle de Dieu.
L’alliance est une exigence pour les humains, mais aussi un engagement de la part de Dieu. Dans sa sauvegarde de la création, le Seigneur a un problème : le péché de Sodome est devenu si grand que la ville ne peut survivre. Comme il a fait une alliance avec Abraham, il ne veut pas intervenir sans informer celui qui est devenu son partenaire.
Que dit le texte ? – La protestation d’Abraham
Schématiquement, les spiritualités peuvent se distinguer selon deux grandes catégories. Il y a d’abord les spiritualités de l’acceptation. Elles considèrent que nous n’avons aucune prise sur ce qui nous arrive et que la spiritualité consiste à un travail sur soi pour nous aider à accepter, et à aimer ce qui advient. Nous retrouvons cette spiritualité dans le stoïcisme, les religions orientales et l’islam.
Une seconde catégorie est la spiritualité de la parole qui consiste pour le sujet à poser sa parole face à la parole de Dieu. Si Abraham avait été un bon stoïcien, il aurait demandé au Seigneur de l’aider à supporter la destruction de Sodome, mais il n’était pas dans une spiritualité de la soumission, mais de la parole. Il n’hésite pas à opposer la justice de Dieu à Dieu lui-même en lui faisant remarquer que s’il y a cinquante justes dans la ville, il commettrait une injustice en supprimant les justes avec les injustes. Lorsque le Seigneur reconnaît la justesse du raisonnement, Abraham souligne que l’argument reste le même s’il y a quarante, trente, vingt, dix justes à Sodome. Le Seigneur promet de ne pas détruire la ville s’il y trouve dix justes.
Dans la suite de l’histoire, il ne s’est trouvé qu’un juste à Sodome, Loth, et le Seigneur lui a fait quitter la ville avant de la détruire.
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – La prière de Jésus
Nous trouvons trois points dans la prière de Jésus qui fait écho à la prière d’Abraham.
Père. Si certains passages évoquent la paternité de Dieu, jamais il n’est appelé Père. Le mot évoque une proximité, une familiarité. Dieu n’est pas une divinité lointaine à laquelle il faut se soumettre, mais un père à qui on peut tout dire.
La suite de la prière égrène plusieurs demandes : le règne, le pain, le pardon, la protection. C’est une façon de poser tout ce dont nous avons besoin devant Dieu, ce qui relève plus du dialogue que de la soumission.
Enfin la prière est suivie de plusieurs paraboles qui insistent sur la persévérance. Il ne faut jamais se lasser de lui dire ce qu’on attend, même si on lui casse les oreilles.
Production : Fondation Bersier – Regards protestants
Intervenants : Antoine Nouis, Christine Pedotti