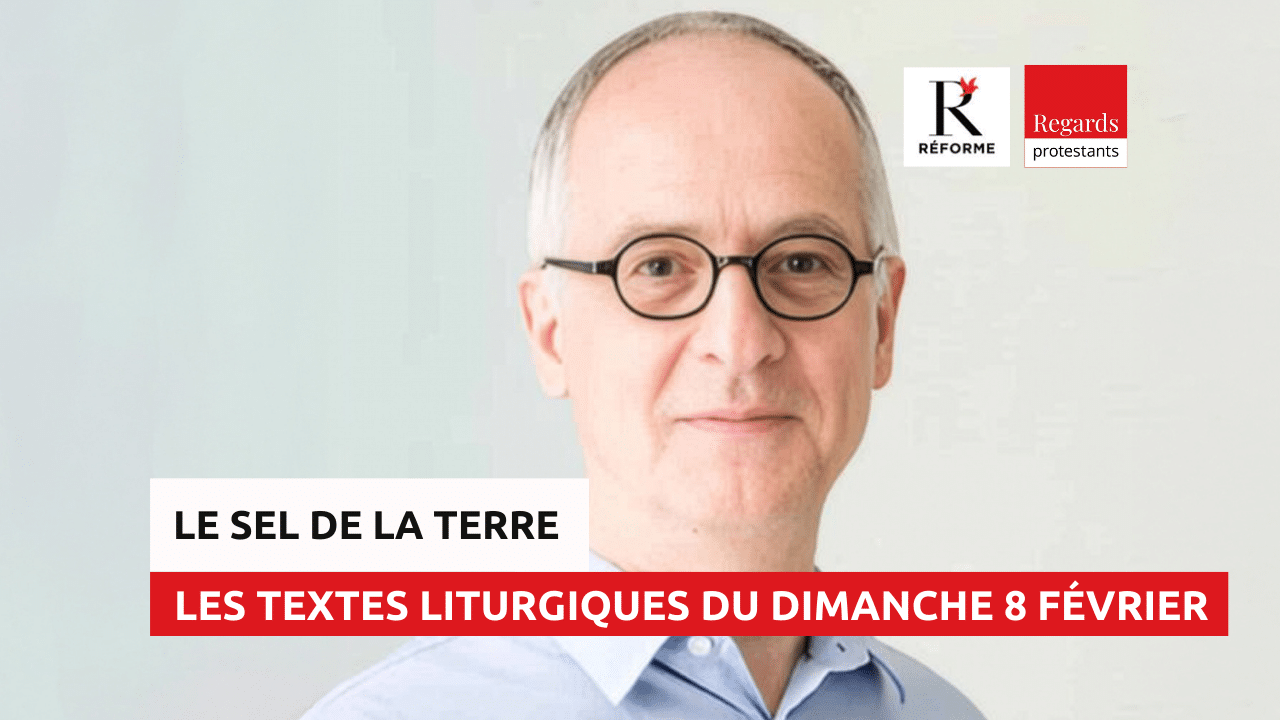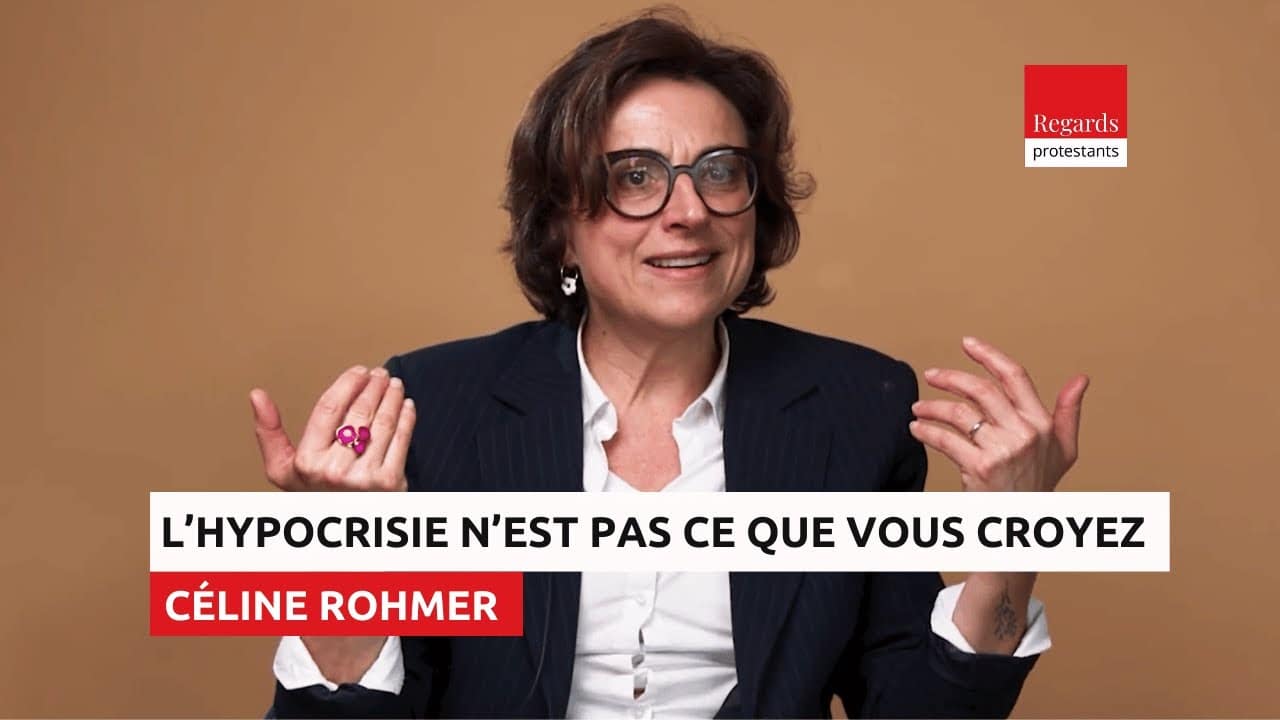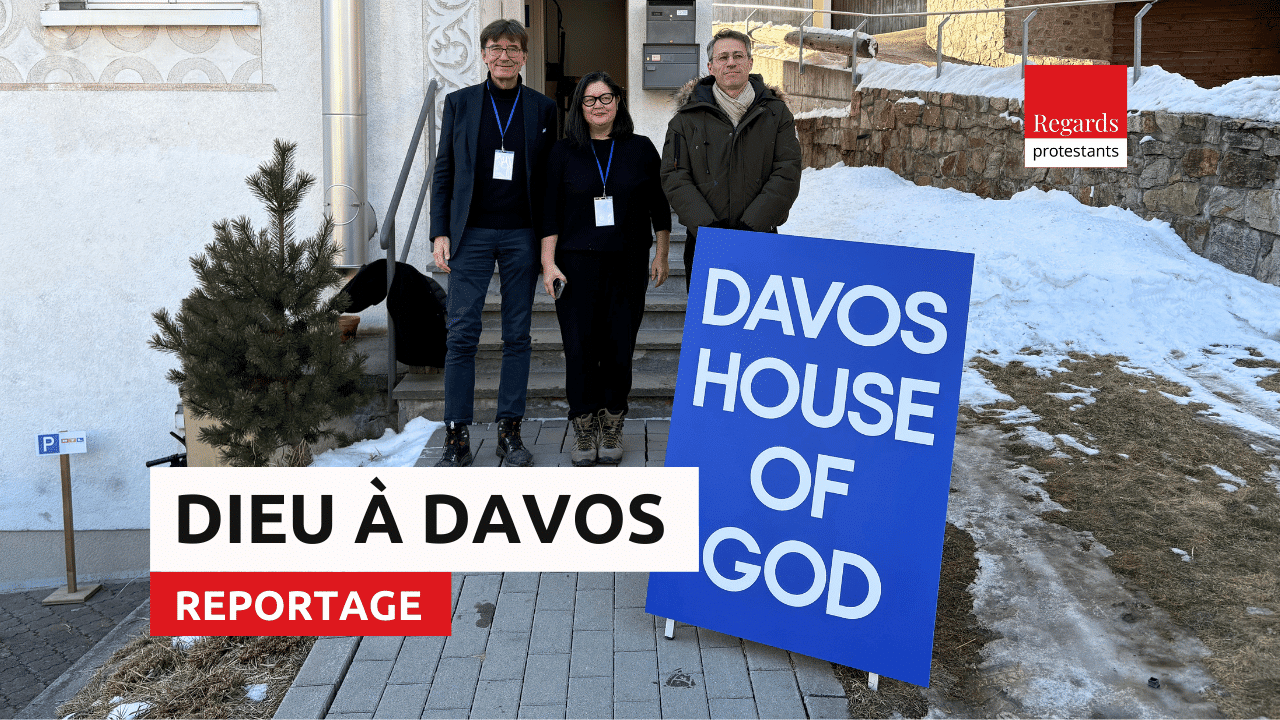L’évangile de Luc du 3 août (Luc 12.13-21)
Vraies et fausses richesses
Introduction
L’évangile de Luc est celui qui parle le plus d’argent. Lorsqu’un homme l’interpelle pour lui demander d’intervenir auprès de son frère pour partager un héritage, il renvoie le plaignant au juge pour régler la question, mais surtout il interroge son interlocuteur sur son rapport à l’argent. Que nous ayons hérité ou pas, la question s’adresse à chacun de nous.
Points d’exégèse
Attention sur deux points.
- Jésus refuse de jouer au notaire ou au juge
Lorsqu’un homme demande à Jésus d’intervenir auprès de son frère pour partager l’héritage, sa démarche est légitime sauf qu’il ne s’adresse pas à la bonne personne. Jésus n’est pas venu pour arbitrer les questions financières, non qu’il les néglige, mais il y a des juges pour cela.
À la différence de Moïse, Jésus a vécu dans un monde qui était organisé par le droit romain et les tribunaux religieux. Il n’est pas venu pour organiser la société, mais pour appeler les hommes et les femmes au changement de comportement. C’est ce qu’il fait dans ce passage en appelant son interlocuteur à s’interroger sur son rapport à l’argent.
2. Veillez à vous garder de toute avidité
Le problème de l’avidité est que c’est un puits sans fond. Quand on a dix, on veut douze, quand on a cent on veut cent vingt et quand on a mille, on veut deux mille deux cents. Lutter contre l’avidité, c’est entendre le commandement qui nous demande de ne pas convoiter en sachant rendre grâce pour ce que nous avons.
Dans le livre de la Genèse, lors des retrouvailles de Jacob et Ésaü après des années de séparation, Ésaü dit : Je suis dans l’abondance, et Jacob répond : j’ai tout ce qu’il me faut (Gn 33.9,11). Les commentaires rabbiniques ont relevé la différence entre les deux affirmations. Les deux frères sont riches mais Ésaü dit : j’ai beaucoup (sous-entendu il ne me manque que 20%), alors qu’en disant j’ai tout, Jacob affirme qu’il ne lui manque rien.
Pistes d’actualisation
L’erreur du riche
Quelle est l’erreur du riche ? Pas d’avoir de bonnes récoltes, c’est un signe de bénédiction dans le Premier Testament. Pas de vouloir se construire des granges pour recueillir ses récoltes, ne pas le faire serait un mépris des dons de Dieu. Son erreur, c’est qu’il est seul avec ses biens : Je vais démolir mes granges pour en construire de plus grandes… j’y recueillerai tout mon blé et mes biens. Et quand il parle à quelqu’un, c’est à lui-même, il dit à son âme qu’il est heureux.
L’argent isole alors que le vrai bonheur est dans la relation. La Bible nous invite à utiliser notre argent pour créer du lien.
Cette nuit même ta vie te sera redemandée
La perspective de sa mort permet de mettre nos choix et nos décisions en perspective. On raconte que le pape Innocent IX avait commandé un tableau qui le représentait sur son lit de mort et qu’il le contemplait chaque fois qu’il avait à prendre une décision importante. Cette pratique s’inscrit dans la tradition de la meditatio mortis – méditation de la mort – exercice qui consiste à se représenter sa propre mort pour nous aider à prendre conscience de la valeur du temps et pour injecter de l’ultime dans notre quotidien.
Les vraies et les fausses richesses
Ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n’est pas riche pour Dieu. L’homme qui a interpellé Jésus lui a demandé l’argent qui lui était dû. Jésus a répondu en racontant une parabole qui pose une autre question : Es-tu riche pour Dieu ? Où est notre vraie richesse ? Dans le sermon sur la montagne : Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où ni vers ni rouille ne détruisent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur (Mt 6.19-21).
Devant Dieu, les vraies richesses ne se mesurent pas en argent ou en propriété, mais en générosité, en confiance, en accueil et en simplicité.
Une illustration : Le génie libéré
Pour avoir été libéré d’une bouteille dans laquelle il était enfermé depuis l’aube des temps, un génie propose à son libérateur d’exaucer tous ses vœux. L’homme demande de vivre dans un château magnifique et d’être le seigneur d’un grand royaume, de pouvoir s’enivrer des vins les meilleurs et se rassasier des mets les plus raffinés.
Le génie lui demande s’il ne veut rien d’autre car lorsque ses vœux seront exaucés, il ne pourra revenir en arrière. L’homme demande aussi de beaux vêtements et un lit en or, les décorations les plus recherchées et les parfums les plus rares. Le génie insiste une dernière fois et l’homme pense avoir trouvé la garantie du bonheur lorsqu’il demande de ne jamais vieillir, d’être toujours en bonne santé et que les biens qu’il désire se renouvellent éternellement.
Avec un profond soupir, le génie accomplit les vœux de son libérateur qui reçoit tout ce qu’il avait demandé… Mais quand il entre dans son château, il s’aperçoit avec effroi que ce dernier est désert. Il avait simplement oublié de demander des prochains pour partager ses bénédictions. Jusqu’à la fin des temps, notre homme est comblé de richesses et condamné à la solitude jusque dans l’éternité. Et l’éternité, c’est long !
L’épître aux Colossiens du 3 août (Colossiens 3.1-5,9-11)
Devenir ce que nous sommes
Le contexte – L’épître aux Colossiens
L’authenticité paulinienne de l’épître aux Colossiens a été contestée du fait de son style et de son vocabulaire qui diffèrent légèrement des épîtres reconnues comme authentiques. Cela n’empêche qu’on y trouve les grands thèmes pauliniens que sont la déconstruction des œuvres de la loi, la vie nouvelle en Jésus-Christ du fait de sa mort et de sa résurrection et l’affirmation que l’identité du sujet ne repose pas sur son statut ni sur ses actions, mais sur la grâce signifiée par le baptême.
Que dit le texte ? – Vivre en Christ
Les versets 1 à 5 ont déjà été médités le dimanche de Pâques avec cette invitation à rechercher les choses d’en haut car notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. C’est dans ce caché que se situe l’essentiel de notre vie.
Dans les versets 9 à 11, il poursuit son raisonnement en développant trois idées.
Ne vous mentez pas les uns aux autres, vous vous êtes dépouillés de l’homme ancien. Se mentir ici, c’est jouer un rôle social, essayer de paraître, de briller devant les autres. L’épître appelle à une lucidité radicale sur notre personne : si nous sommes ce que nous sommes, notre identité ne vient pas de nous, mais du Christ.
Vous avez revêtu le nouveau… selon l’image de celui qui l’a créé. Au premier chapitre de l’épître, il est dit que par le Christ nous sommes devant Dieu saints, sans défaut et sans reproche (1.22), il nous reste à devenir ce que nous sommes, à nous conformer à cette image de Dieu que nous portons tous.
Il n’y a là ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni homme libre ; mais le Christ est tout et en tous. Lorsqu’on revêt le nouveau, les identités raciales, religieuses, culturelles et sociales deviennent secondes. Elles ne sont pas abolies mais relativisées. Il y a l’homme extérieur que je suis : un français, pasteur, père de famille, théologien… puis l’homme nouveau, caché en Christ : enfant du père, créé à l’image de Dieu, vivant de la grâce, appelé à la résurrection.
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – La parabole du riche insensé
La parabole du riche insensé pose la question de notre identité. Le propriétaire de la parabole se présente comme un homme riche qui a fait de belles récoltes, qui se construit des greniers, qui souhaite profiter de sa fortune et faire la fête, mais cette identité s’effondre le jour où il doit mourir.
La vraie richesse ne repose pas sur le statut, les biens ni la reconnaissance des autres, mais sur notre être intérieur qui est invité à se renouveler à l’image du regard que Dieu porte sur nous.
Le texte de l’Ecclésiaste du 3 août (Ecclésiaste 1.2,2.21-23)
Le travail, une futilité ?
Le contexte – Le livre de Qohéleth
Dans le premier verset, le livre de Qohéleth est attribué au fils de David qui est Salomon. Le Premier Testament l’a considéré comme un maître de sagesse parce qu’il a eu l’intelligence de la demander à Dieu plutôt que le pouvoir ou la richesse (1 R 3.9).
Si elle est douteuse d’un point de vue historique, l’attribution du livre à Salomon donne de l’autorité aux propos d’un ouvrage qui se présente comme une méditation sur les attentes et les plaisirs de la vie. Salomon est présenté dans le premier livre des Rois comme le plus sage, le plus riche et le plus séduisant des hommes. Quand Qohéleth parle de la futilité de la connaissance, du pouvoir, des plaisirs de la table et des femmes, il ne le fait pas comme un homme frustré, mais comme un roi qui a connu toutes ces satisfactions.
La méditation de Qohéleth est une déconstruction radicale de ce qui fait courir les hommes. De tout ce que les humains recherchent, il ne cesse de répéter que ce n’est que futilité complète et poursuite du vent. Une fois que toutes les illusions humaines ont été déconstruites, il ne reste plus que la grâce d’accueillir les bonheurs simples de la vie.
Que dit le texte ? – La déconstruction du travail
Ces quelques versets sur la déconstruction du travail qui est aussi une futilité sont une contestation frontale de l’éthique du travail de la société et d’une certaine forme de protestantisme. En régime libéral, le travail est valorisé et c’est par lui qu’on peut se hisser dans l’échelle sociale pour atteindre la réussite et le bonheur qui lui est associé.
Qohéleth répond que c’est une futilité car il arrive qu’on ait travaillé et perdu tout ce qu’on avait gagné. En outre la richesse procure des satisfactions, mais aussi des soucis selon l’adage qui dit que l’argent ne fait pas le bonheur. Ces propos sont difficiles à entendre, mais ils doivent être écoutés pour nous conduire à reconsidérer notre rapport au travail et à l’argent avec une lucidité radicale.
Dans une lecture chrétienne du livre de Qohéleth, nous devons l’articuler avec la grâce. Quand tout est déconstruit, il reste encore l’amour de Dieu selon cet aphorisme du théologien Jürgen Moltmann : « : « “Tout est pour rien“ dit le nihiliste et il est désespéré. “Tout est vraiment pour rien“ dit la foi et elle se réjouit de la grâce qui existe pour rien. »
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – La parabole du riche insensé
Pour nous aider à ce travail de déconstruction radicale, Jésus raconte l’histoire d’un riche qui a accumulé beaucoup de biens mais qui apprend qu’il va mourir et qu’il va tout perdre selon le proverbe qui dit que les linceuls n’ont pas de poche.
Pour nous aider à ce travail de relativisation de notre rapport au travail, la parabole de l’Évangile nous invite à nous projeter sur notre lit de mort et à nous interroger sur le regard que nous porterions alors sur notre existence.
Une infirmière qui travaillait en soins palliatifs a dit que dans son dialogue avec les personnes en fin de vie, elle exprimait 5 regrets :
- Je regrette de ne pas avoir eu le courage de vivre ma vraie vie et non pas celle que les autres voulaient pour moi.
- Je regrette d’avoir consacré trop de temps à mon travail.
- Je regrette de ne pas avoir plus exprimé mes sentiments.
- Je regrette de ne pas être resté en contact avec mes amis.
- Je regrette de ne pas m’être autorisé à être plus heureux.
Qohéleth n’aurait pas dit autre chose.
Ce travail n’a pas pour objectif de nous faire peur car nous savons que le Christ a vaincu la mort, mais de reconsidérer nos choix et nos modes de vie à partir de l’essentiel.
Production : Fondation Bersier – Regards protestants
Intervenant : Antoine Nouis