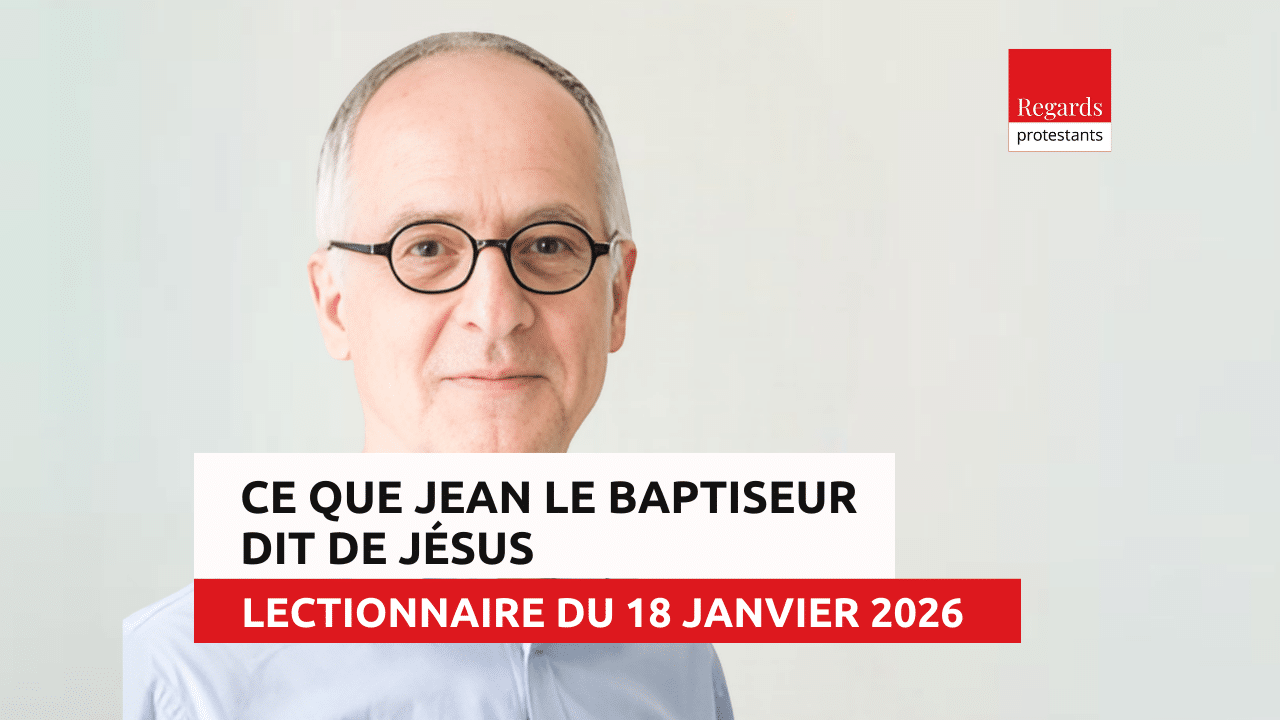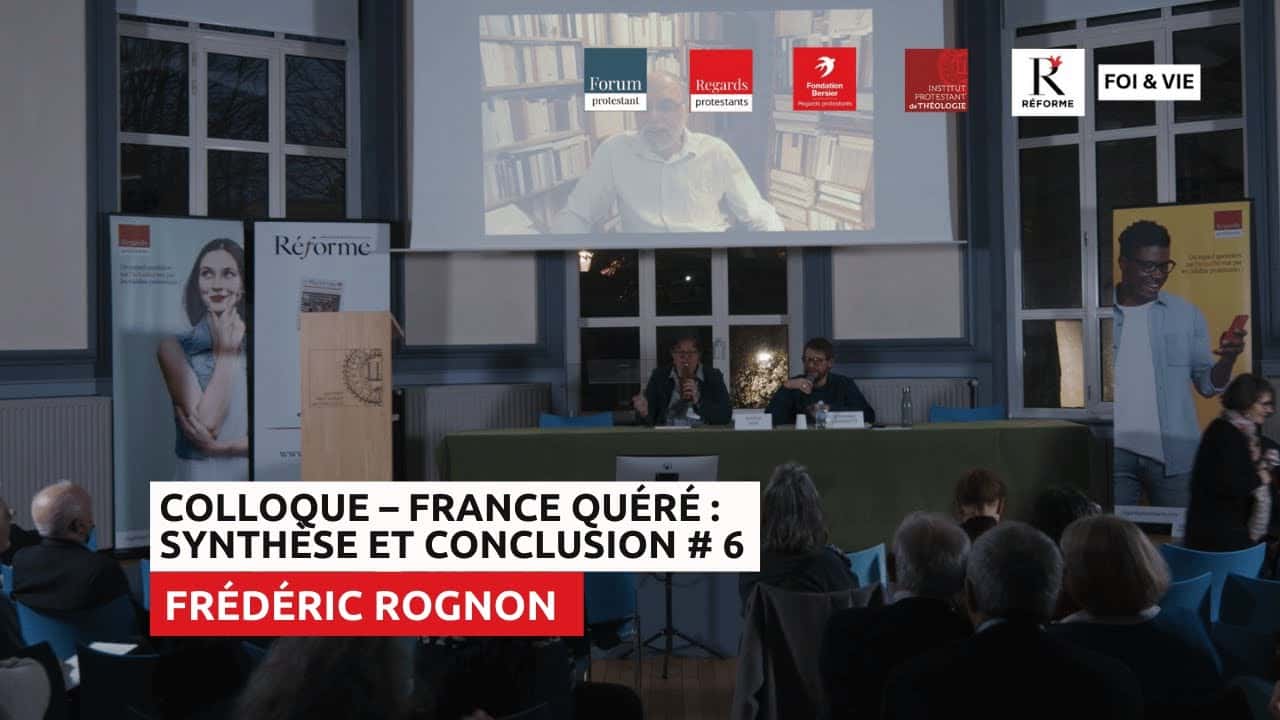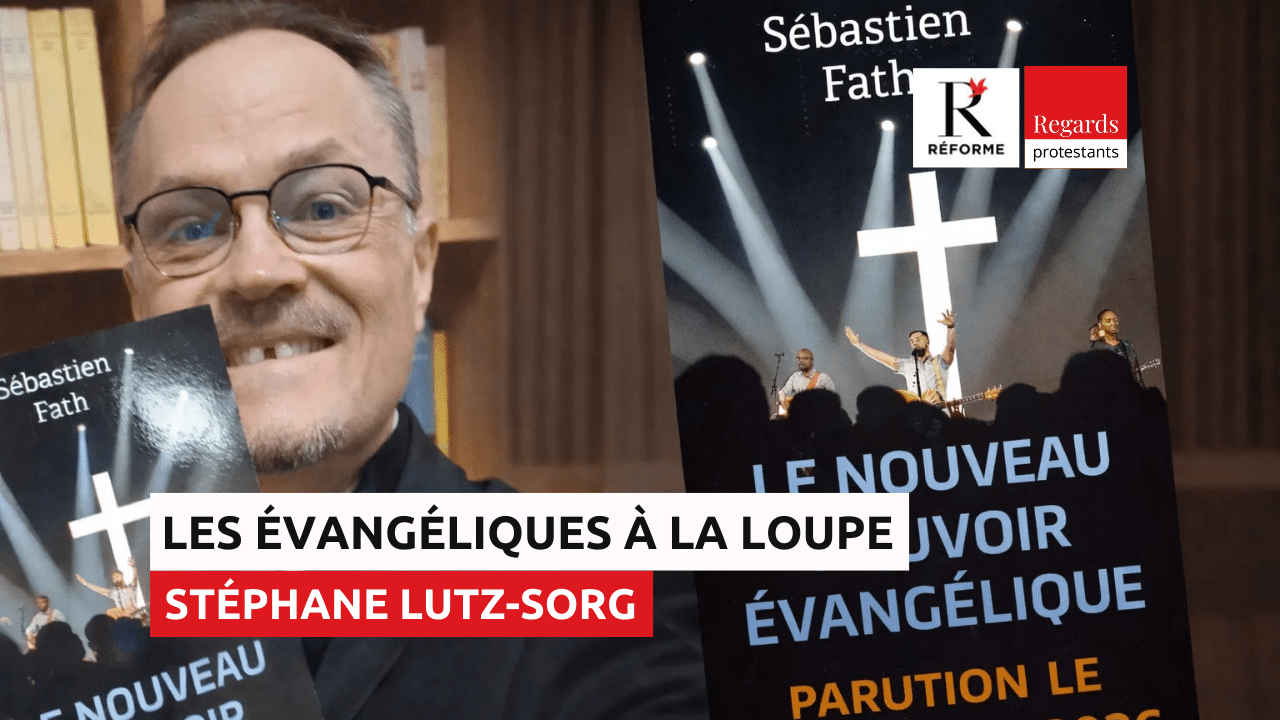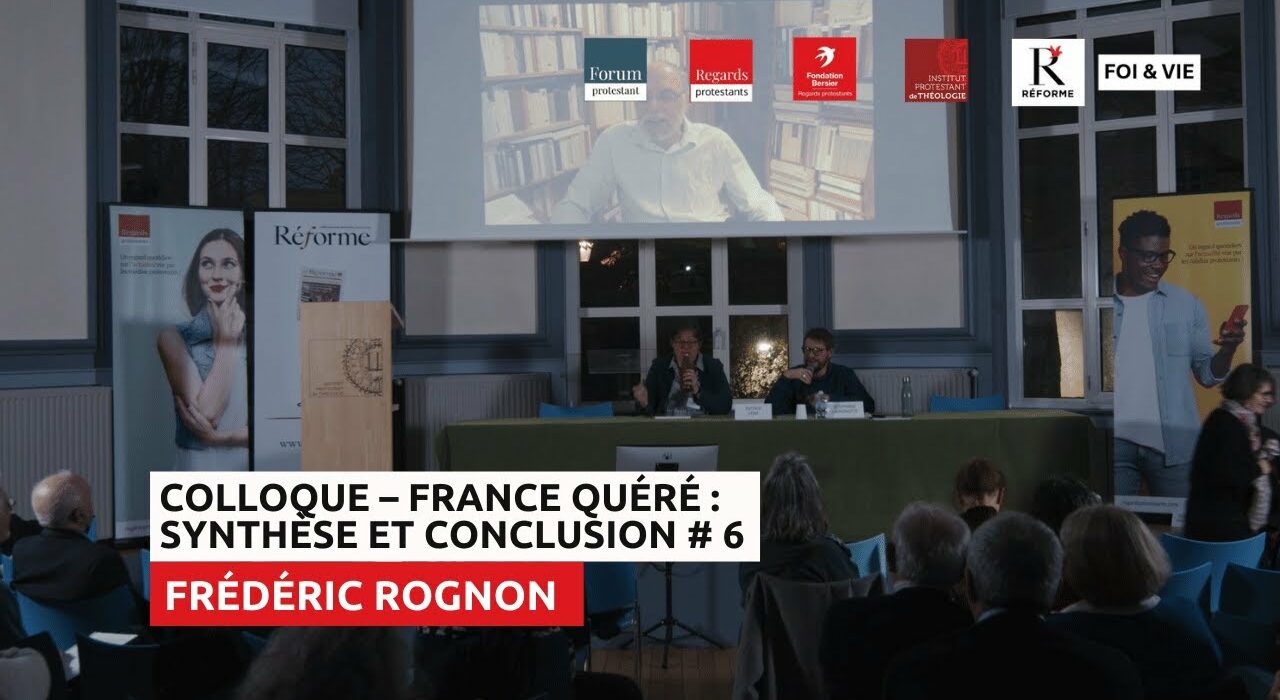L’évangile de Luc du 16 février (Luc 6, 17.20-26)
Le premier épître aux Corinthiens du 16 février (1 Corinthiens 15.12-20)
L’espérance de la résurrection
Le contexte : La première épître aux Corinthiens
Paul est le fondateur de l’Église de Corinthe et on sent qu’il a un attachement particulier pour cette communauté à qui il écrit une lettre pour répondre à des questions qui lui ont été posées, notamment sur la résurrection.
Pour aborder cette question, Paul commence par raconter la résurrection du Christ en énumérant les personnes à qui il est apparu. Il précise que certains sont encore vivants et qu’on donc les questionner. Ensuite, il montre que la résurrection du Christ induit notre propre résurrection.
Que dit le texte : Le Christ comme prémices
Le dernier verset de notre passage dit que le Christ est les prémices de ceux qui sont morts. Le terme de prémices est important dans le Premier Testament. Il évoque l’offrande de la première partie d’une récolte comme marque de reconnaissance et confession que toute la récolte est considérée comme un don de Dieu. Dire que dans sa résurrection le Christ est les prémices est une façon de dire qu’elle nous ouvre à une réalité nouvelle.
La résurrection du Christ n’est pas un super miracle pour nous prouver qu’il est plus fort que tout, c’est une victoire sur l’emprise de la mort qui a perdu son pouvoir.
Notre humanité est marquée par son rapport à la mort et ce rapport peut nous paralyser. Par sa résurrection, le texte dit que la mort a été vaincue, ce qui nous libère de la peur et de l’emprise qu’elle exerce sur nous. Comme le dit l’épître aux Romains, si Christ est mort et qu’il est ressuscité, rien ne pour nous séparer de l’amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur (Rm 8.39).
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – Les béatitudes de Luc
Notre humanité est marquée par sa quête de richesse, de plaisirs et de reconnaissance. Face à cette quête, les béatitudes proposent un contre programme qui consiste à accueillir notre pauvreté, à partager nos larmes et à ne pas craindre le rejet de nos contemporains. Ce contre programme trouve un sommet dans la dernière affirmation de Jésus qui déclare : Heureux êtes-vous lorsque les gens vous détestent, lorsqu’ils vous excluent, vous insultent et rejettent votre nom comme infâme, à cause du Fils de l’homme. Comment être heureux dans le rejet ? Parce que nous savons que nous sommes habités par une vie plus grande que ce que nos yeux voient et nos sens perçoivent. La perspective de notre résurrection est une puissance de vie qui nous permet de réorganiser nos existences en fonction de l’Évangile.
Le livre de Jérémie du 16 février (Jérémie 17. 5-6)
Le bon et le mauvais chemin
Le contexte – Jérémie
Jérémie est un prophète tragique puisqu’il doit parler au nom de Dieu pendant le siège de Jérusalem qui va se terminer par la prise de la ville, la destruction du temple et la déportation d’une partie de la population à Babylone.
Pour faire entendre son message, il va habiter sa parole en posant des signes du malheur qu’il est chargé d’annoncer. Il porte autour des reins une ceinture qu’il a fait pourrir dans l’eau de l’Euphrate pour signifier l’état du peuple, il casse une cruche publiquement pour annoncer la chute de Jérusalem (19.1-15), il se promène dans Jérusalem en portant un joug de fer qui représente l’oppression des Chaldéens. Il va payer ses provocations en étant accusé de trahison, il est frappé et enfermé dans une prison, puis jeté dans une citerne pleine de boue.
Que dit le texte ? – les deux voies
Notre récit joue sur l’opposition entre deux voies : celui qui met sa confiance dans un être humain et celui qui met sa confiance dans le Seigneur. Le premier demeure dans des lieux brûlés du désert alors que le second est sans inquiétude et ne cesse de porter du fruit.
Celui qui met sa confiance dans les humains est une référence aux rois de Jérusalem qui ont cherché des alliances avec leurs grands voisins – tantôt l’Égypte et tantôt l’Assyrie – pour assurer leur sécurité. Ça leur a coûté très cher et ça n’a pas été efficace (2 R 16.7, 18.21, Es 30.1-3). Plutôt que de faire confiance à la diplomatie en cherchant des protecteurs, les rois auraient mieux fait de cultiver leur fidélité.
Celui qui met sa confiance dans le Seigneur est béni. Le texte ne dit qu’il ne connaît pas des périodes de sécheresse, mais qu’il les traverse dans la paix et la confiance. Même quand sa fidélité est à l’épreuve, il ne cesse de porter du fruit.
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – Les béatitudes de Luc
Le sermon dans la plaine de l’évangile de Luc joue aussi sur l’opposition entre deux voies : heureux les pauvres… heureux ceux qui ont faim… malheureux les riches… malheureux ceux qui sont rassasiés.
Les béatitudes nous placent devant un choix. Le vrai bonheur ne consiste pas à courir derrière les satisfactions de ce monde (l’argent, la consommation, la reconnaissance) mais à vivre l’Évangile, même quand cela nous appauvrit, nous fait pleurer sur la situation de notre monde et nous conduit à être rejetés.
La promesse des béatitudes est qu’il y a une joie paradoxale à accueillir quand on vit selon les promesses de l’Évangile, même quand notre fidélité est douloureuse.
Production : Fondation Bersier – Regards protestants
Intervenants : Christine Pedotti, Antoine Nouis