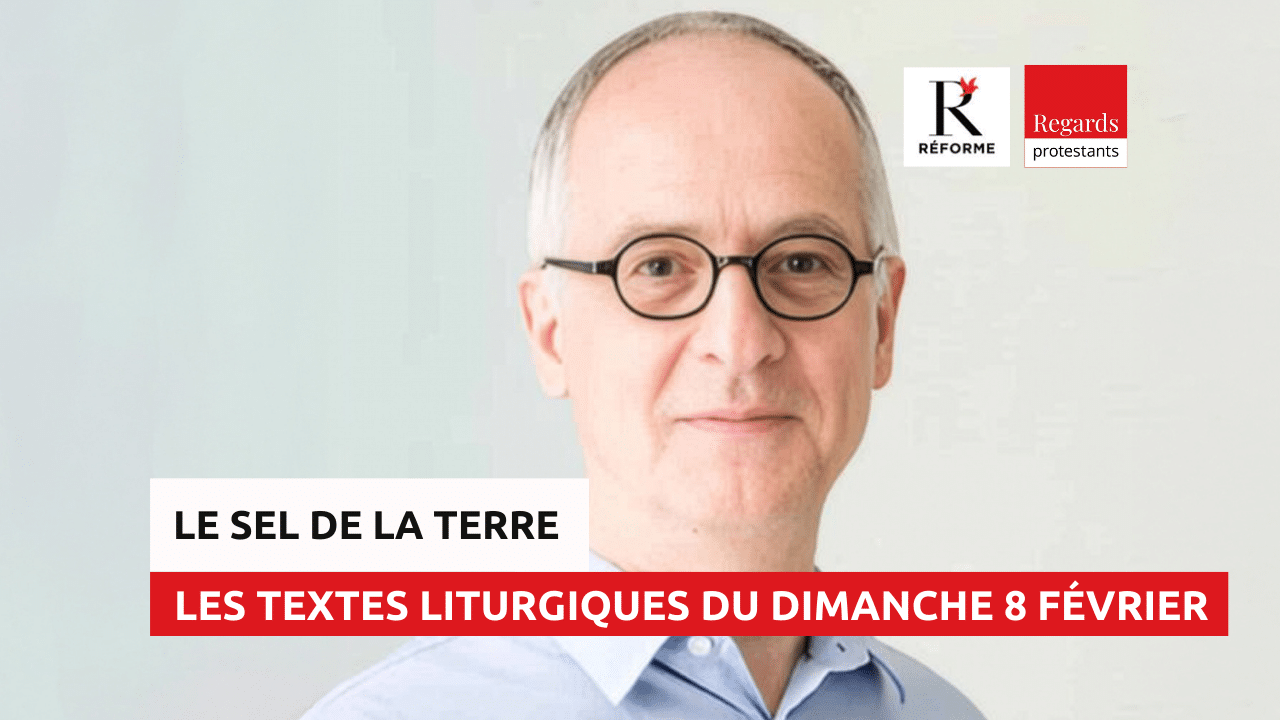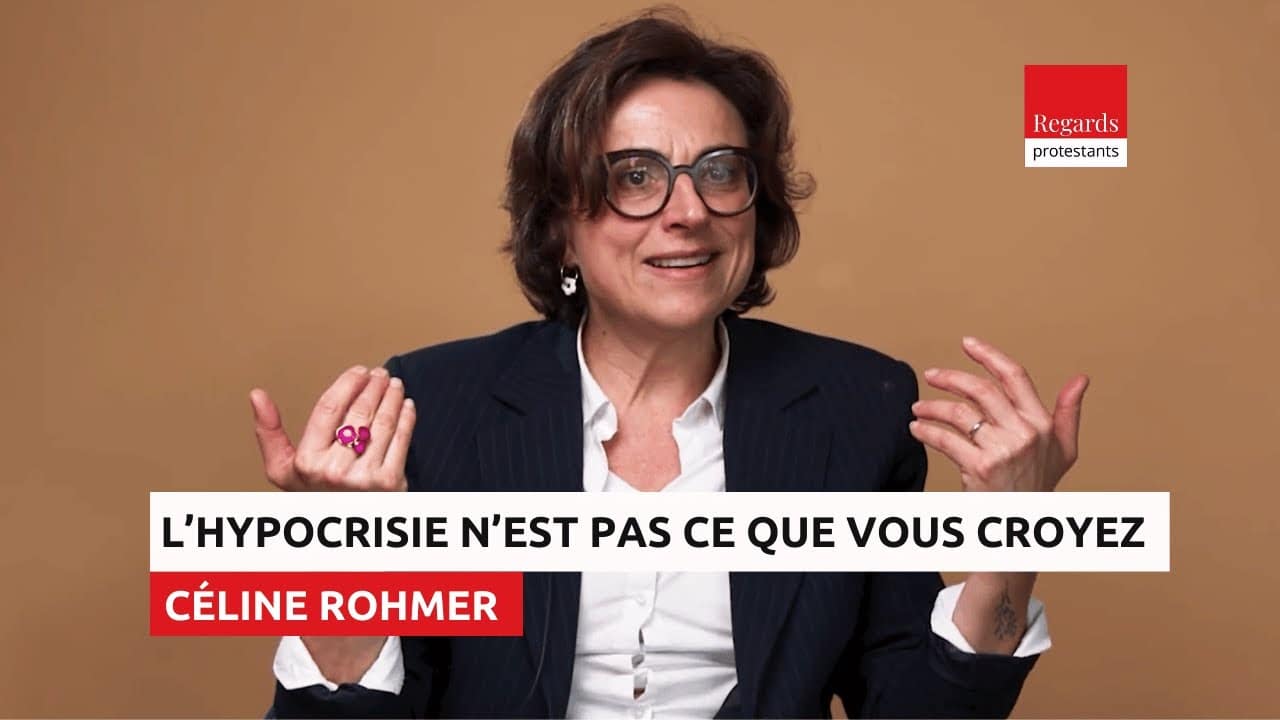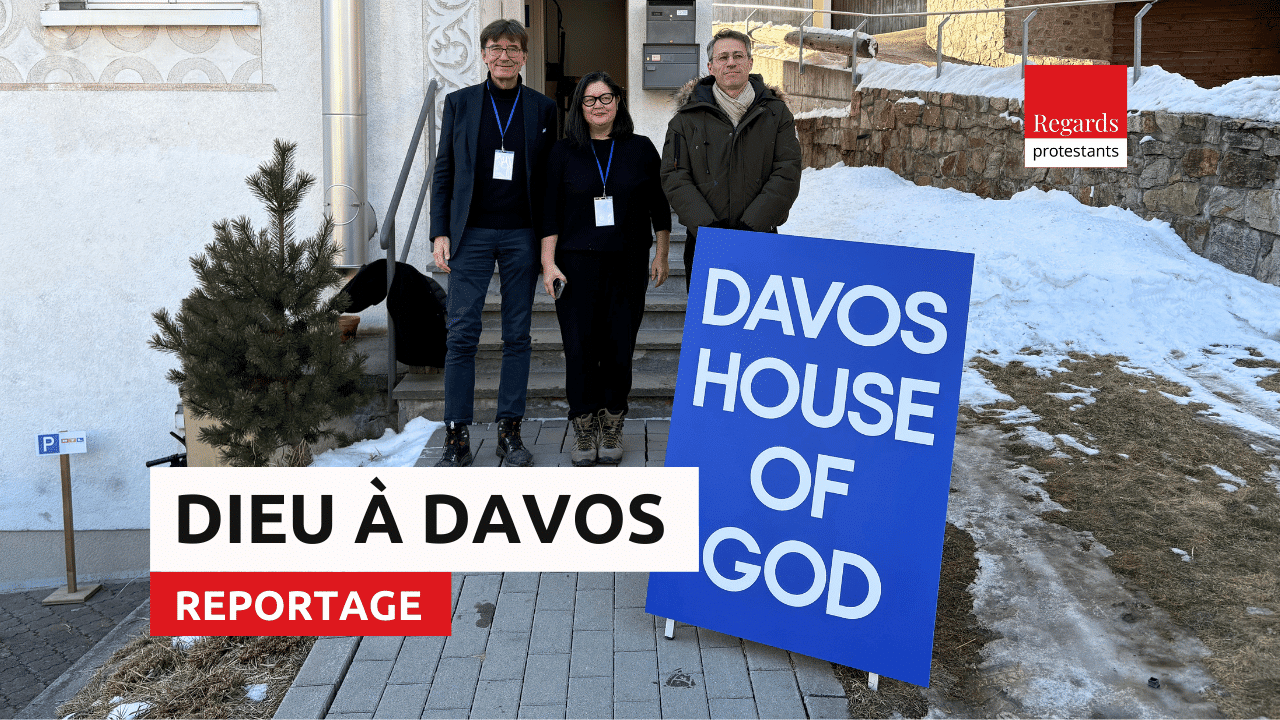L’évangile de Luc du 23 février (Luc 6. 27-38)
L’éthique paradoxale de l’Évangile
Introduction
Ces quelques versets développent une éthique de la non-violente. Martin Luther King a dit : « C’est sur la non-violence que nous serons jugés. L’homme fort est celui qui est capable de se dresser pour la défense de ses droits sans rendre les coups. » Nous trouvons ici le programme de l’homme fort. Même si nous n’avons pas cette force, nous devons la considérer comme un objectif à atteindre.
Points d’exégèse
Attention sur deux points.
Titre : La règle d’or
Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Ce verset évoque ce qu’on appelle la règle d’or qui repose sur un principe universel de réciprocité, si bien qu’on la trouve dans de nombreuses écoles de sagesse. La sagesse de l’Évangile s’inscrit donc dans la sagesse universelle ce qui est un point sur lequel on peut entrer en dialogue avec les autres religions et les autres traditions de sagesse.
Généralement cette règle est formulée de façon négative : « Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu’il te fasse… », alors que Jésus la formule positivement : « Fais à ton prochain ce que tu voudrais qu’il fasse pour toi. » C’est la différence entre une morale passive : « Ne fais pas le mal », et active : « Fais le bien. »
Telle qu’elle est formulée par Jésus, elle nous invite à interroger nos désirs et à les exaucer pour notre prochain. Tu veux être aimé, aime ; tu veux être écouté, écoute ; tu veux être honoré, honore ; tu veux être aidé, aide ton prochain. Finalement elle rejoint le grand commandement : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Titre : le plus de la foi
Un verset désarmant est celui qui dit : Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs eux-mêmes en font autant. Si c’est pour aimer ceux qui nous aiment et faire du bien à ceux qui nous font du bien, nous n’avons pas besoin de l’évangile, les pécheurs eux-mêmes en font autant.
L’évangile n’est pas un petit vernis de spiritualité qui viendrait apaiser notre âme inquiétée, c’est une conversion de notre vie, un changement radical pour reprendre les termes de la prédication de Jésus. Ce changement s’applique à nos relations avec ceux qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui nous font du bien et ceux qui nous font du mal.
C’est ce que nous allons voir dans les pistes de prédication. Pour cela, j’ai choisi trois versets.
Pistes d’actualisation
1er thème : Aimez vos ennemis
La parole qui nous appelle à aimer nos ennemis est un oxymore, une contradiction dans les termes : si c’est mon ennemi, je ne l’aime pas et si je l’aime, ce n’est plus mon ennemi. Peut-être est-ce là le but de cet aphorisme : de faire de mon ennemi un ami.
Le commandement d’amour ne dépend pas des personnes que nous sommes appelés à aimer, il est. Comme le dit Paul dans son hymne à l’amour : Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout.
Ce commandement fait changer notre compréhension de l’amour. Il ne s’agit pas d’avoir un élan de sympathie car on n’a aucune sympathie pour nos ennemis, l’amour est ce que nous entreprenons pour aider nos ennemis à grandir. Aimer son ennemi, c’est l’élever jusqu’au moment où, peut-être, il ne sera plus notre ennemi.
2e thème : Bénissez ceux qui vous maudissent
Si je ne peux trouver mon ennemi sympathique, je peux toujours le bénir et prier pour lui. La prière et la bénédiction ne sont pas des questions de sentiment, mais de volonté.
Jim Wallis qui est responsable d’un mouvement pacifiste chrétien a dit à propos de la prière pour les ennemis : « La prière est une nécessité. Sans elle nous ne considérons que notre propre point de vue, notre propre justice et nous ignorons la perspective de nos ennemis. La prière renverse ces distinctions… elle transforme les ennemis en amis. Quand nous avons porté nos ennemis dans la prière, il devient difficile de maintenir l’hostilité préalable à la violence. En les approchant de nous, la prière nous protège de nos ennemis. Ainsi la prière s’oppose à la propagande de ceux qui nous invitent à haïr et à craindre nos ennemis. »
3e thème : À celui qui te frappe sur la joue droite, tends la gauche
Pour frapper un homme sur la joue droite, il faut le faire du revers de la main, ce qui est une forme d’humiliation. En lui tendant l’autre, on refuse l’attitude victime et on invite l’autre à comprendre que sa violence le mène dans une impasse.
Le mot important de ce verset est autre. Comme pour la loi du talion, on n’est pas obligé d’interpréter ce verset à la lettre, mais d’entendre ce à quoi il nous invite. Lorsqu’on nous frappe, notre réaction première est de répondre à la violence par la violence. Le disciple doit chercher une autre réponse que celle de la violence.
Paul a résumé les différentes recommandations de ce sermon dans le verset qui dit : Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien (Rm 12.21).
Une illustration
Martin Luther King a été un des grands témoins qui a essayé de vivre la non-violence. À propos de l’amour des ennemis, il précise : « Pour ma part, je suis heureux que Jésus n’ait pas dit. Ayez de la sympathie pour vos ennemis, parce qu’il y a des personnes pour lesquelles j’ai du mal à avoir de la sympathie. La sympathie est un sentiment d’affection et il m’est impossible d’avoir un sentiment d’affection pour quelqu’un qui bombarde mon foyer. Il m’est impossible d’avoir de la sympathie pour quelqu’un qui m’exploite. Non, aucune sympathie n’est possible envers quelqu’un qui jour et nuit menace de me tuer. Mais Jésus me rappelle que l’amour est plus grand que la sympathie, que l’amour est une bonne volonté, compréhensive, créatrice, rédemptrice, envers tous les hommes. Et je pense que c’est là que nous nous situons en tant que peuple, pour la justice sociale. Dans cette lutte, nous ne reculerons jamais, mais jamais dans notre action, nous n’abandonnerons le privilège que nous possédons, celui d’aimer. »
Le premier épître aux Corinthiens du 23 février (1 Corinthiens 15. 45-49)
La résurrection et la transfiguration de notre poussière
Le contexte – La première épître aux Corinthiens
Le Nouveau Testament évoque l’attachement particulier que l’apôtre Paul avait pour l’Église de Corinthe qu’il a fondée. Par son caractère cosmopolite, elle est à l’image d’un évangile qui s’adresse à tous, juifs et Grecs, hommes et femmes, esclaves et hommes libres, riches et pauvres qui sont appelés à vivre en frères et sœurs au nom d’une bonne nouvelle qui dépasse les séparations de nos catégories humaines.
Mais Paul a reçu des nouvelles inquiétantes de cette Église qui est traversée par des scandales, des conflits et des mauvaises compréhensions de l’Évangile. Il évoque notamment le fait qu’en son sein certains remettent en question la résurrection. Paul aborde cette question au chapitre 15 de la première épître qu’il a écrite à cette Église.
Paul commence par affirmer la résurrection du Christ, puis il dit que cette résurrection est les prémices de notre propre résurrection. Après avoir évoqué les questions pratiques : Comment ressuscite-t-on ? Il nous appelle dans le passage que nous lisons à acquérir notre résurrection en vivant en ressuscité.
Que dit le texte ? – La poussière et le céleste
Paul fait l’opposition entre deux catégories qu’il appelle le naturel et le spirituel, la poussière et le céleste.
Au commencement on est poussière, puis dans la résurrection on devient céleste. Si actuellement notre vie est marquée par la poussière – ce qui plombe notre humanité : nos lourdeurs, nos fatigues, nos limites, on est appelés à être transfiguration par la résurrection.
Le chemin de toute la vie de foi est une invitation à habiter notre poussière, mais à se laisser progressivement habiter par le céleste.
Péguy disait qu’il n’y a pas trop de toute une vie pour que l’eau du baptême qui a été versée sur notre tête descende jusqu’à nos pieds. Le défi d’une vie de foi est de faire en sorte que la grâce proclamée sur nous le jour de notre baptême vienne habiter toute notre personne.
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – Le sermon dans la plaine
Habiter le céleste, ce n’est pas renoncer à son humanité, mais c’est se laisser transformer par l’évangile du Christ. Le passage de ce dimanche nous appelle à l’amour des ennemis, à la non-violence, à la bonté envers tous les humains, y compris nos ennemis.
Vivre la résurrection, c’est être porteur d’une parole de vie y compris dans les conflits et les fractures de notre monde. Nous sommes appelés à poser des signes dès maintenant de ce que nous serons dans l’éternité de Dieu.
Le texte tiré du premier livre de Samuel du 23 février (1 Samuel 26.2-23)
David épargne Saül
Le contexte – Le premier livre de Samuel
Arrivée en terre promise, le premier mode d’organisation du peuple a été le régime des juges. Chaque tribu vivait sur son territoire sans gouvernement centralisé et lorsqu’un problème intervenait, un juge se levait pour fédérer les tribus et quand le problème était résolu, chacun rentrait chez soi. Le livre des Juges a montré l’échec de cette organisation.
Dans sa quête d’être un peuple comme les autres, les enfants d’Israël ont demandé un roi. Le premier roi s’appelait Saül, le texte dit qu’il était jeune et beau ; aucun des Israélites n’était plus beau que lui, il les dépassait tous d’une tête (1 S 9.2). Peut-être parce qu’il est trop beau, Saül vit dans la comparaison et il ne supporte pas que David ait conquis le cœur des Israélites après sa victoire du Goliath. Il développe alors une jalousie pathologique contre son serviteur et va le poursuivre pour le faire mourir.
À deux reprises, David à la possibilité de tuer celui qui le pourchasse à mort, mais à deux reprises il l’épargne car il ne veut pas porter la main sur celui qui a reçu l’onction royale. Le récit de ce dimanche raconte la deuxième fois que David agit selon les règles de la non-violence.
Que dit le texte ? – David dans le camp de Saül
David est à la tête d’une bande de rebelle poursuivi par Saül qui commande une troupe d’élite. Ayant appris où était Saül David prend un de ses hommes et pénètre de nuit dans le camp de son ennemi jusqu’à la couche du roi. L’officier pense que le Seigneur leur a remis la vie de celui qui les poursuit et se propose de le tuer, mais David refuse car même si Saül le poursuit, il est le roi qui a reçu l’onction. Il décide donc de l’épargner et se contente de prendre sa lance. Il monte sur une colline et interpelle l’officier qui dirige l’armée de Saül pour lui reprocher de ne pas avoir protégé son maître.
Quand Saül comprend que David l’a épargné, il se repent et prend l’engagement de ne plus poursuivre David. Il respectera cet engagement un temps mais sa jalousie pathologique reprendra le dessus.
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – Le sermon dans la plaine
L’attitude de David est une belle illustration de l’enseignement de Jésus dans le sermon dans la plaine lorsqu’il enseigne : aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent.
Jésus propose de substituer la loi de l’amour à la logique de la violence. Le problème de cette dernière est que c’est une spirale car la violence engendre la violence. L’attitude non-violente est une alternative à la violence. L’évangile ne dit pas qu’elle est plus efficace à tous les coups, mais que c’est l’attitude la plus évangélique.
L’évangile nous rappelle que si on fait du bien à ceux qui nous font du bien, on ne fait rien d’extraordinaire, tous les hommes sensés le font. La réponse évangélique est de renoncer à la violence en toute circonstance. Parce qu’il est mort parce qu’il a refusé de se défendre, mais 2000 ans plus tard, il continue à nous inspirer.
Production : Fondation Bersier – Regards protestants
Intervenants : Antoine Nouis, Christine Pedotti