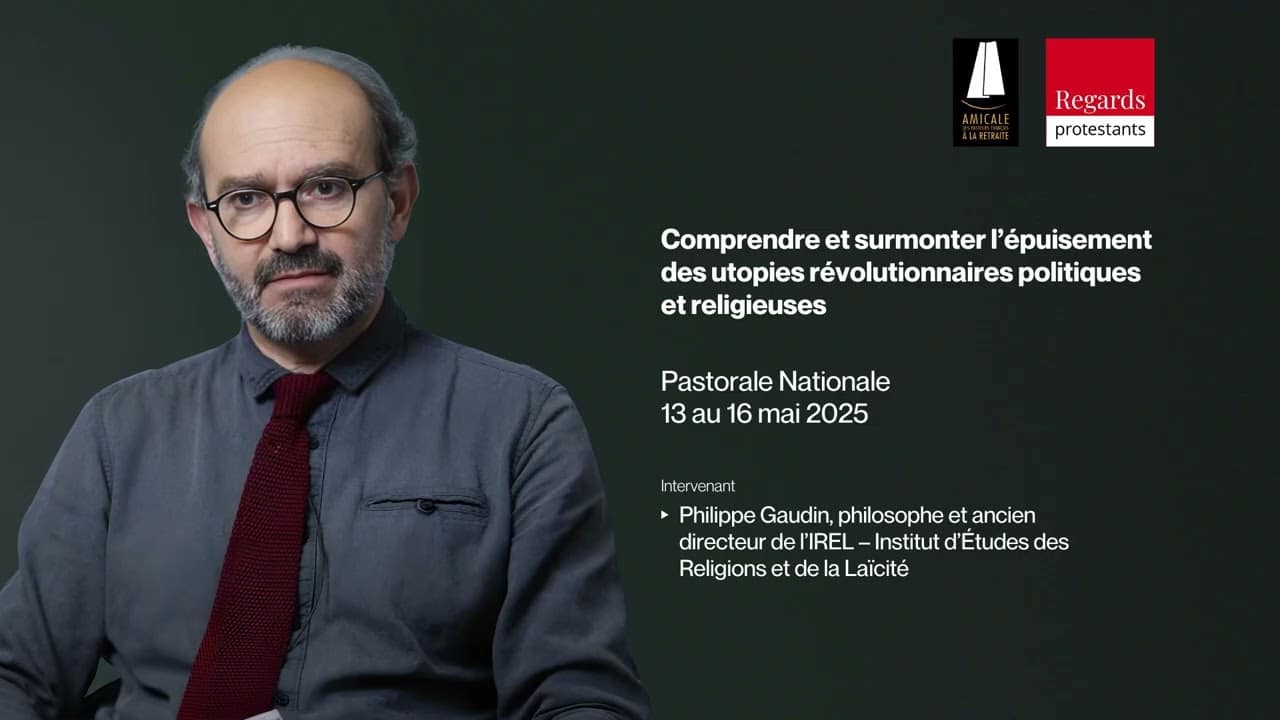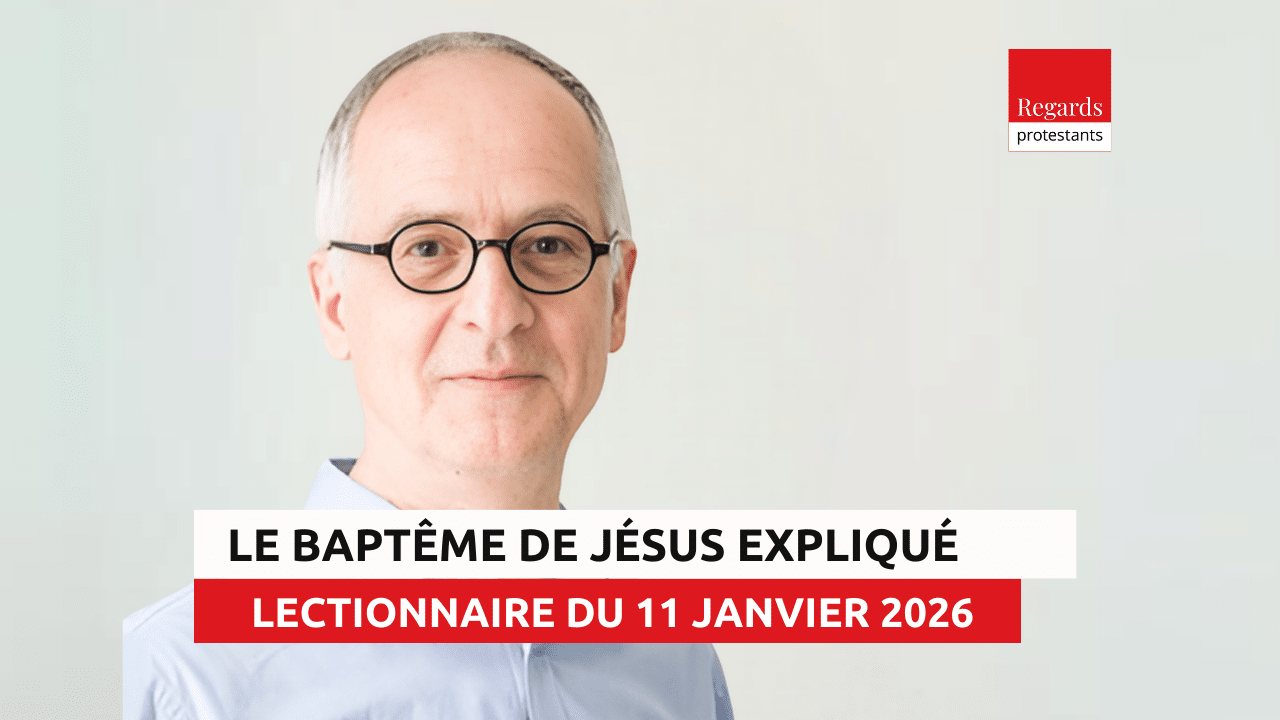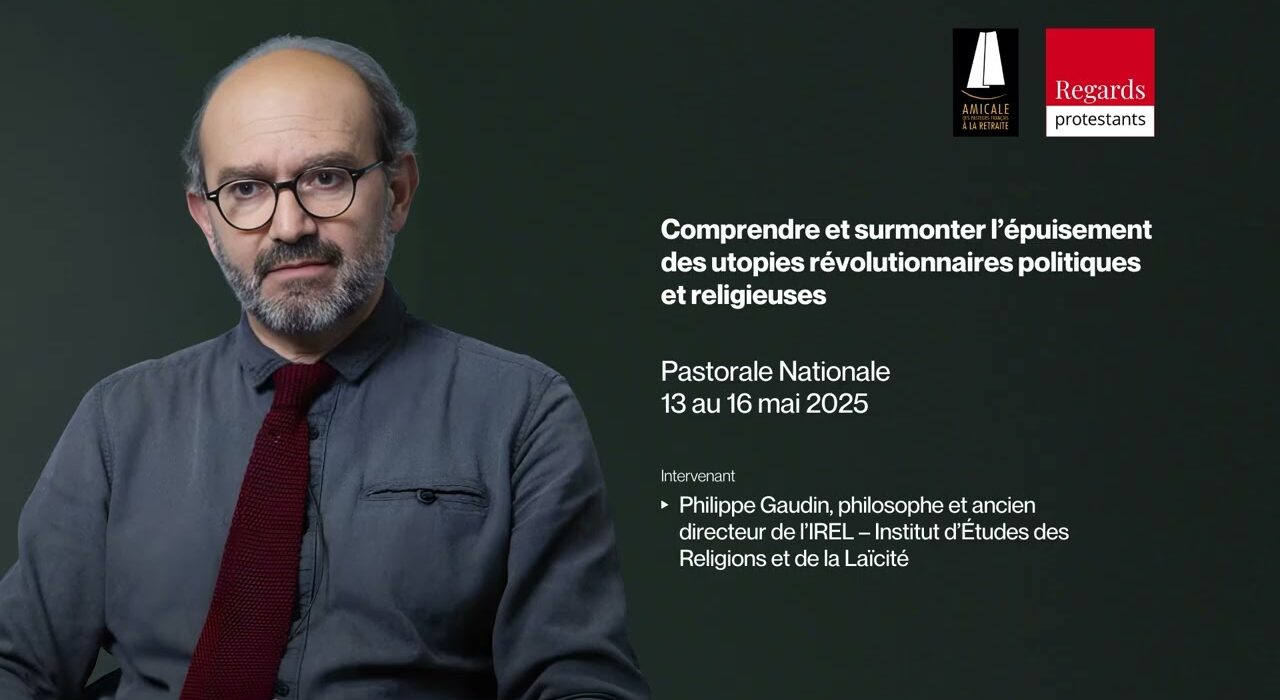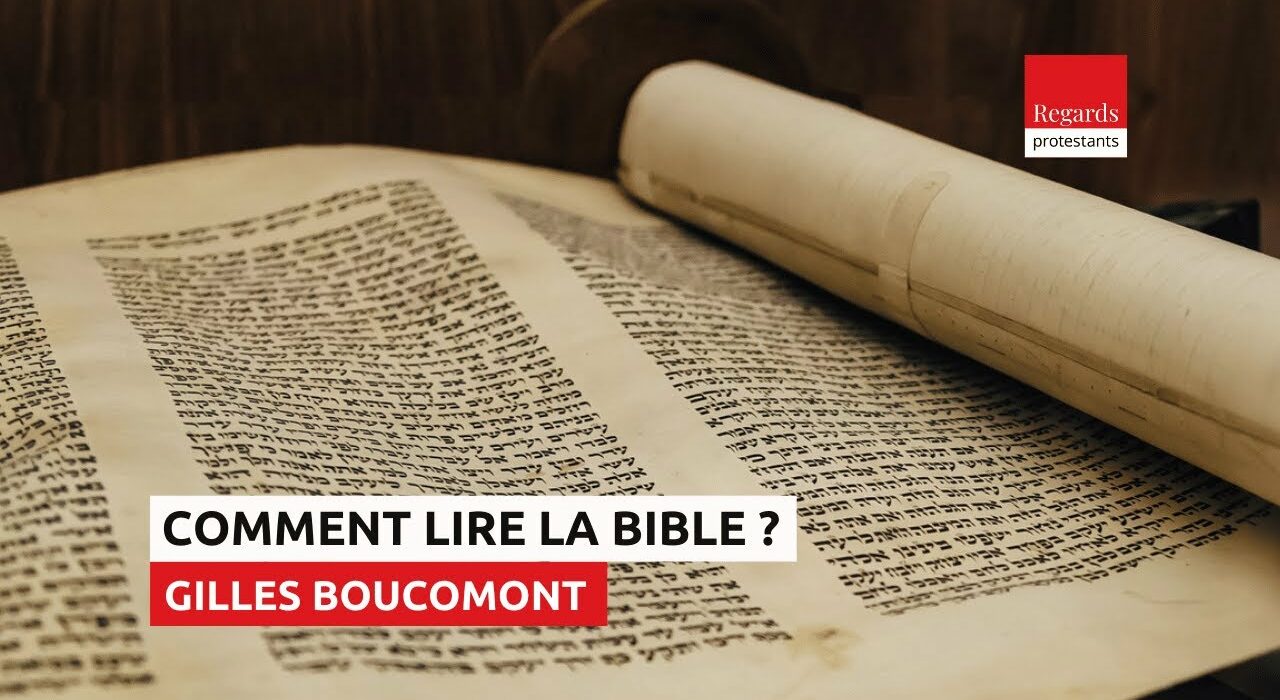L’évangile de Luc du 9 février (Luc 5. 1-11)
Dans le passage biblique de Luc chapitre 5 versets 1 à 11, l’histoire de la conversion de Simon Pierre se déroule au lac de Génésareth. Alors que Jésus prêche à une foule sur le rivage, il monte dans un bateau de pêche et demande à Simon, un pêcheur, de l’emmener en mer pour poursuivre son message. Après avoir enseigné aux gens, Jésus ordonne à Simon de jeter ses filets en eaux profondes, bien qu’ils n’aient rien pris de la nuit. Obéissant à l’ordre de Jésus, Simon et ses compagnons ramènent une pêche abondante, si importante que leurs filets commencent à se rompre. Les pêcheurs appellent à l’aide et les deux bateaux sont bientôt submergés de poissons.
Submergé par la crainte et la peur, Simon Pierre tombe à genoux devant Jésus, reconnaissant son propre péché. Jésus le rassure cependant, lui disant de ne pas avoir peur, car il va maintenant attraper des hommes au lieu de poissons. Ce moment marque un tournant dans la vie de Simon, qui, avec ses compagnons, laisse tout derrière lui pour suivre Jésus.
Ce passage met en lumière la transformation d’un pêcheur en disciple. Jésus ne choisit pas des érudits religieux ou des membres du clergé, mais des travailleurs ordinaires, soulignant ainsi la valeur de la patience et de la persévérance, qualités essentielles à la vie de disciple. L’histoire souligne la nature surprenante de la conversion, où la grâce précède le repentir. La reconnaissance par Simon de la puissance divine de Jésus, illustrée par la pêche miraculeuse, l’amène à reconnaître son péché, ouvrant ainsi la voie à son appel à devenir disciple.
Les quatre étapes de la vie de disciple – accueillir Jésus, s’aventurer dans des eaux plus profondes, obéir à sa parole et jeter le filet – servent de modèle aux croyants. Ce passage ne dépeint pas seulement un événement miraculeux, mais enseigne également les aspects fondamentaux de la foi : la grâce, l’obéissance et la volonté d’abandonner les anciennes habitudes pour un nouvel appel. L’expérience de Simon illustre comment la rencontre avec Jésus change le cours de la vie, offrant à la fois un défi et une promesse d’espoir.
Le premier épître aux Corinthiens du 9 février (1 Corinthiens 15. 1-11)
Paul et la grâce
Le contexte – Le première épître aux Corinthiens
Paul est le fondateur de l’Église de Corinthe dans laquelle il est resté dix-huit mois. Après être parti vers d’autres villes pour poursuivre son ministère d’évangéliste, il a reçu des nouvelles inquiétantes sur la communauté. L’Église est victime de divisions, on trouve en son sein des situations d’immoralité qui font scandale, les célébrations sont désordonnées et la table du Seigneur n’est pas respectée, et enfin la résurrection même est contestée.
Il va aborder ces différentes questions les unes après les autres, et il termine par la question de la résurrection qui est traitée au chapitre 15.
Que dit le texte ? – La résurrection du Christ
Paul n’explique pas la résurrection car elle relève de l’inconcevable, il la raconte : « Christ est apparu à Pierre, puis aux Douze ; ensuite à plus de cinq cents frères à la fois – la plupart sont encore vivants… – ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l’avorton que je suis. » La résurrection ne peut s’appréhender que par le témoignage de ceux qui en ont été les témoins.
Pour ce qui le concerne, Paul souligne la fécondité de cette rencontre : « Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n’a pas été inutile ; au contraire, j’ai travaillé plus qu’eux tous. »
La preuve de la résurrection, c’est que la vie de Paul a été transformée. Nous pouvons actualiser cette affirmation et dire que la preuve de la résurrection, c’est que l’Église existe encore de nos jours, alors que la mise à mort de Jésus à la croix marquait la fin de son ministère.
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – La vocation de Pierre
Pierre a fait partie des témoins du ressuscité, mais son histoire avec lui a commencé quelques années plus tôt lors de sa vocation alors qu’il était pêcheur de poissons.
S’il a répondu à l’appel de Jésus, c’est qu’il a entendu que sa personne et sa parole donnaient un sens à sa vie et lui a permis d’être authentiquement lui-même. Comme Paul il a pu dire que grâce au Christ il est ce qu’il est.
La foi n’est pas un enseignement théorique c’est la découverte chez une personne que sa vie a du sens, qu’elle est aimée, qu’elle est précédée du désir de Dieu et qu’elle s’achèvera dans son amour. Alors le disciple peut assumer authentiquement son humanité et devenir témoin de cette annonce.
Malgré les trahisons, les manques d’amour des Églises et la petitesse de sa foi, elle est détentrice d’une parole capable aujourd’hui encore de relever et d’envoyer.
Le livre d’Esaïe du 9 février (Esaïe 6. 1-8)
La vocation d’Ésaïe
Le contexte – Le livre d’Ésaïe
La première partie du livre d’Ésaïe (chapitre 1 à 39) fait référence aux événements qui se sont déroulés au VIIIe siècle avant notre ère. Ésaïe est un homme appelé par le Seigneur pour parler au nom de Dieu dans une période où le peuple s’est éloigné de la fidélité et de la justice.
Les premiers chapitres évoquent l’état pitoyable dans lequel se trouve le peuple qui est gangréné depuis les pieds jusqu’à la tête et qui n’a pas été soigné. Certes Jérusalem est toujours debout, mais c’est parce qu’elle reste sous le regard de Dieu, sinon elle aurait disparu.
Les cérémonies célébrées dans le temple n’ont aucune valeur aux yeux de Dieu car elles ne sont pas sincères, et le droit est bafoué car les juges acceptent les pots-de-vin, ce qui fait que la justice n’est pas rendue selon le droit, mais selon la fortune de ceux qui sont jugés.
Que dit le texte ? – L’appel du prophète
Dans une vision, Ésaïe voit le trône de Dieu, car Dieu lui-même ne peut être vu. Lorsque Moïse a voulu voir la gloire de Dieu, Dieu a répondu qu’il lui montrera sa bonté, mais il a ajouté : Tu ne peux voir ma face, car l’homme ne saurait me voir et vivre (Ex 33.20). Dieu s’est laissé voir de dos. Dans la même veine, Ésaïe ne décrit pas Dieu, il dit qu’il était assis sur un trône très élevé, que le bas de son vêtement remplissait le temple, et qu’il était entouré de seraphim qui proclamaient la gloire du Seigneur.
Devant cette vision, Ésaïe pense qu’il va mourir car il se sait impur, c’est pourquoi un des seraphim lui purifie la bouche avec une braise de l’autel. Plutôt que de mourir, le prophète est envoyé pour parler au nom du Seigneur.
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – La vocation de Pierre
Pierre est un pécheur qui a accepté de laisser Jésus monter dans son bateau pour parler à la foule. Quand ce dernier lui propose de jeter son filet et que la pêche devient miraculeuse, il prend conscience que celui qu’il a accueilli dans sa barque est plus qu’un simple prédicateur. Il se reconnaît pécheur et se jette aux pieds de Jésus.
Dans la Bible, chaque fois qu’un humain est devant une manifestation incontestable de la présence de Dieu, il commence par mesurer son péché.
Un commentaire dit qu’il en va de la conviction du péché comme d’un pare-brise poussiéreux et maculé. Tant que nous roulons dans une forêt épaisse par temps de brouillard, nous ne voyons pas la couche grise qui couvre notre pare-brise. Mais dès que nous sortons de la forêt et du brouillard pour entrer dans une zone ensoleillée, la lumière frappe notre pare-brise et nous révèle toutes les taches et les impuretés qui nous empêchent de voir la route et le paysage.
Production : Fondation Bersier – Regards protestants
Intervenant : Antoine Nouis