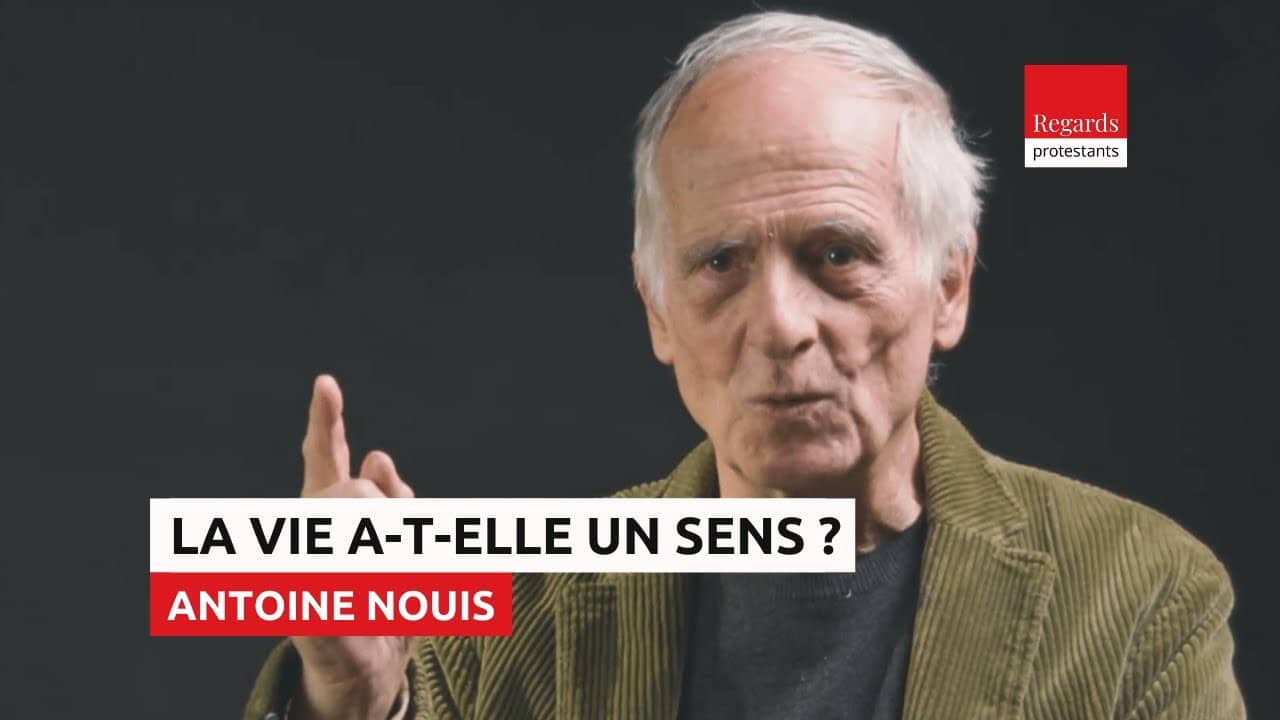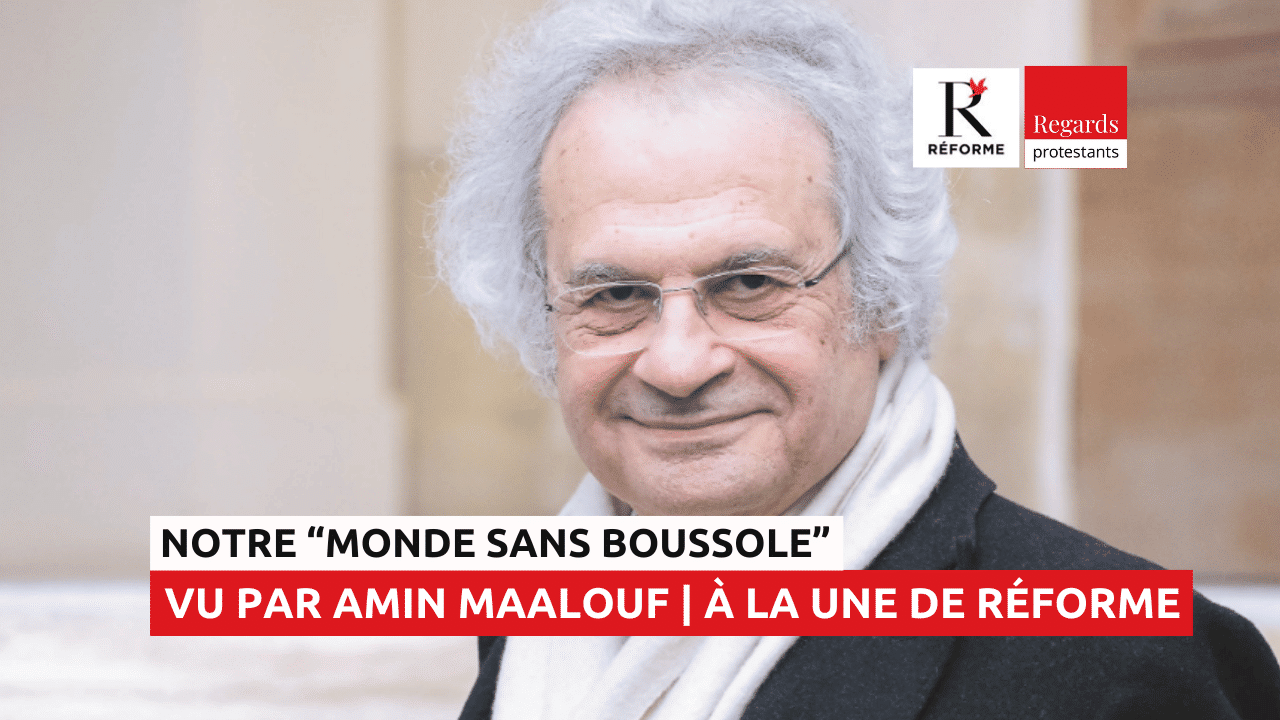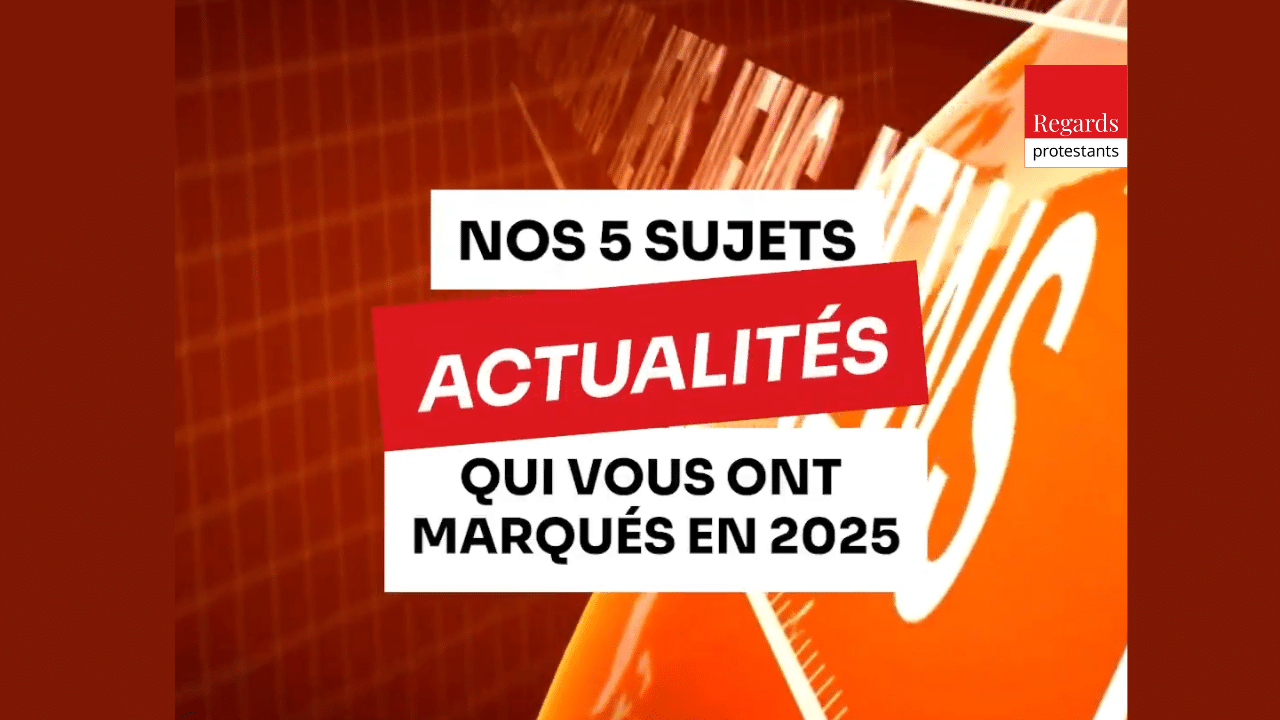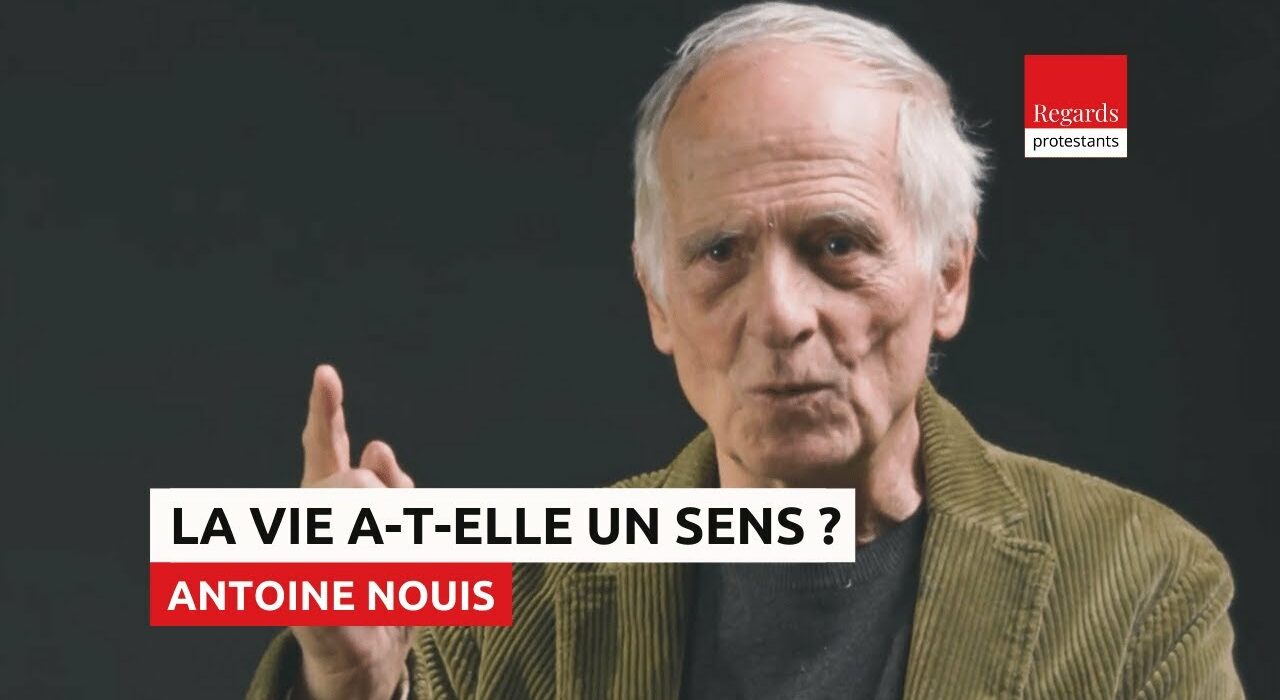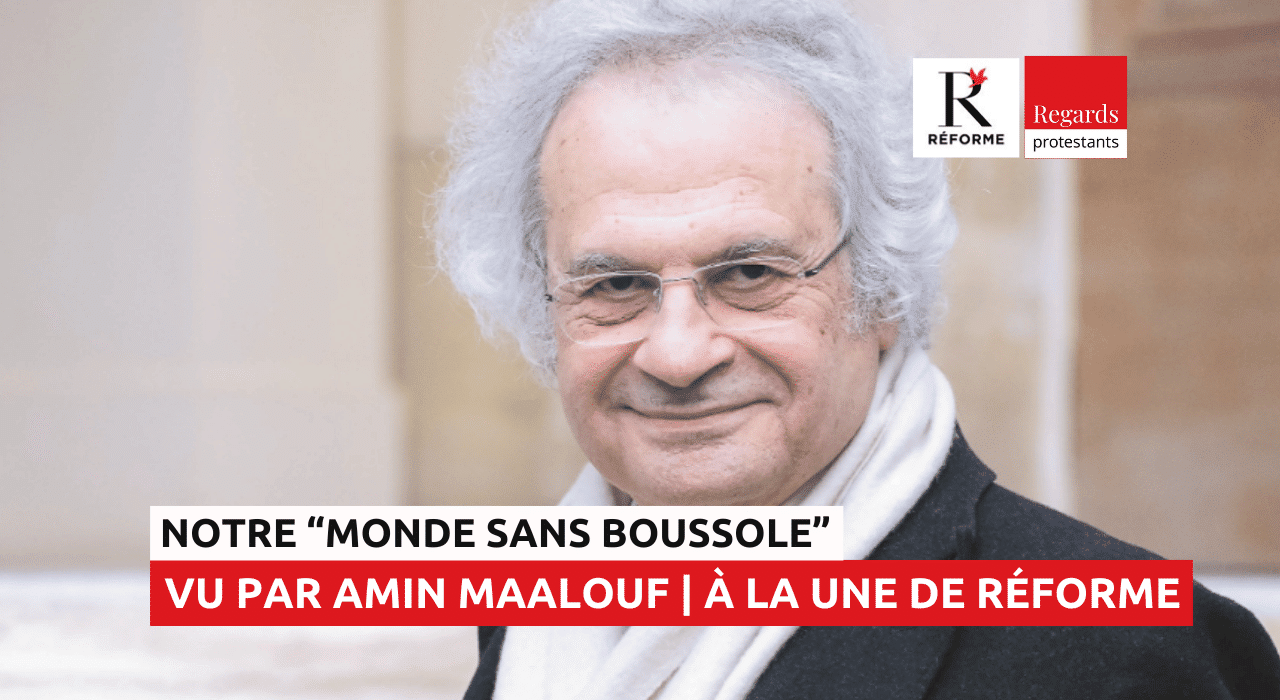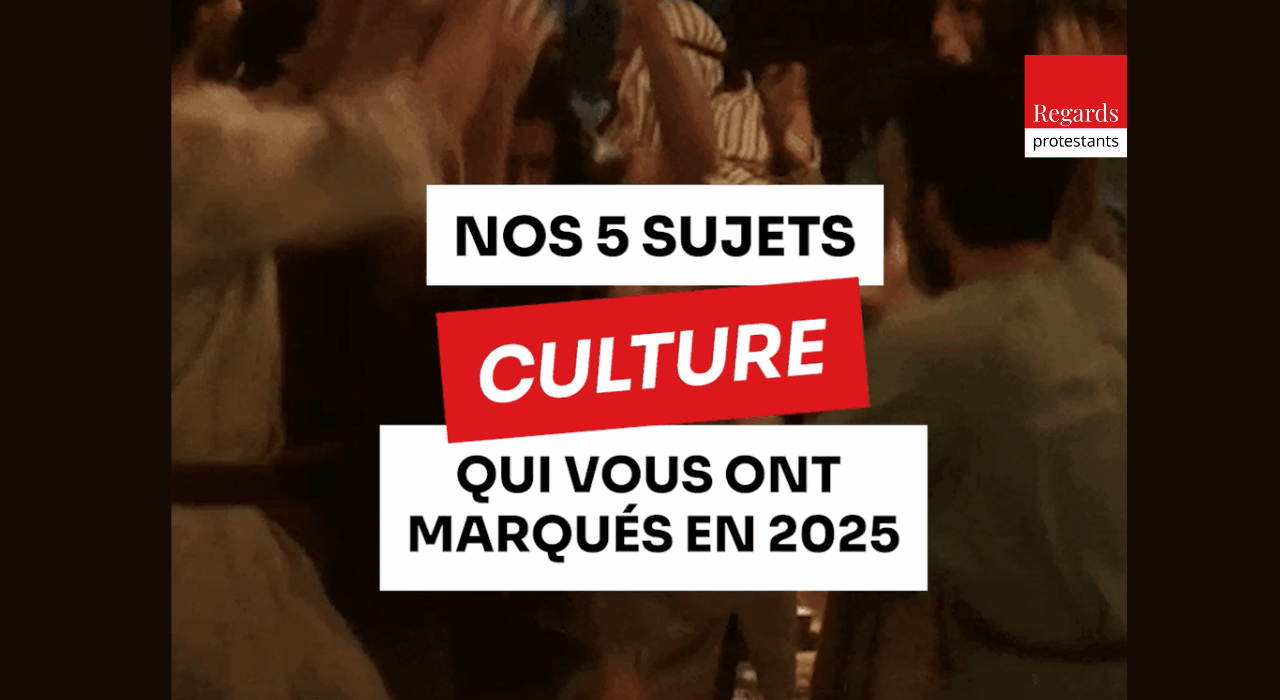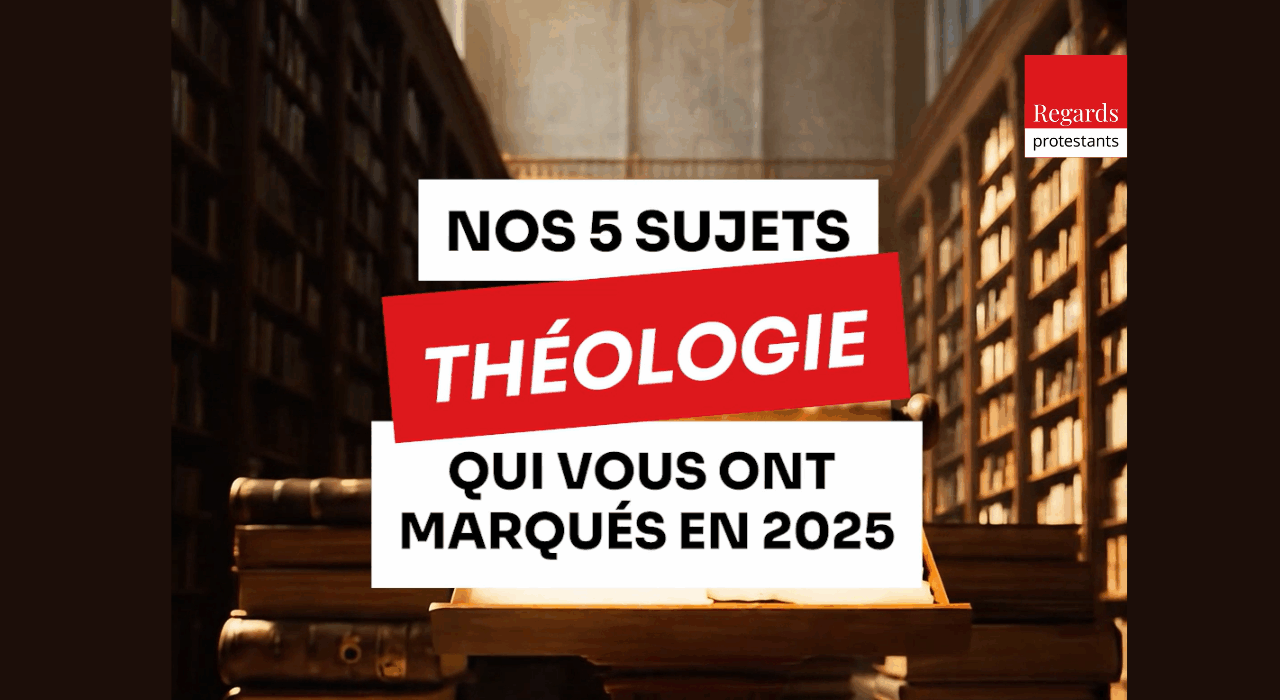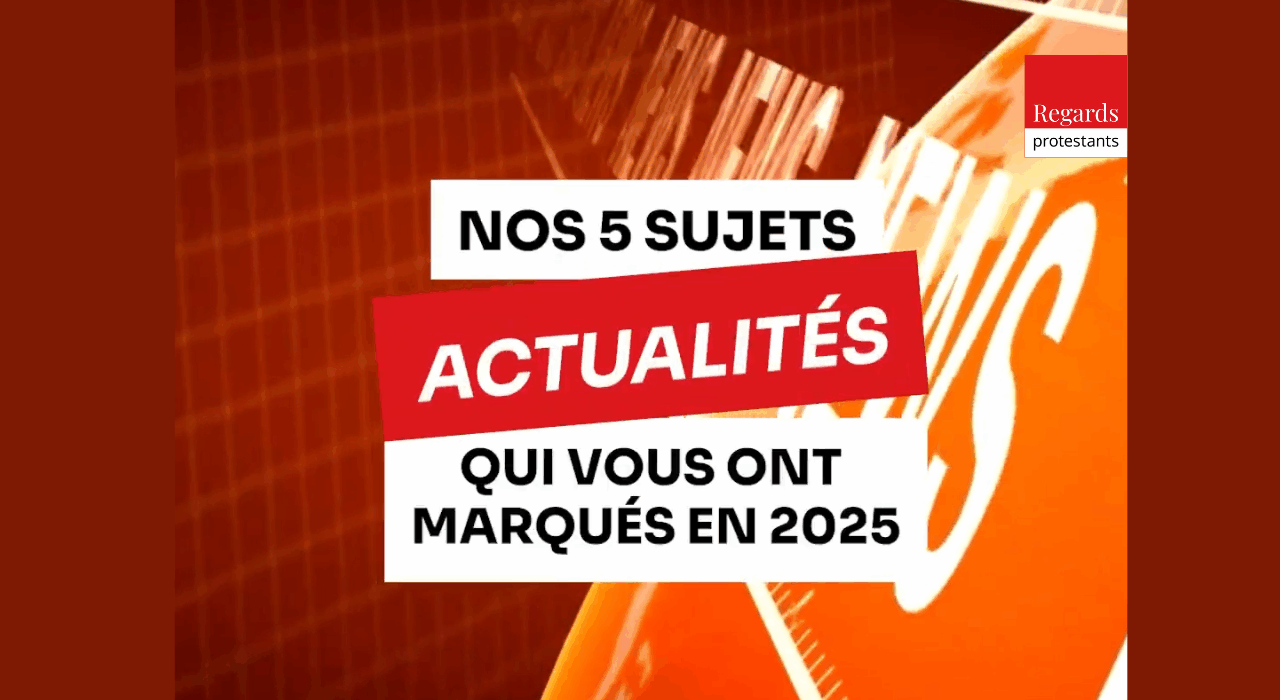Le texte extrait de l’évangile de Jean du 11 mai (Jean 10, 27-30)
Dans l’Évangile de Jean au chapitre 10, Jésus se décrit comme le berger et la porte, offrant une image de la relation entre lui et ses disciples. Dans ce passage, Jésus affirme que ses moutons entendent sa voix, le reconnaissent et le suivent, et en retour, il leur accorde la vie éternelle. Cette vie éternelle ne se limite pas à une existence prolongée, mais renvoie à une vie de qualité et de relation avec Dieu, une vie qui s’accomplit et se dilate plutôt que de simplement s’étendre indéfiniment.
L’image du mouton, souvent perçue aujourd’hui de manière négative, symbolise en réalité une relation de confiance et de bienveillance entre le berger et son troupeau. Cette métaphore était très familière à l’époque biblique, car la société pastorale valorisait le berger comme un modèle de responsabilité et de soin. Dans l’Ancien Testament, de nombreux rois, dont David, étaient eux-mêmes des bergers, un symbole de leadership et de protection. Loin d’être des animaux sans esprit, les moutons, dans ce passage, sont des êtres réactifs et capables de reconnaître la voix de leur berger. Ils choisissent de le suivre en raison d’un lien profond et d’une écoute attentive.
Le verset phare de ce passage, « le Père et moi sommes un », met en lumière la nature divine de Jésus et son union intime avec Dieu. Ce concept de l’unité de Jésus avec le Père constitue une affirmation théologique majeure, annonçant les débats christologiques à venir dans l’histoire de l’Église. Jésus ne se limite pas à être un simple enseignant ou un prophète, il est Dieu incarné, un pont entre l’humanité et le divin.
Enfin, la vie éternelle mentionnée dans ce passage n’est pas seulement une promesse d’immortalité, mais une expérience de vie profonde et spirituellement accomplie. Jésus, en se présentant comme le bon berger, invite ses disciples à une vie de communion avec Dieu, une vie qui dépasse les frontières de la mort et qui se trouve inscrite dans la mémoire divine, inaltérable et éternelle.
Le texte extrait du livre des Actes du 4 mai (Actes 13.14-52)
Échec de la prédication auprès des juifs, ouverture aux non-juifs
Le contexte – Le livre des Actes des Apôtres
Le livre des Actes des Apôtres rapporte l’histoire de la première Église. Il comporte un certain nombre de discours de Pierre, d’Étienne et de Paul qui, chacun à sa façon, relit l’histoire d’Israël dans le but de montrer que Jésus de Nazareth est le Christ annoncé par le Premier Testament et attendu par le peuple.
Le texte de ce dimanche est important car il montre comment en arrivant à Antioche de Pisidie Paul et Barnabé ont d’abord évangélisé dans la synagogue, puis comment ils ont été chassés par les responsables, ce qui les a conduits à se tourner vers des non-juifs.
Comme dans l’épisode de la venue de Pierre chez Corneille, ce sont les événements qui ont conduit la première Église à s’ouvrir à l’universel.
Que dit le texte ? – Échec et opportunité
Du discours de Paul, nous pouvons retenir quatre points.
Il inscrit la personne du Christ en accomplissement de la promesse faite à David qu’un de ses descendants régnera toujours. À la manière de Dieu, cette promesse ne s’accomplit pas sous les formes attendues, mais elle s’accomplit.
En même temps que la promesse faite à David, le Premier Testament raconte aussi comment les prophètes envoyés par Dieu ont été persécutés. Jésus accomplit l’attente du Premier Testament, dans son origine davidique et dans son rejet.
Dans son résumé de l’évangile Paul dit de Jésus que c’est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Le cœur de l’Évangile, c’est qu’en Christ Dieu est pardon, il ne nous voit pas dans les contradictions de notre humanité mais les lunettes de la grâce et du pardon.
Le dernier verset de notre passage dit que les disciples… étaient remplis de joie et d’Esprit saint. Je suis marqué comment très régulièrement dans le Nouveau Testament, la foi est décrite dans le registre de la joie.
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – Le bon berger
L’évangile de ce dimanche avec l’affirmation que Jésus est le bon berger et qu’avec lui personne ne se perd suivi de l’attitude de certains religieux qui veulent le lapider.
Derrière l’image du berger, nous retrouvons David qui était berger avant d’être roi. Nous retrouvons les deux points que nous avons relevés dans le discours de Paul : Le Christ qui accomplit et le Christ qui est rejeté.
Enfin nous trouvons dans le passage de l’évangile l’explication de la joie qui qualifie les disciples de la première Église : Je leur donne la vie éternelle… et personne ne les arrachera de ma main. La vie éternelle est une vie inscrite dans l’éternité de Dieu, c’est l’assurance que notre vie est belle et qu’elle a du poids.
Le texte extrait du livre de l’Apocalypse du 4 mai (Apocalypse 7.9-17 )
La gloire et la résistance
Le contexte – Le livre de l’Apocalypse
L’apocalyptique est une littérature de résistance. Ce style littéraire est utilisé pour soutenir la fidélité des croyants lorsqu’ils sont opprimés, oppressés, parfois martyrisés. Il utilise un imaginaire puissant pour rassurer et encourager ceux qui sont dans le combat de la foi.
L’histoire du monde est représentée sous la forme d’un livre qui ne peut être ouvert car il est scellé. Celui qui rompt les sceaux est l’agneau immolé, c’est à partir de lui que nous pouvons appréhender le sens de l’histoire. Nous entendons que les forces du mal existent – l’agneau est immolé – mais nous entendons aussi qu’à la fin c’est lui qui est vainqueur. Celui qui est descendu le plus bas est en même temps celui qui trône à la droite de Dieu.
Que dit le texte ? – Le sort des martyrs
Nous pouvons relever quatre points dans ce passage de l’Apocalypse.
Ceux qui se tiennent devant le trône de l’agneau sont ceux qui viennent de la grande détresse. Le livre s’adresse à une Église persécutée. Le fait d’être opprimé n’est pas la conséquence d’une faute ou d’une erreur, mais de la fidélité à celui qui a été crucifié.
Le texte rappelle que les adorateurs de l’agneau sont une foule innombrable. L’Église était toute petite, elle était opprimée et elle pouvait se demander si ça valait la peine de rester fidèle. Le voyant apprend aux fidèles qu’ils ne sont pas seuls ils appartiennent à une foule innombrable.
Encore une fois, nous devons relever le paradoxe d’une adoration – la bénédiction, la gloire, la sagesse, l’action de grâces, l’honneur, la puissance et la force – qui ne s’adresse pas à un lion ou un taureau, mais à un agneau immolé.
Notre passage se termine par une promesse : Il essuiera toute larme de leurs yeux. Dans l’épreuve il faut rester accroché à la promesse qu’elle aura une fin et qu’elle sera suivie d’une grande consolation.
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – Le bon berger
Dans le passage de l’évangile de ce dimanche, le Christ n’est pas l’agneau mais le bon berger. Le paradoxe n’est qu’apparent : notre berger est un agneau.
Parce que c’est un agneau, il intervient avec douceur et compassion et parce que c’est un berger il nous conduit sur le bon chemin.
Parce qu’il a été immolé, il nous assure du pardon de Dieu, et parce que c’est un berger il nous donne la vie éternelle, c’est-à-dire une vie inscrite dans l’éternité de Dieu.
Avec un tel berger, il ne nous est pas promis que nous ne traverserons pas d’épreuves, mais rien de pourra nous séparer de son amour.
Production : Fondation Bersier – Regards protestants
Intervenant : Antoine Nouis