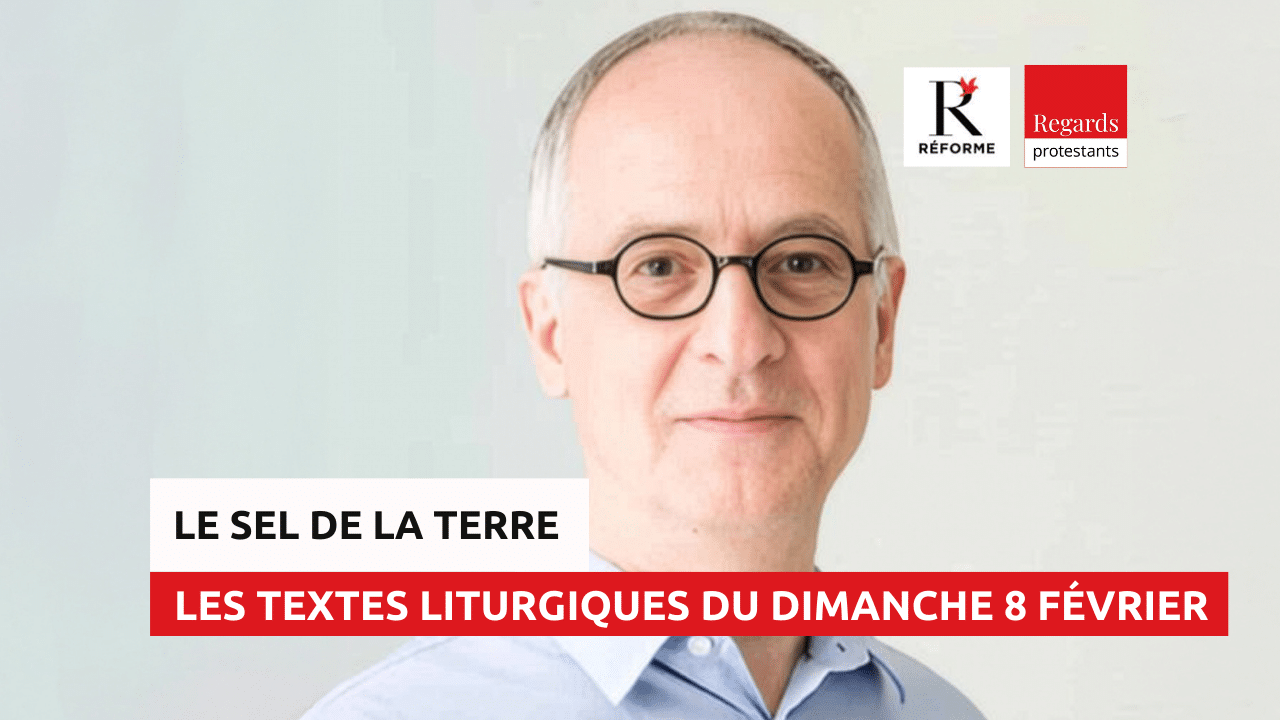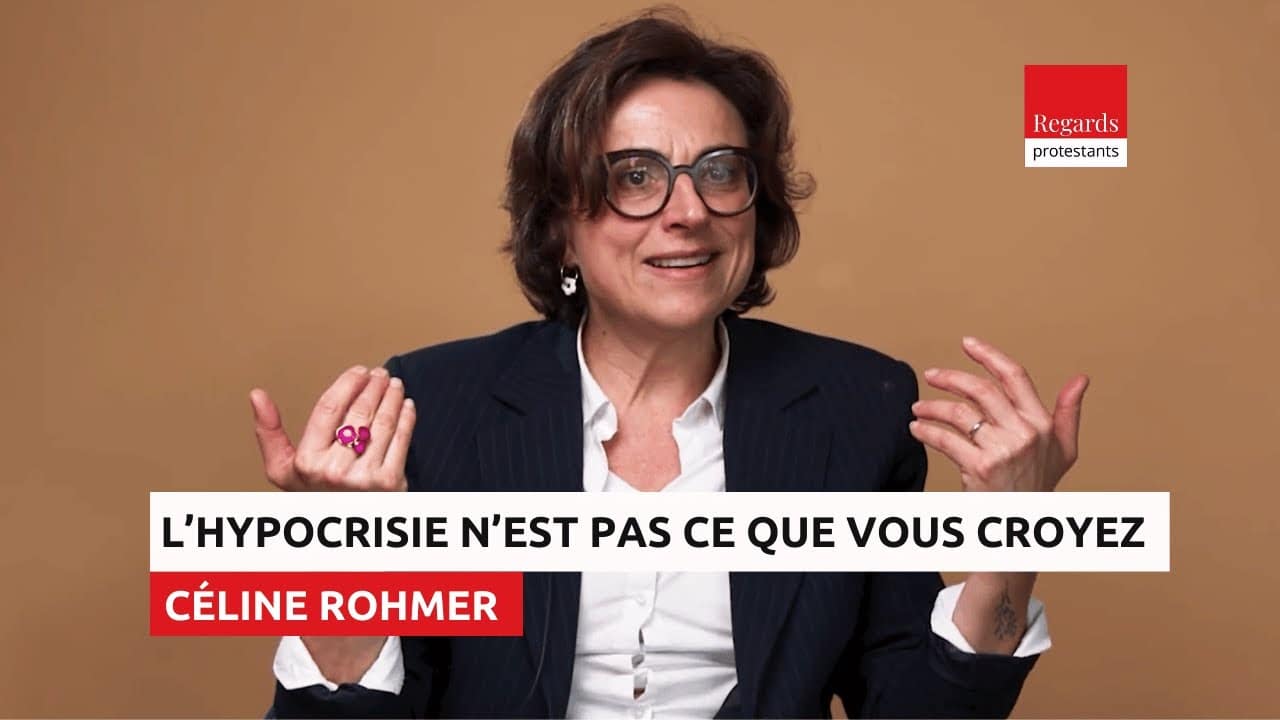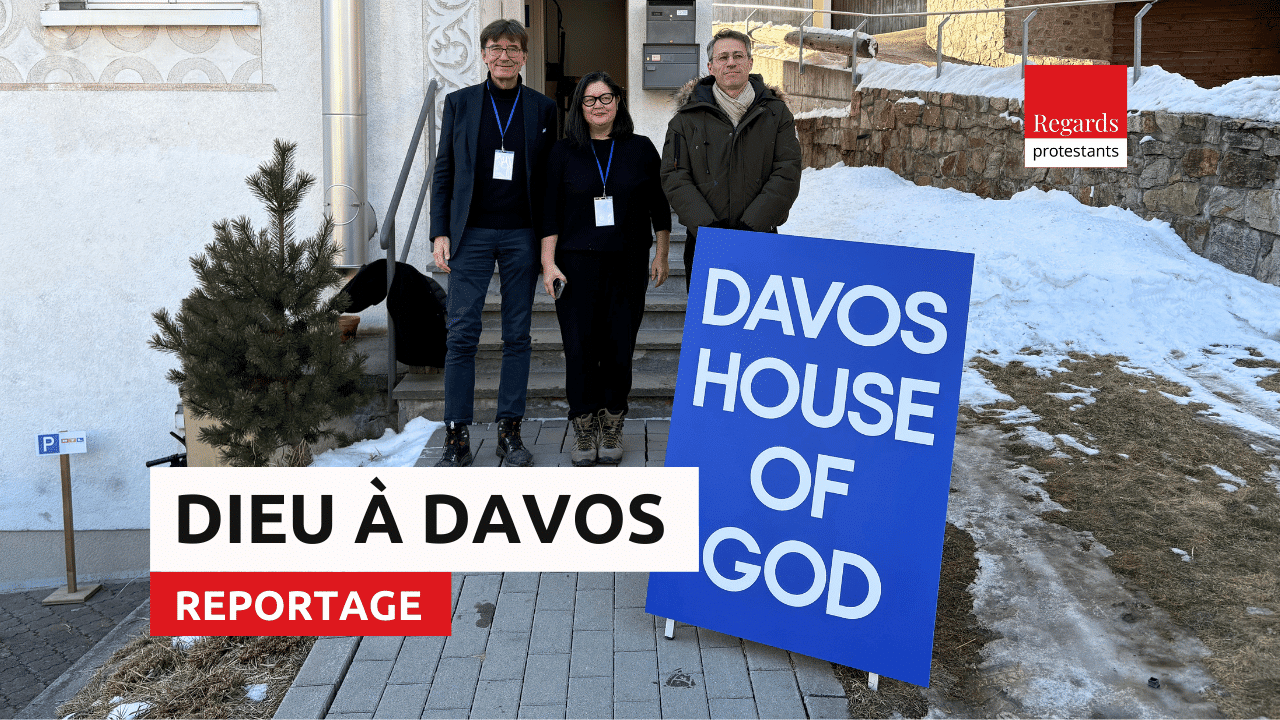L’évangile de Luc du 13 avril (Luc 23, 35-43)
Le texte des Rameaux, s’appuie sur l’épisode de la crucifixion où Jésus, moqué et humilié par les autorités religieuses et civiles, porte une inscription proclamant : « Ce homme est le roi des Juifs. » Cet acte, interprété comme une raillerie, soulève la question du véritable sens de la royauté de Jésus.
L’évangéliste Luc commence par décrire les moqueries des soldats et des malfaiteurs, qui, tout en étant crucifiés avec Jésus, le narguent en lui demandant de se sauver lui-même. Toutefois, un des malfaiteurs, dans un acte de foi paradoxal, reconnaît la justice de la souffrance de Jésus et lui demande : « Souviens-toi de moi lorsque tu entrerais dans ton royaume. » Jésus répond en lui assurant qu’il sera avec lui dans le paradis. Ce moment devient l’illustration parfaite de la royauté de Jésus, qui n’est pas celle d’un monarque terrestre mais celle d’un roi spirituel qui règne sur le cœur des hommes, même dans la souffrance.
Le texte analyse ensuite la notion de royauté chrétienne comme un paradoxe : un roi crucifié, humilié, rejeté par presque tous, et pourtant le plus grand des rois. Ce contraste est au cœur de la foi chrétienne, qui proclame un Dieu ayant partagé les souffrances humaines jusqu’à l’abaissement total, allant jusqu’à la mort sur la croix. L’auteur souligne que ce sacrifice est l’incarnation même du salut universel, accessible à tous, même aux plus désespérés.
La réflexion s’élargit sur la façon dont ces textes évangéliques, bien que rédigés il y a des siècles, continuent de nourrir la foi et d’inviter à une conversation constante avec le divin. À travers les paradoxes de la royauté du Christ, le croyant est conduit à une foi pure et inébranlable, trouvant dans chaque lecture de l’Évangile une nouvelle parole, un nouvel enseignement. En somme, la royauté de Jésus, loin d’être une gloire terrestre, est un royaume de miséricorde, de rédemption et d’humilité, où la plus grande royauté réside dans l’abaissement de soi.
Le texte de la lettre aux Philippiens du 13 avril (Philippiens 2.6-11)
Le Christ abaissé et élevé
Le contexte – L’épître aux Philippiens
Lorsque Paul écrit l’épître aux Philippiens, il est en prison. Il pourrait se lamenter devant l’injustice de son incarcération, mais il refuse de se laisser aller à la plainte, au contraire c’est l’épître qui parle le plus de joie, thème qu’il évoque à six reprises en quatre chapitres.
L’apôtre est en prison, mais sa communion avec le Christ est plus forte que toutes ses épreuves. La joie n’est pas dépendante des circonstances extérieures, elle est un fruit de la foi comme l’écrivait Bonhoeffer : « La joie de Dieu est passée par le dénuement de la crèche et la détresse de la croix : c’est pourquoi elle est invincible, irrésistible. Elle ne nie pas la détresse là où elle se trouve, mais au sein de cette détresse, en elle, elle trouve Dieu. »
Que dit le texte ? – L’évidement du Christ
L’hymne christologique du deuxième chapitre évoque l’évidement d’un Christ qui était divin et qui est devenu humain, non seulement humain mais esclave, non seulement esclave mais crucifié. La suite du texte précise : C’est pourquoi Dieu l’a souverainement élevé.
Ce mouvement fonde théologiquement le renversement des valeurs que l’on trouve dans les évangiles lorsque Jésus annonce que les derniers seront les premiers, que les petits sont les vrais grands et que les maîtres sont ceux qui servent. C’est à partir de ce fondement que Paul fonde sa théologie et invite ses interlocuteurs à cultiver l’humilité en regardant les autres comme étant supérieurs à eux-mêmes.
L’évidement, en grec on dit la kénose, devient un principe théologique et éthique : accepter de se retirer pour libérer un espace dans lequel le prochain pourra se déployer et tout simplement vivre.
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – Les rameaux
Le récit des rameaux est un grand malentendu. La foule et les disciples acclament Jésus comme un roi pour qu’il règne sur le monde alors qu’il sera roi en étant obéissant jusqu’à la mort, la mort sur la croix. Cette opposition fonde l’Évangile.
L’hymne de l’épître aux Philippiens est une interprétation de l’impensable de la croix en soulignant que l’abaissement du Christ n’est pas la marque de l’échec de sa mission mais le jusqu’au bout d’un évangile qui révèle un Dieu qui se donne pour les humains.
Comme l’a écrit Calvin dans un autre hymne : « Tu t’es humilié pour nous exalter, tu as été asservi pour nous affranchir, tu t’es appauvri pour nous enrichir, tu as été vendu pour nous racheter. »
Le texte de Esaïe du 13 avril (Esaïe 50.4-7)
La compassion jusqu’à la souffrance
Le contexte – Le livre d’Ésaïe
La deuxième partie du livre d’Ésaïe évoque le temps de l’exil qui fut un temps de reconfiguration théologique et spirituelle. Quand il a perdu sa terre, son temple et sa liberté, le peuple a changé son regard sur le divin et a compris Dieu comme un soutien qui marchait à ses côtés dans ses épreuves.
Cette nouvelle compréhension apparaît notamment dans les chants du serviteur, le texte de ce dimanche est le troisième de ces poèmes qui présentent un serviteur qui a été envoyé pour soutenir celui qui est épuisé. Sa compassion le conduira à partager son épreuve puisqu’il va jusqu’à dire : J’ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe ; je ne me suis pas détourné des insultes et des crachats.
Ces chants opèrent une déconstruction de l’image de Dieu qui trouvera un aboutissement dans l’Évangile.
Que dit le texte ? – Un serviteur qui écoute
Le serviteur est défini comme celui qui sait parler au peuple : il m’a donné le langage des disciples, il sait par sa parole soutenir l’homme épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille. Pour dire une parole juste, le serviteur commence par écouter. Il faut éduquer son oreille à la parole de Dieu pour avoir une parole ajustée, savoir quand il faut se taire et quand on peut parler, et quelle parole dire.
L’écoute de la parole a conduit le serviteur à la non-violence. De même qu’il ne s’est pas dérobé à la parole du Seigneur, il ne s’est pas dérobé à ceux qui le frappaient, qui lui arrachaient la barbe, qui l’insultaient et l’humiliaient. Parce qu’il savait que son attitude était juste, il a résisté à ceux qui l’opprimait par ce qu’il n’avait pas honte.
Nous ne pouvons pas lire ce passage sans relever que dans l’évangile, celui qui a été flagellé, frappé, insulté et humilié est le Christ de Dieu. Le cœur de la révélation chrétienne est la non-violence d’un Dieu qui a préféré subir le mal de ses ennemis, plutôt que de les massacrer.
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – Les rameaux
La nouvelle compréhension de Dieu induise par les chants du serviteur mettra du temps à être entendue par les croyants. Nous en voyons une illustration dans le verset qui dit que la foule acclame Jésus pour tous des miracles qu’ils avaient vus, or Jésus monte à Jérusalem pour être crucifié, ce qui est l’anti-miracle par excellence.
Le texte des Rameaux repose sur un quiproquo majeur entre la foule qui acclame un roi qui apportera la justice et le serviteur qui se prépare à être humilié, écrasé, et rejeté par tous.
Production : Fondation Bersier – Regards protestants
Intervenants : Antoine Nouis, Christine Pedotti