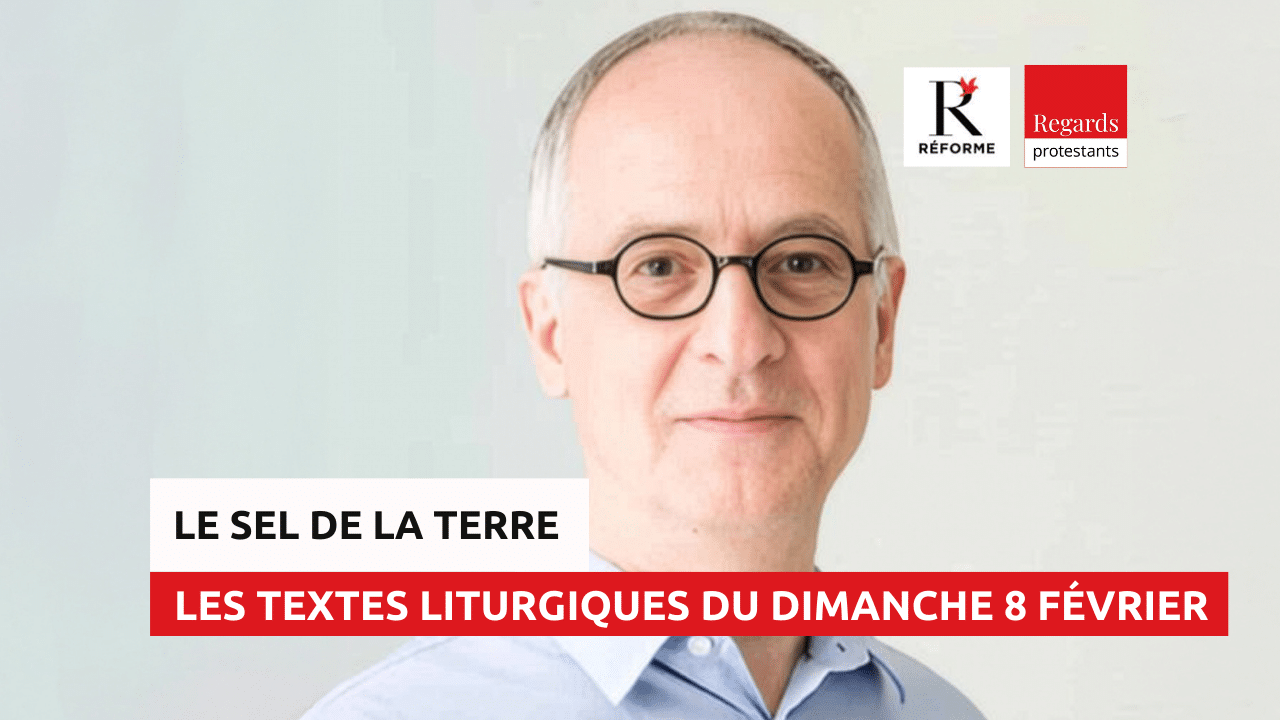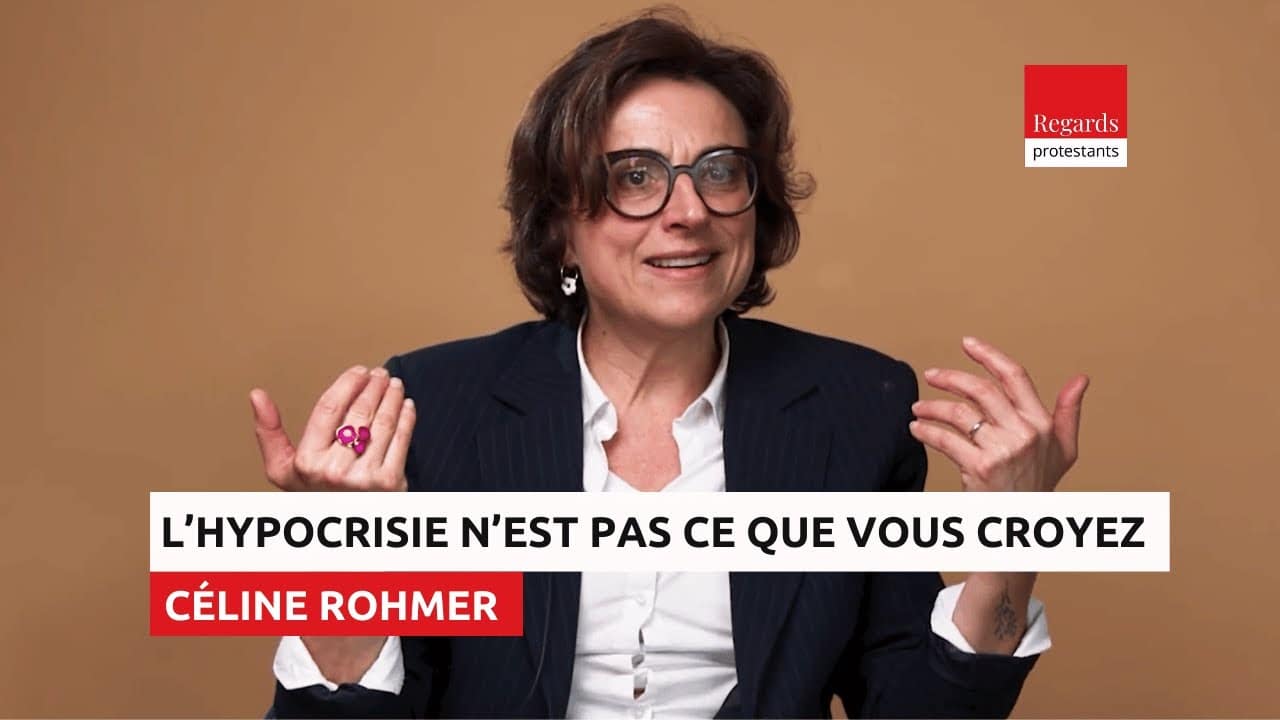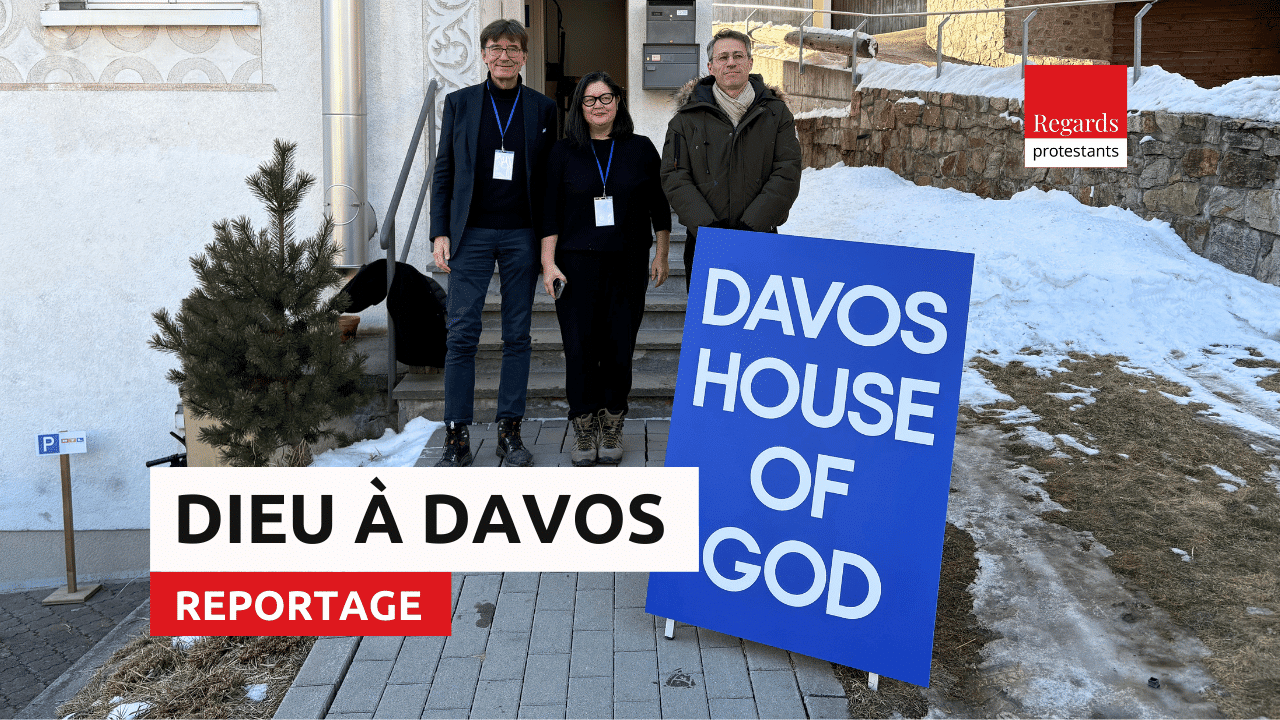L’évangile de Luc du 30 mars (Luc 15. 1-3. 11.32)
La parabole du Fils Prodigue, telle que décrite dans Luc chapitre 15 versets 1 à 3 et 11 à 32, aborde les thèmes de pardon, de rédemption et d’amour inconditionnel d’un père. L’histoire commence par Jésus qui dîne avec des collecteurs de taxes et des pécheurs, ce qui scandalise les pharisiens et les scribes, qui le critiquent pour fréquenter de telles personnes. En réponse, Jésus raconte la parabole d’un père ayant deux fils. Le plus jeune demande sa part d’héritage, une demande normalement faite après la mort du père. Malgré le manque de respect de cette demande, le père y accède. Le fils prodigue part dans un pays lointain, dilapide sa richesse en vivant de manière débauchée, et finit par se retrouver sans rien, luttant pour survivre pendant une famine. Désespéré, il accepte un travail en nourrissant des porcs, un emploi considéré comme profondément dégradant dans la culture juive. Dans son moment le plus bas, il se souvient que même les serviteurs dans la maison de son père ont de quoi manger, ce qui le pousse à retourner chez lui en se rependant.
Alors que le fils prodigue approche, son père, le voyant de loin, court à sa rencontre et l’embrasse. Avant que le fils ait pu terminer sa confession, le père ordonne un festin en son honneur, symbolisant sa restauration totale en tant que fils bien-aimé. Cependant, le fils aîné, qui a toujours servi son père fidèlement, se met en colère en entendant parler de la fête pour son frère cadet. Il confronte son père, exprimant son ressentiment. Le père répond avec compréhension, lui rappelant que tout ce qu’il possède lui appartient, mais qu’il faut se réjouir, car le fils cadet était perdu et il a été retrouvé.
Cette parabole met en lumière le concept révolutionnaire de la grâce dans l’Évangile. Le pardon du père précède la repentance du fils, montrant que le pardon divin est accordé gratuitement avant toute action humaine. L’histoire rappelle que l’amour de Dieu est inconditionnel, invitant tous, quel que soit leur passé, à revenir à la maison. L’Église, à l’image du père dans la parabole, doit offrir cette grâce et ce pardon à ceux qui se sentent indignes. La parabole souligne le pouvoir transformateur de la mémoire, de la repentance et de la nature radicale de la grâce qui défie les attentes humaines et les normes sociales.
Le texte de la lettre aux Corinthiens du 30 mars (2 Corinthiens 5.17-21)
Christ nous a réconciliés
Le contexte – La deuxième épître aux Corinthiens
La deuxième épître aux Corinthiens est la plus personnelle de l’apôtre puisqu’il nous fait partager les épreuves qu’il a traversées dans son ministère, alors qu’habituellement il reste pudique sur sa propre personne pour tout concentrer sur le Christ.
Il faut dire qu’il est personnellement attaqué dans l’Église de Corinthe par des hyper-spirituels qui lui reprochent son manque de prestance et d’éloquence tout en se faisant entretenir par l’Église.
Au lieu de se défendre, il renvoie au Christ car c’est sur lui que repose le ministère de la réconciliation et non sur les performances de ses serviteurs.
Que dit le texte ? – Le ministère de la réconciliation
En se concentrant sur le Christ, Paul appelle les Corinthiens à vivre la nouveauté du Christ qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il appelle ses interlocuteurs à cesser leurs querelles pour vivre la réconciliation.
En grec, dans le verbe réconcilier (katallasso), il y a le mot autre (allos). La réconciliation passe par la reconnaissance de l’autre dans sa différence. Cela ne va pas de soi, c’est pourquoi Paul en fait un ministère.
Si nous pouvons vivre la réconciliation – la reconnaissance de l’autre – c’est parce que nous savons que nous avons été réconciliés. C’est l’épître aux Colossiens qui a le mieux parlé de réconciliation quand elle a déclaré à propos du Christ : Il vous a maintenant réconciliés, par la mort, dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche (Col 1.22). Si devant Dieu je sais saint, sans défaut et sans reproche, alors je peux accepter l’autre tel qu’il est, et l’aimer jusque dans ses défauts.
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – La parabole du fils prodigue
La parabole du fils prodigue nous offre une belle illustration de ce qu’est la réconciliation dans la Bible lorsque le Père accueille son fils rebelle en le restaurant dans son statut de fils et en organisant un banquet pour célébrer son retour à la maison.
Il en est un qui n’est pas encore réconcilié, c’est le fils aîné qui est jaloux de la bienveillance du père à l’égard de son frère. Le père lui offre la réconciliation en allant vers lui et en lui proposant de partager la fête, mais la parabole se termine par des points de suspension, on ne sait qu’elle a été la réponse de l’aîné.
Le Christ nous offre sa réconciliation, mais il nous appartient de la vivre avec ceux qui nous entourent.
Le texte de Josué du 30 mars (Josué 5.9-12)
La première Pâque
Le contexte – Le livre de Josué
Le livre de Josué raconte la conquête et l’installation en terre promise qui est le commencement de la concrétisation de la promesse de l’alliance faite aux patriarches : Je vous donnerai une descendance et une terre.
Le chapitre 5 évoque la transition entre l’économie du désert marquée par l’intervention massive de Dieu qui nourrit son peuple avec la manne et qui demande à Moïse de faire jaillir l’eau du rocher quand la soif se fait sentir et l’économie de la terre promise qui est marquée par la responsabilité du peuple qui doit prendre en charge son organisation et sa survie.
Le passage qui précède notre texte raconte que Josué le Seigneur a demandé à Josué de circoncire les Israélites. Les commentaires disent que le rite a été oublié pendant la période du désert. La circoncision est le signe que les Israélites entreprennent la conquête dans le registre de l’alliance.
Que dit le texte ? – La première Pâque
Après la circoncision le récit de ce dimanche raconte la première Pâque en terre promise. La circoncision et la Pâque sont les marqueurs identitaires des Israélites.
La Pâque est la fête qui célèbre la libération et la sortie de l’esclavage. Les enfants d’Israël n’ont pas encore conquis la terre, mais ils doivent faire mémoire de la libération. On se souvient que Moïse avait déjà donné les instructions concernant la Pâque alors que le peuple était encore en Égypte (Ex 13.5-10)
Le texte précise qu’à cette occasion la manne a cessé, ce qui correspond à la sortie de l’économie de l’Exode dans laquelle le Seigneur pourvoyait aux besoins de son peuple pour entrer dans l’économie de la responsabilité humaine.
Quel est le lien avec le passage de l’Évangile ? – La parabole du fils prodigue
La parabole du fils prodigue commence avec l’image d’un Dieu qui laisse la liberté à son peuple comme le père laisse partir son fils avec sa part d’héritage alors qu’il sait qu’à ce moment de son histoire c’est un fils rebelle qui va dilapider la fortune de son père. Comme dans notre texte, elle souligne la responsabilité des humains.
Mais la parabole se termine avec un repas de fête. Il est généralement interprété comme la célébration du retour du fils, mais nous pouvons aussi l’interpréter comme la célébration du pardon de Dieu qui accueille l’enfant rebelle et le réintègre comme fils bien-aimé.
Le repas de la parabole ressemble alors à celui de la Pâque qui célèbre la libération de Dieu.
Production : Fondation Bersier – Regards protestants
Intervenants : Antoine Nouis, Christine Pedotti