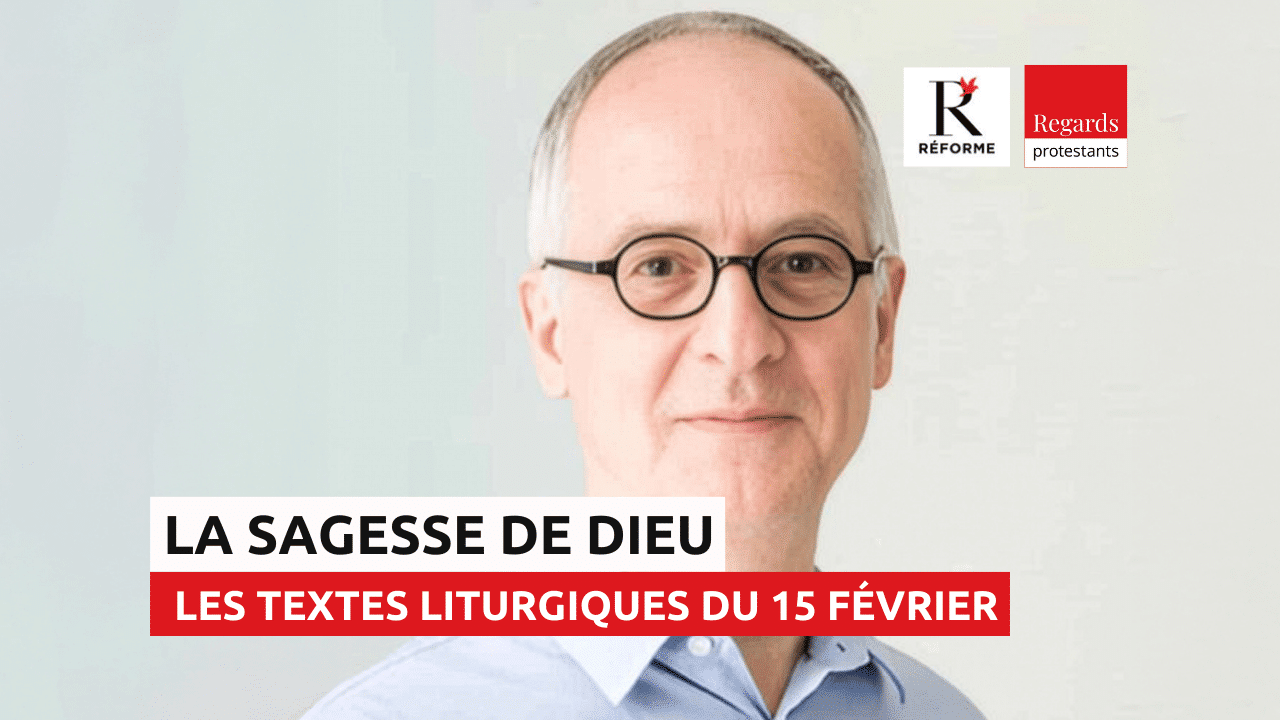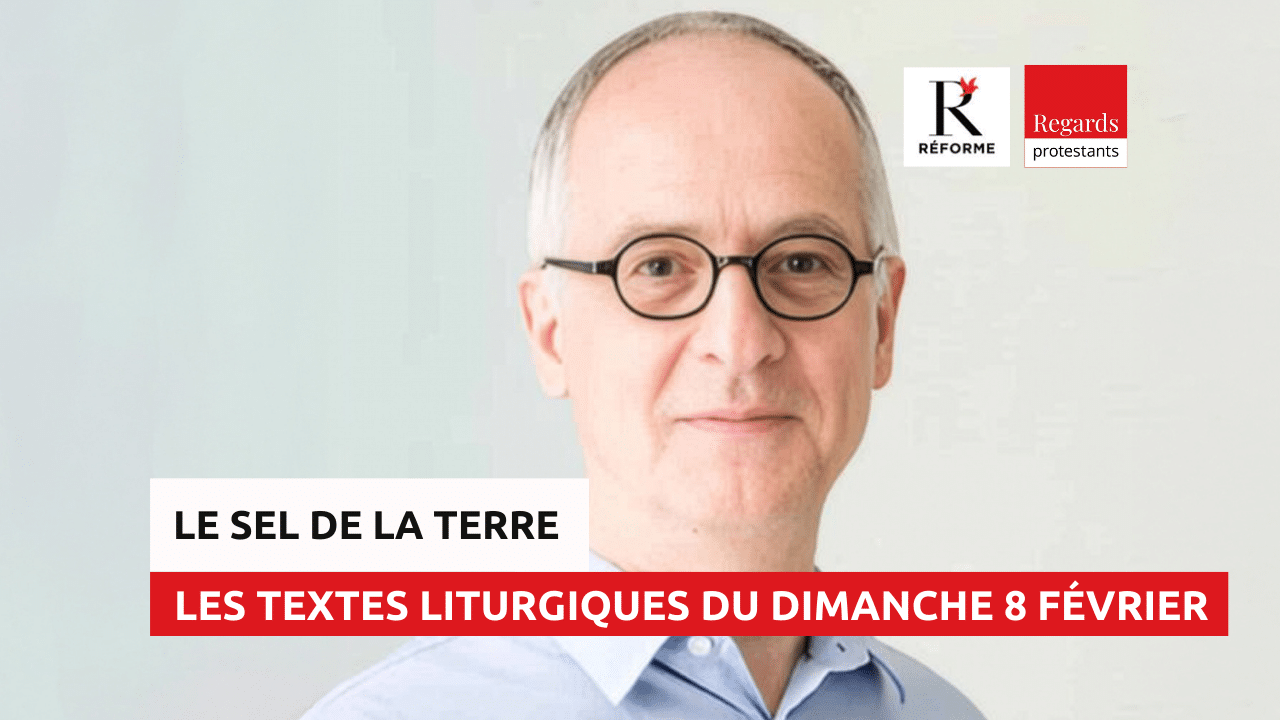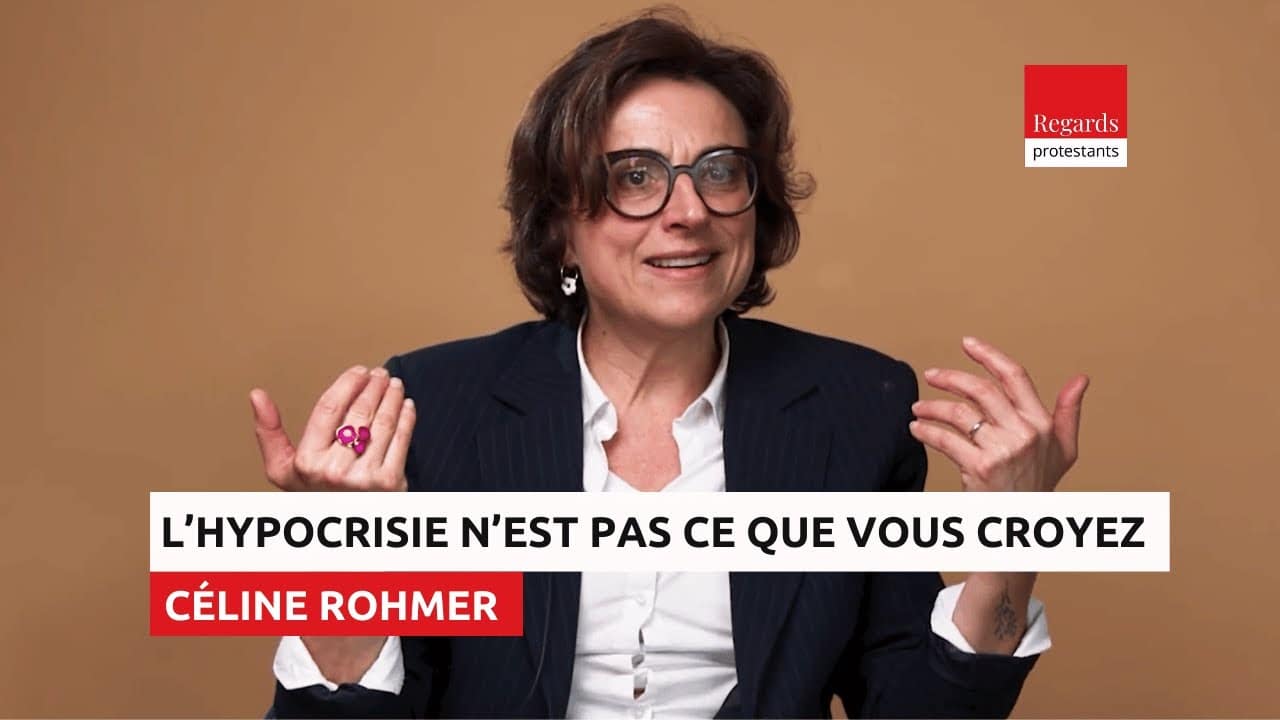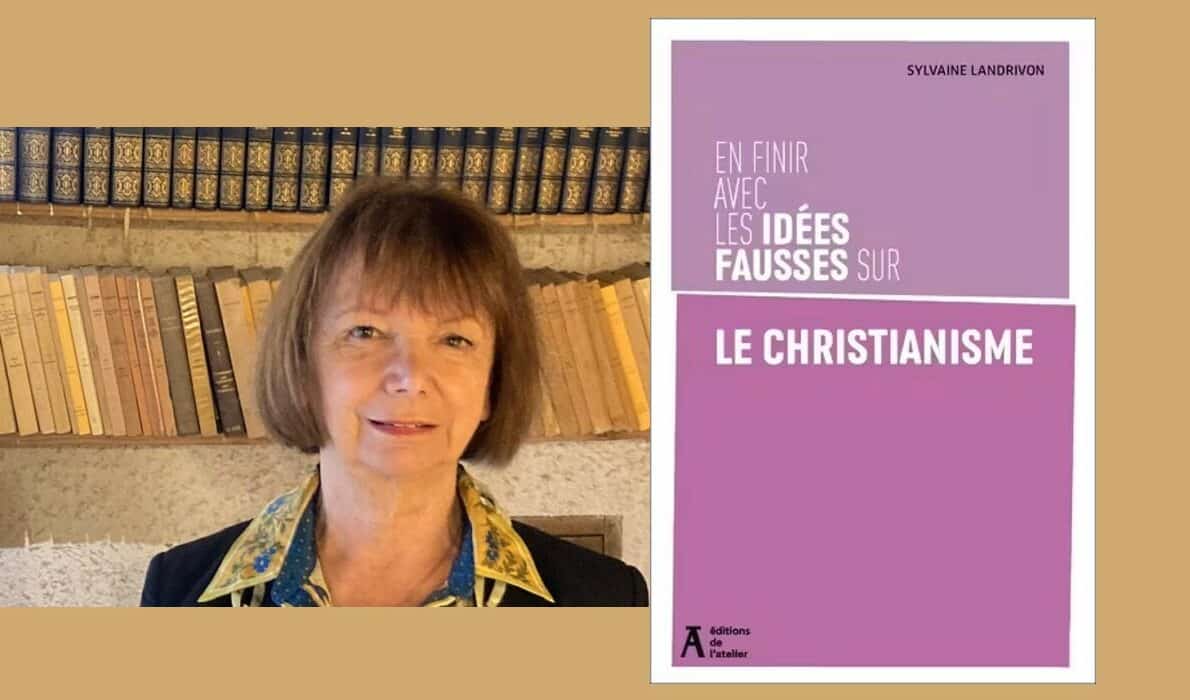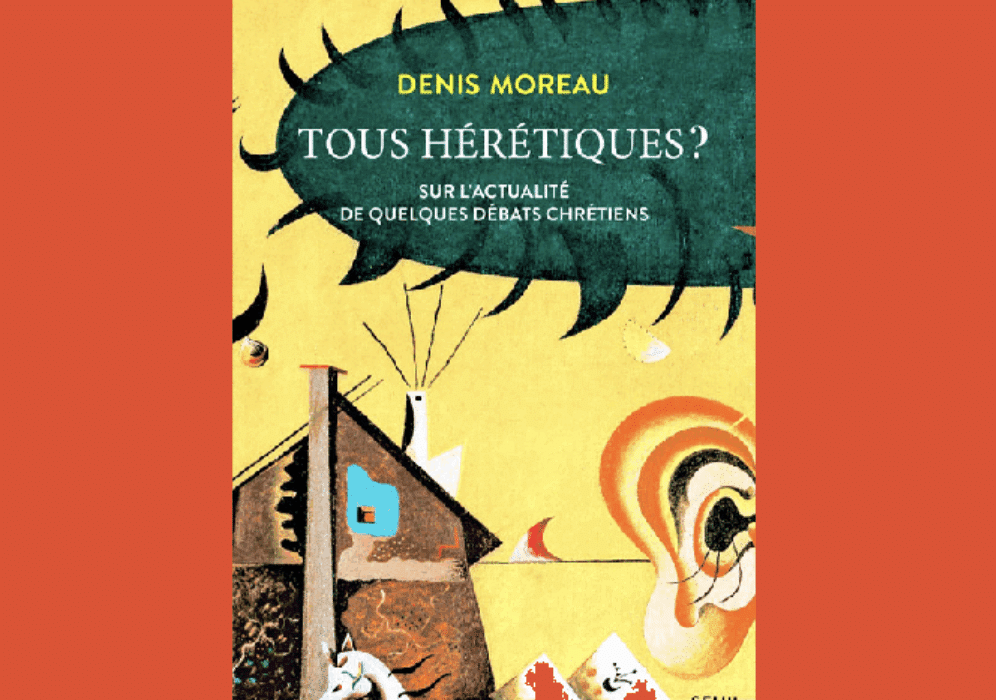Le mythe du “sauveur blanc” : repenser nos bonnes intentions
« Ce mythe du sauveur blanc, c’est la tendance qu’ont certaines personnes à vouloir sauver les autres », explique calmement Josiane Ngongang. Créatrice du podcast I Have a Dream, la communicante et théologienne explore dans ses entretiens les héritages invisibles des rapports de domination culturelle, religieuse et raciale. Un travail de déconstruction nécessaire à l’heure où les mots “aider”, “transmettre” ou “soutenir” charrient encore, parfois inconsciemment, un imaginaire de supériorité.
Ce concept, popularisé dans le monde anglophone, décrit la posture adoptée par certaines personnes ou institutions occidentales persuadées d’avoir une mission civilisatrice. « L’idée d’aller porter la lumière, la culture ou la foi à ceux qui seraient “dans l’ombre” n’a pas disparu », souligne Josiane Ngongang. Elle cite l’exemple d’une jeune Américaine partie en Ouganda pour ouvrir un orphelinat et soigner des enfants sans avoir aucune formation médicale — un geste présenté comme altruiste, mais dont les conséquences ont été dramatiques.
Cette logique traverse aussi nos imaginaires collectifs. Le cinéma, note-t-elle, reproduit souvent le schéma du héros blanc venu sauver des populations noires ou opprimées. « Dans Les Figures de l’ombre, on voit un patron blanc venir “libérer” trois mathématiciennes afro-américaines. Dans la réalité, cette scène n’a jamais existé. » Ce besoin de placer un personnage blanc au centre du récit illustre la difficulté à reconnaître pleinement l’autonomie et la compétence des autres.
Dans son travail, Josianne Ngongang cherche à ouvrir un espace d’écoute et de décentrement. Elle recommande notamment deux ouvrages marquants : God is not a White Man de Chine McDonald et Reading While Black de Esau McCaulley. Le premier explore les représentations de Dieu dans une culture majoritairement blanche et la manière dont elles influencent la foi et les relations humaines. Le second relit la Bible à travers l’expérience afro-américaine, pour montrer comment l’espérance chrétienne peut renaître malgré l’histoire de l’esclavage et du racisme.
Ces lectures, explique-t-elle, sont essentielles pour renouveler nos pratiques spirituelles : « Il ne s’agit pas de culpabiliser, mais de comprendre comment nos schémas culturels façonnent notre rapport à Dieu et à l’autre. » En invitant à la fois à la vigilance et à la curiosité, Josianne Ngongang propose une théologie de l’humilité : celle qui apprend à “aimer sans sauver”.
Son podcast “I Have a Dream” est une série pour repenser la foi, la justice et les rêves collectifs.
Production : Fondation Bersier – Regards protestants
Remerciements : Josiane Ngongang
Entretien mené par : David Gonzalez
Technique : Horizontal pictures