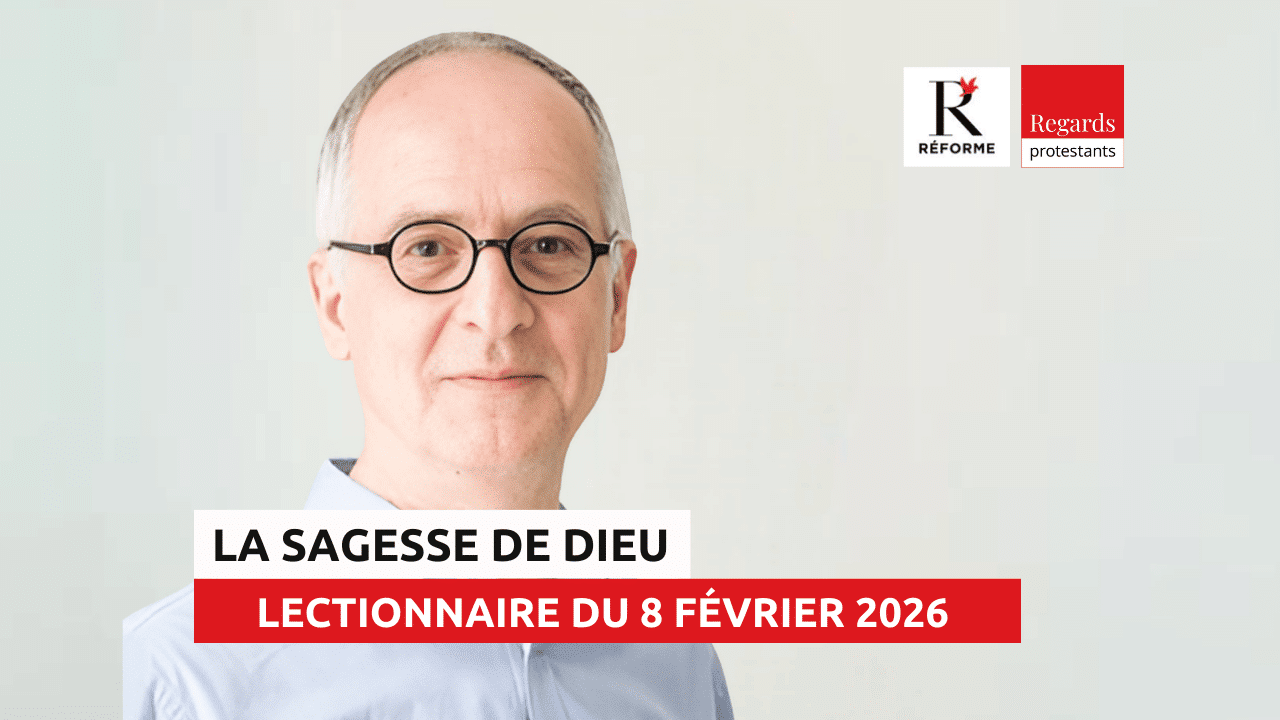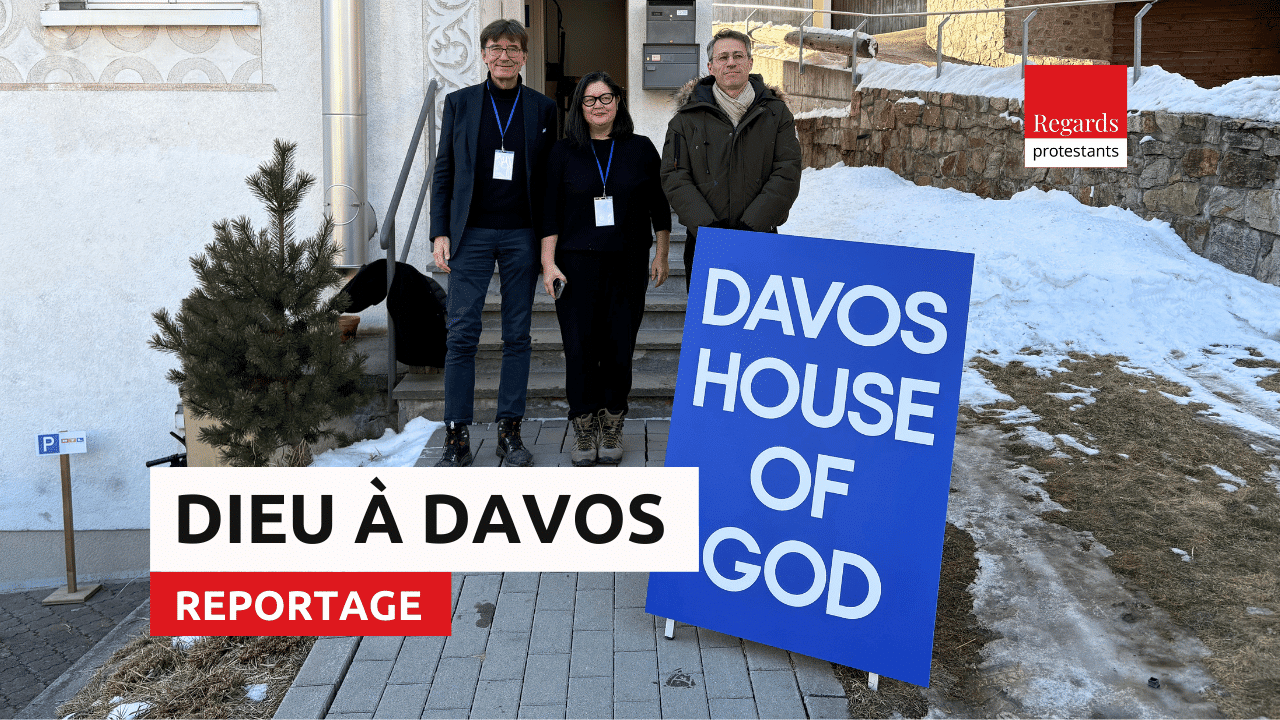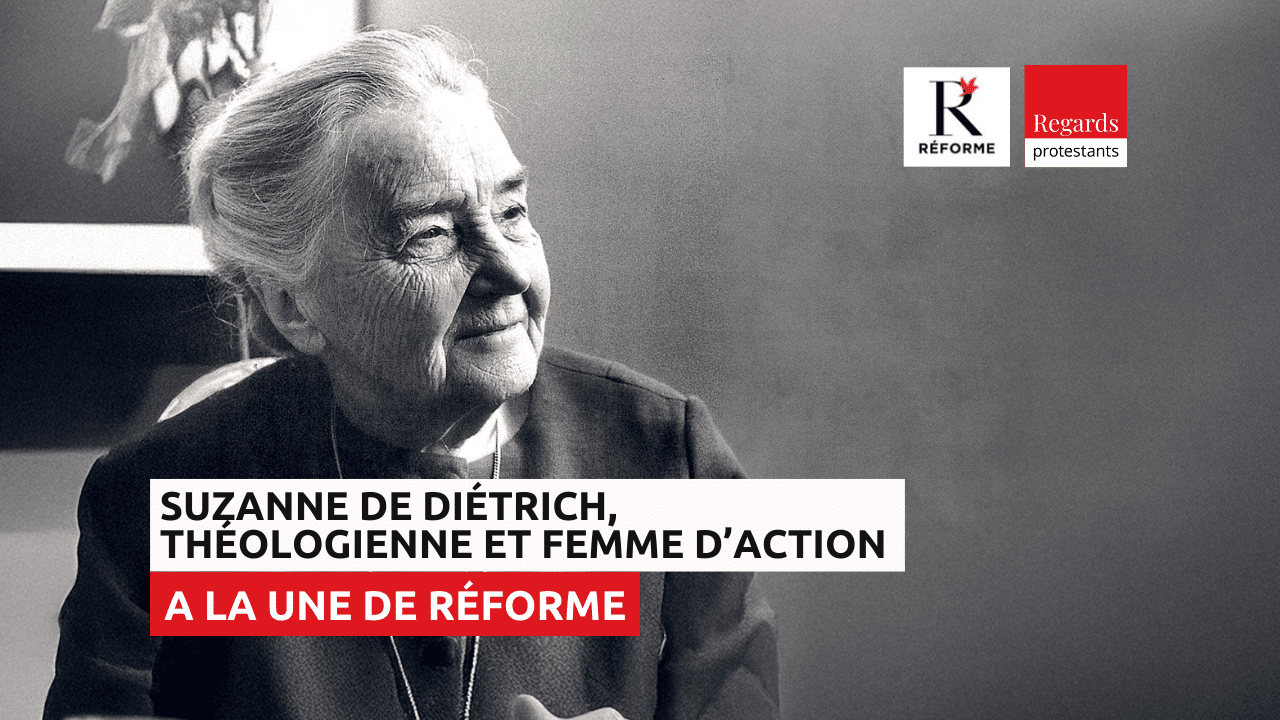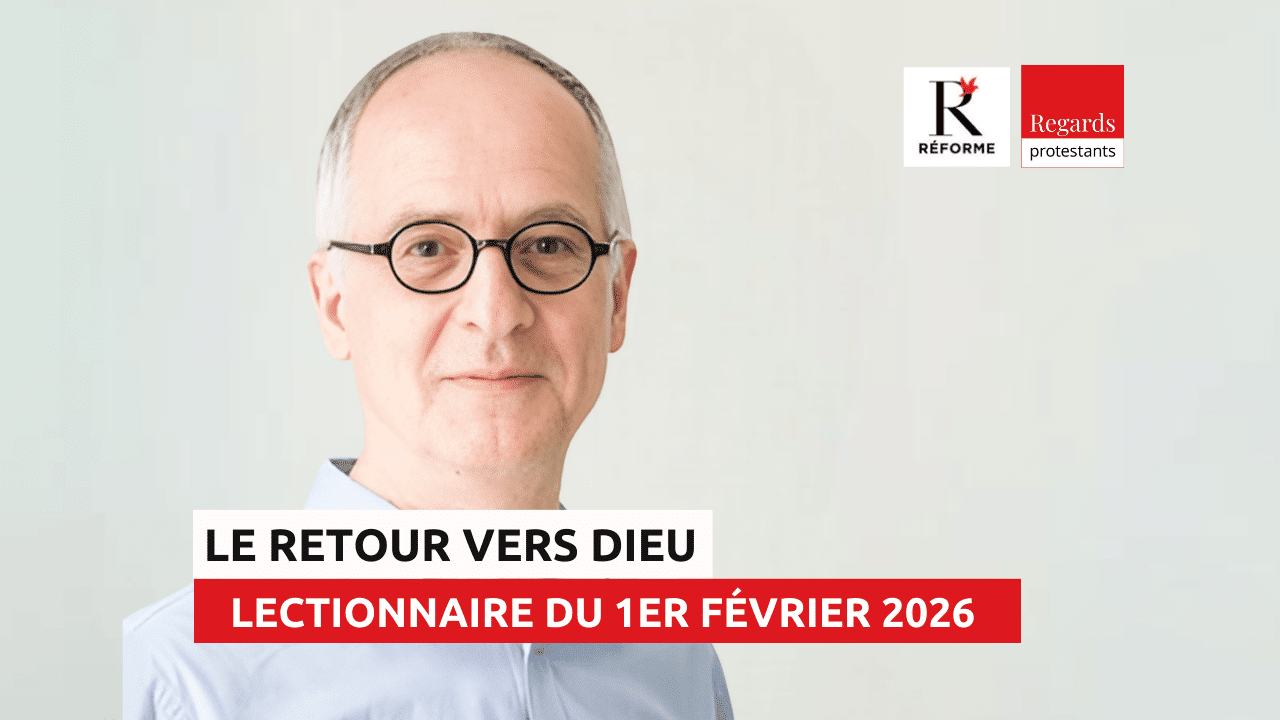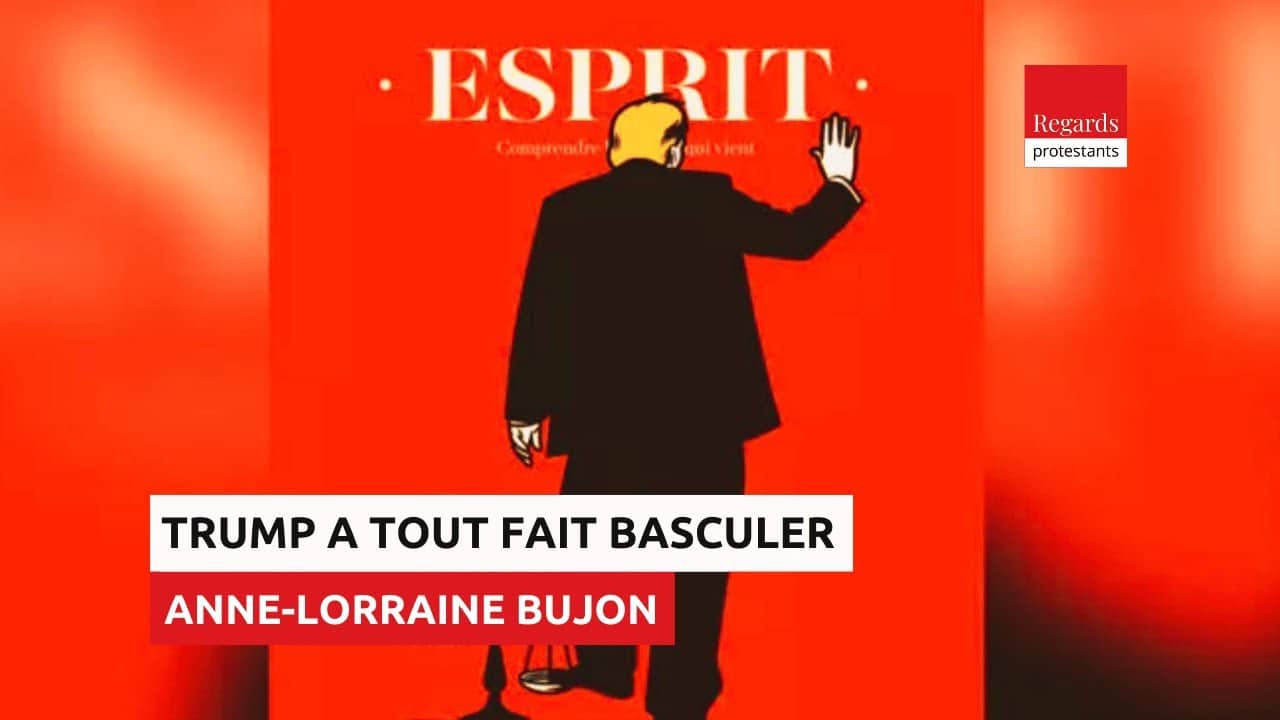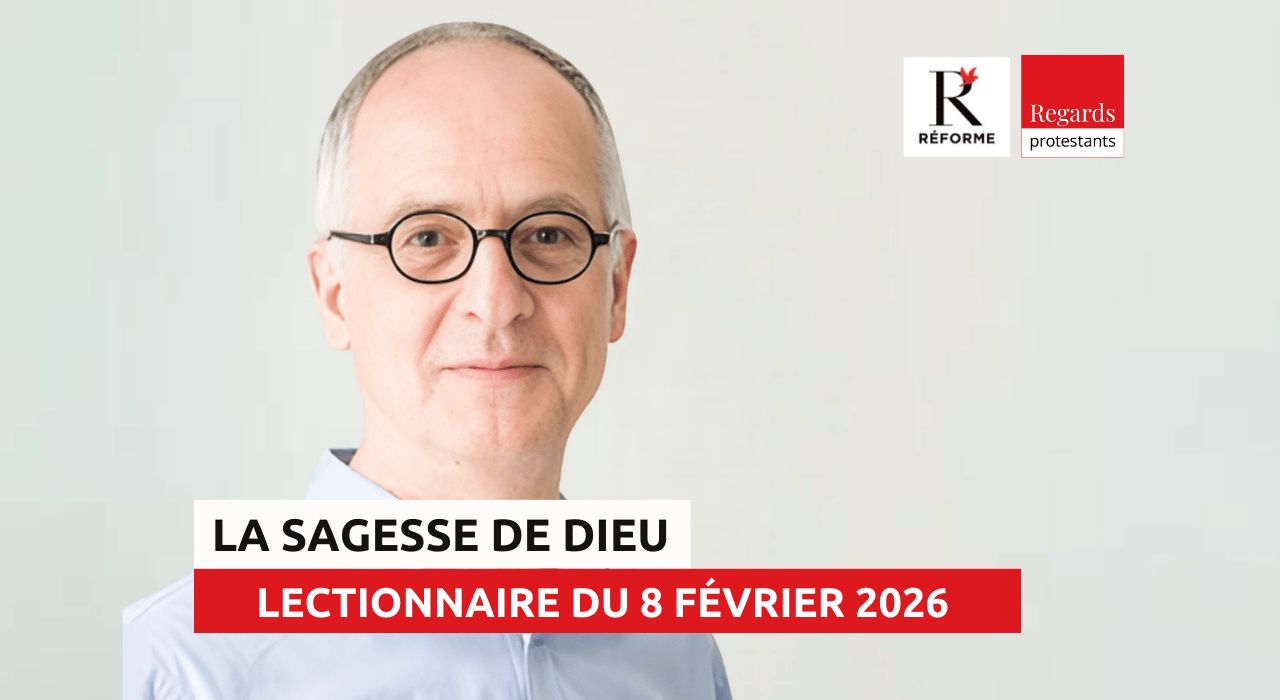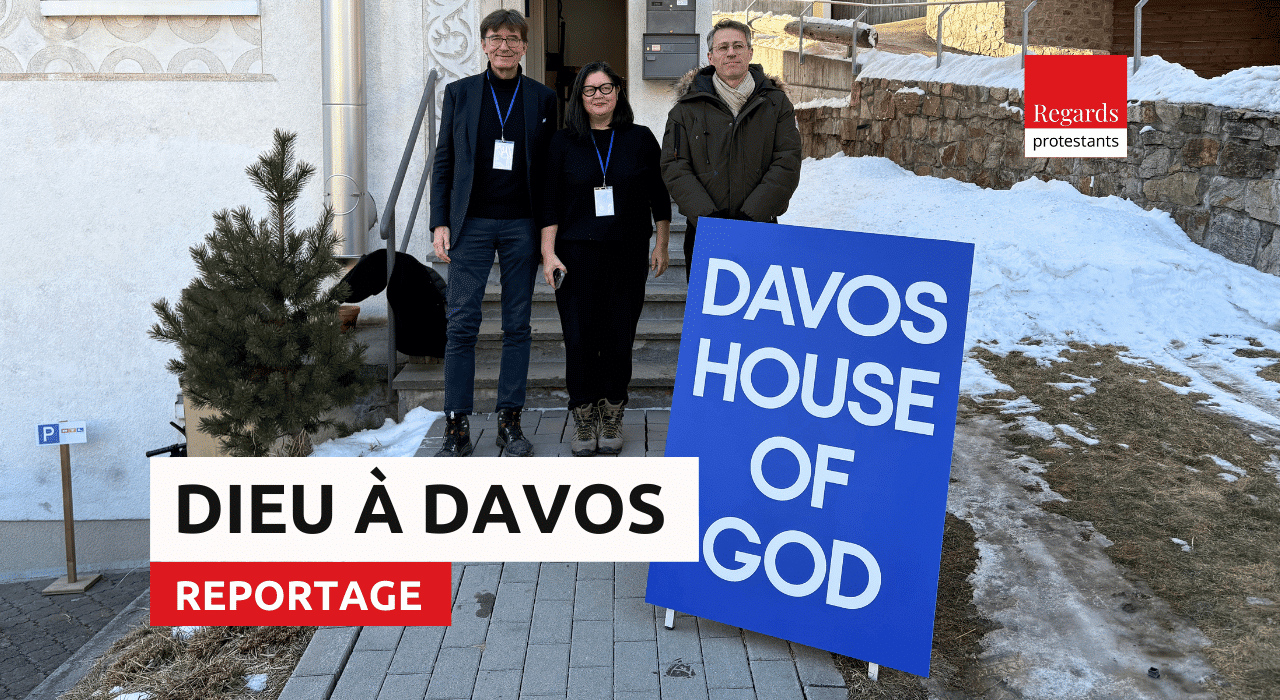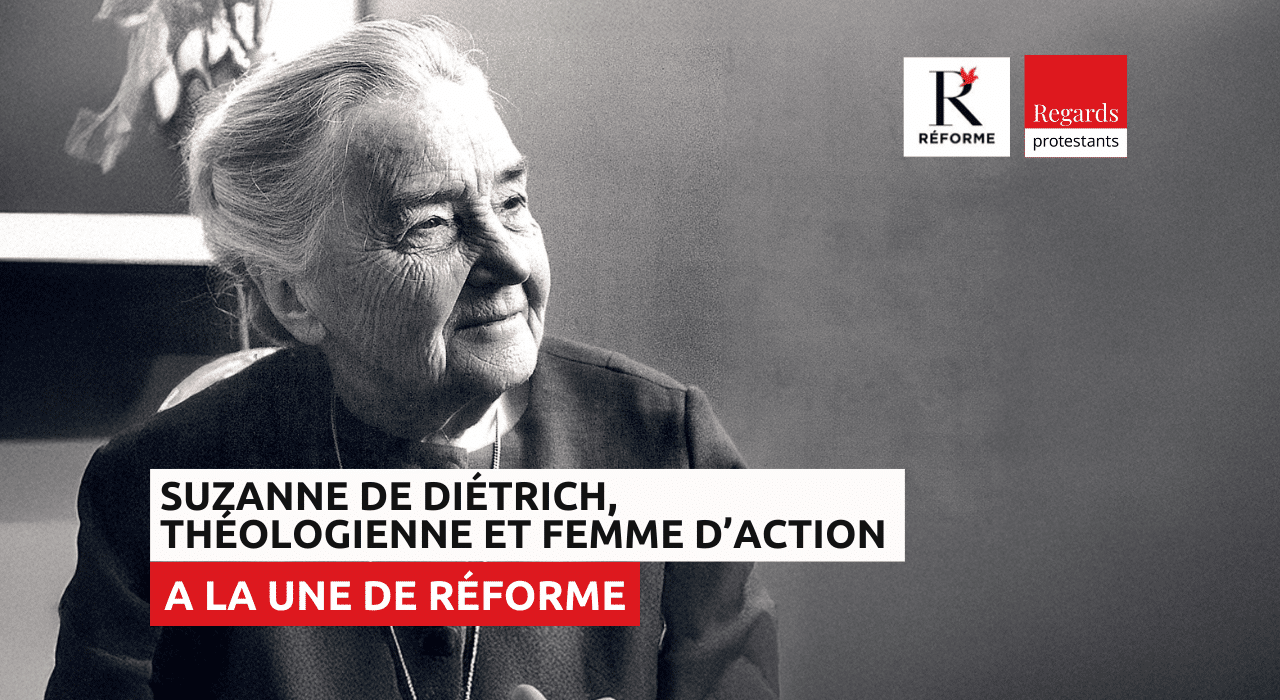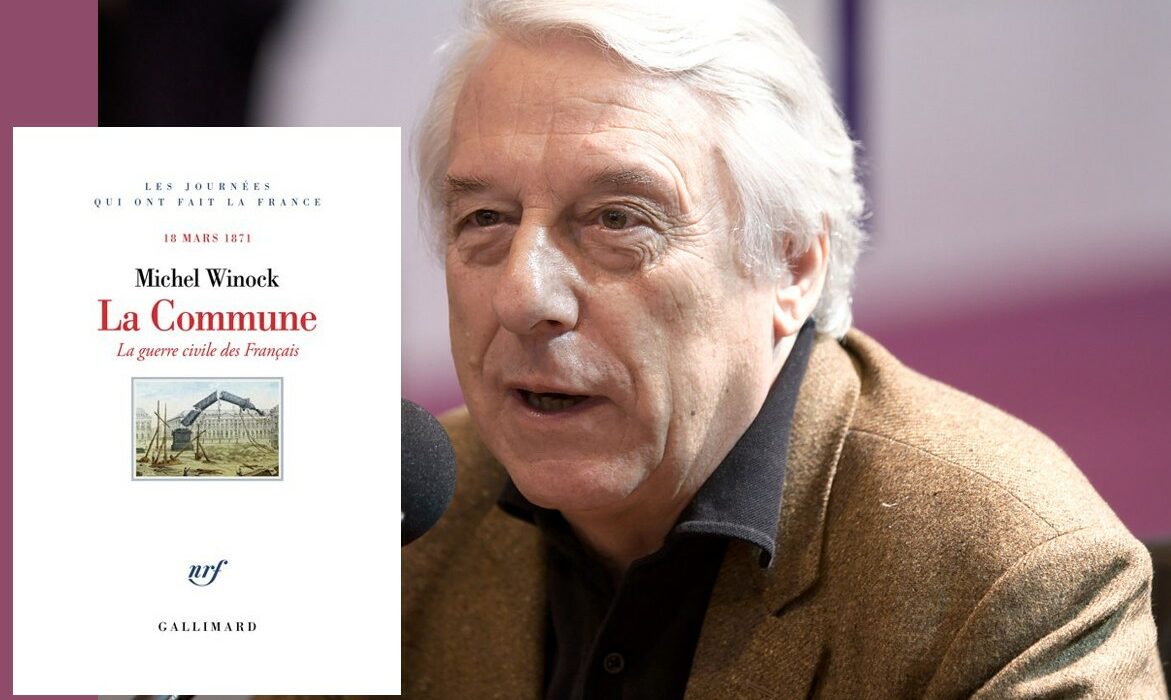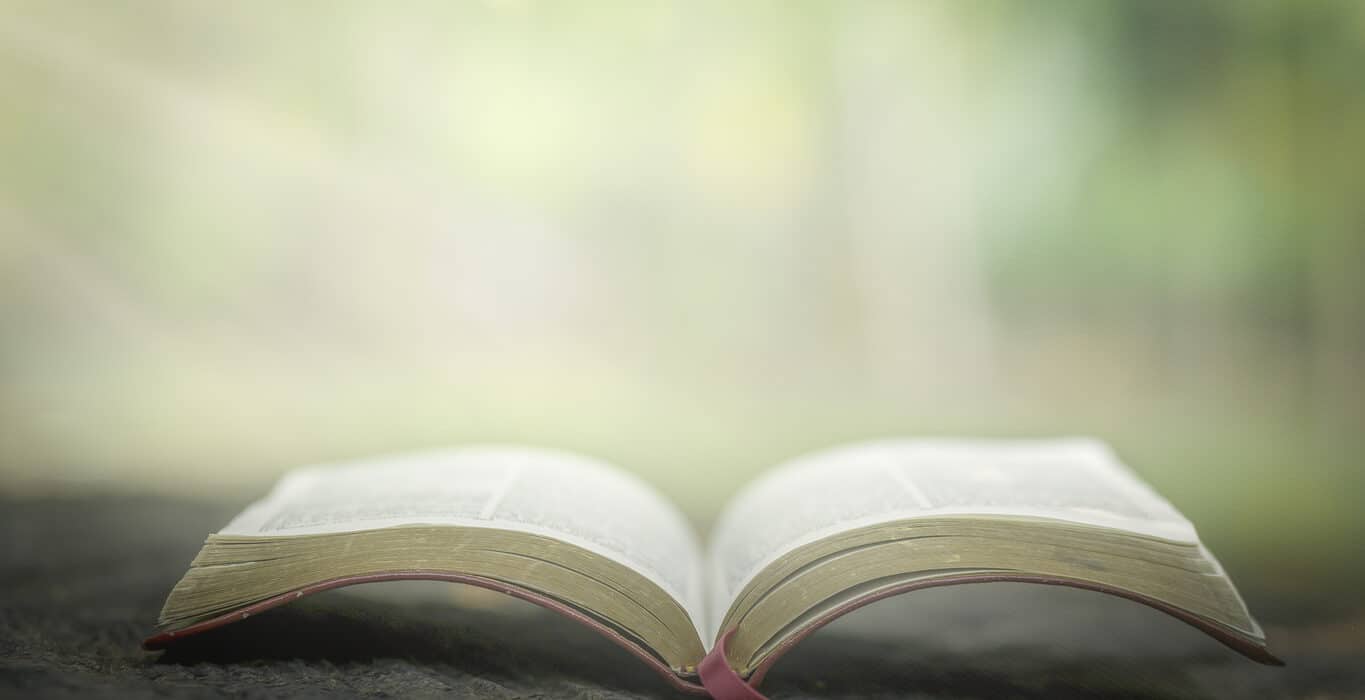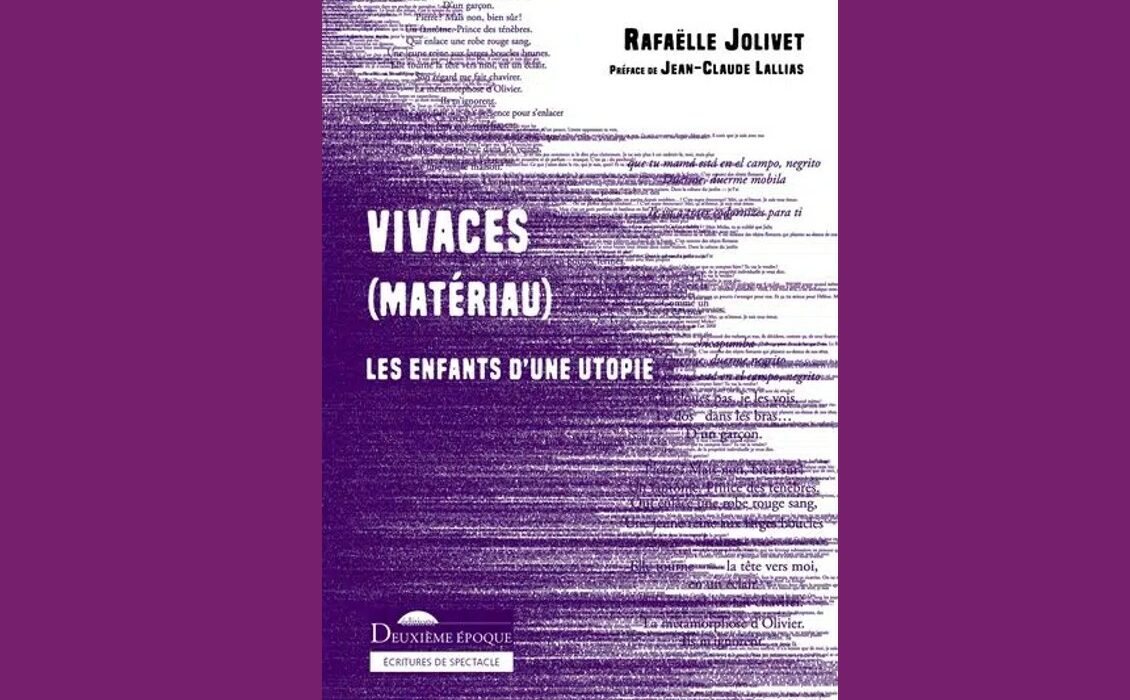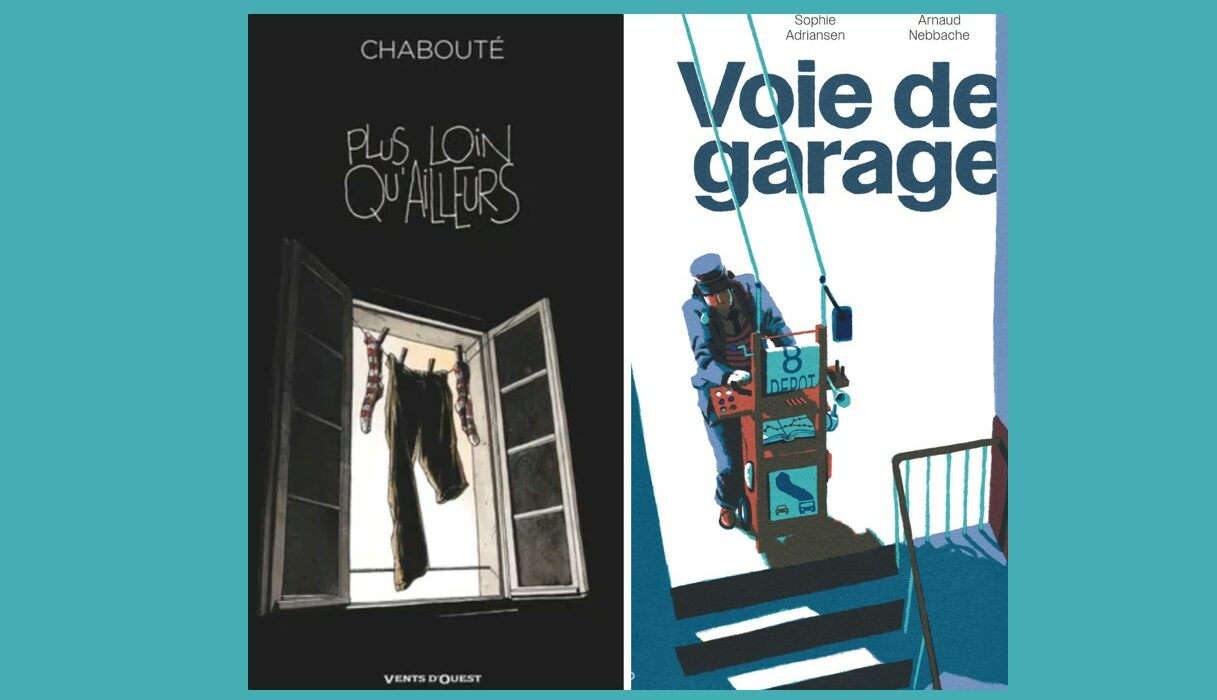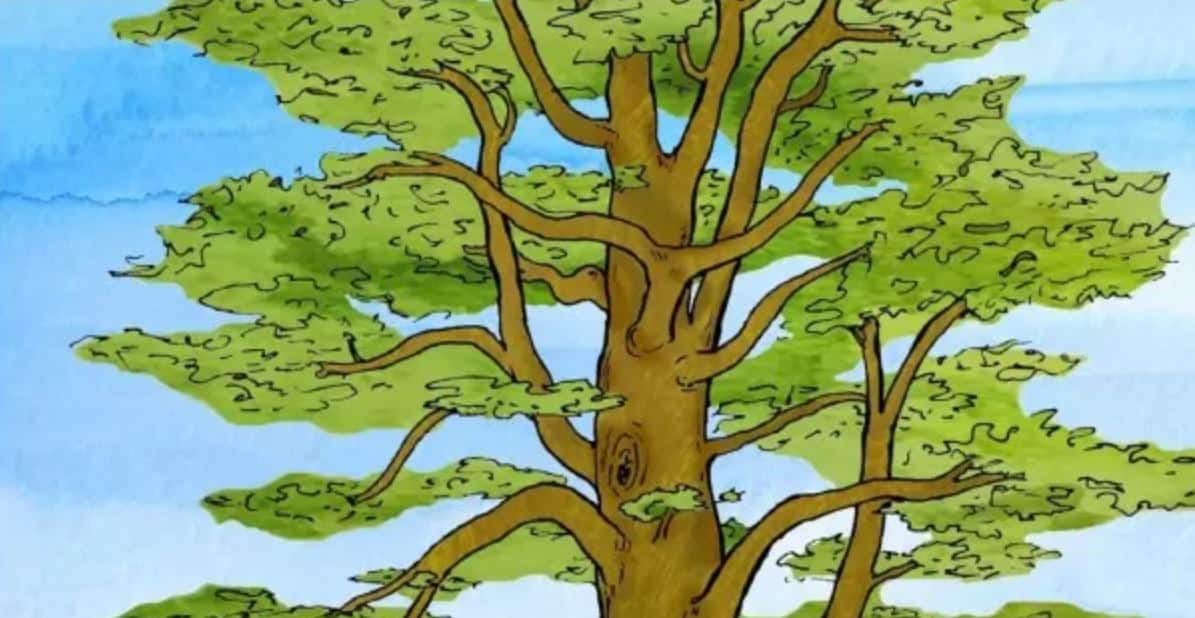Cette rentrée 2025 met sous les projecteurs les fresques familiales, et plus précisément les parents. Pères et mères, figures tutélaires ou ombres écrasantes, sont en effet au cœur de nombreux récits.
La littérature a toujours su se nourrir du roman familial. On pense à Albert Cohen et à son bouleversant Livre de ma mère, à Romain Gary dans La promesse de l’aube ou encore Marcel Pagnol avec La gloire de mon père. Et la liste est longue : les hommages à Papa et Maman traversent les siècles et les styles.
Ainsi, cette année, les écrivains contemporains poursuivent cette tradition. Emmanuel Carrère, avec Kolkhoze, revient sur l’histoire de sa mère académicienne. Justine Lévy, dans Une drôle de peine, évoque la maladie et la perte de sa mère. Anne Berest revisite l’histoire de son père et de sa lignée paternelle dans l’excellent Finistère. Mathilda di Matteo signe un premier roman intitulé La Bonne mère, qui alterne les points de vue entre une mère et sa fille. Régis Jauffret publie de son côté un roman sobrement intitulé Maman. Pour n’en citer que quelques-uns…
Décidément, les histoires de famille ont de quoi rendre jalouse la fiction !
C’est dans ce contexte que j’ai choisi de vous parler d’un livre qui n’appartient pas à la rentrée littéraire, puisqu’il est paru en janvier dernier aux éditions du Rocher, mais qui y aurait parfaitement trouvé sa place par son thème. Il s’agit d’un premier roman intitulé Un jour, il n’y aura plus de pères, signé par David Frèche.
Le roman raconte le cheminement d’Adam Fier, quadragénaire en crise existentielle. Fils d’un père flamboyant, brillant homme d’affaires et esthète volcanique, Adam se trouve à un moment charnière de sa vie : il vient de devenir père, mais sa paternité s’accompagne de la dépression de son épouse et d’une séparation douloureuse. Au mitan de son existence, il ressent le besoin impérieux de retourner aux origines, d’enquêter sur le meurtre mystérieux de son grand-père Georges, abattu en pleine rue à Alger en 1957.
Commence alors une véritable archéologie familiale. Adam fouille les archives, exhume des photos, interroge des témoins. Ce faisant, il remonte le fil d’une histoire marquée par la guerre d’Algérie et surtout par les fractures de la mémoire collective. Un livre prenant, aux accents autobiographiques, qui nous entraîne dans une quête intime.
Dans ce récit, la figure paternelle est bien sûr omniprésente. Georges, le grand-père assassiné. Pierre, le patriarche charismatique, aimé et admiré par son fils. Et Adam lui-même, devenu père à son tour, qui est amené à réfléchir à ce qu’il transmettra à son fils James. Ce cycle de filiation est au cœur du roman, et il est traversé de zones d’ombre, de silences, de non-dits.
Comme l’écrit Frèche :
« La vérité est là, belle ou laide, elle a le pouvoir de sauver le monde, mais elle est découpée en petits morceaux, stockés dans la mémoire des hommes qui les gardent pour eux. »
Un passage qui m’a particulièrement marqué se déroule lors d’une cérémonie religieuse juive, où Adam est amené à commenter l’épisode biblique de la ligature d’Isaac. Il s’interroge sur le silence du texte : Abraham et son fils ne se reparlent jamais après cet événement. « Avoir un père qui veut égorger son fils et qui l’attache, ce n’est pas rien. Ils auraient pu en parler », lance-t-il. Frèche écrit alors qu’ils créent là « le premier secret de famille ».
Un jour, il n’y aura plus de pères est aussi un roman de la zone grise. Rien n’y est manichéen. La guerre d’Algérie elle-même y apparaît dans toute sa complexité. Le roman refuse les caricatures simplistes et nous place face à l’ambivalence, aux contradictions, aux vérités multiples qui façonnent l’être humain.
C’est là sa force : mêler l’intime et l’Histoire, l’héritage familial et la mémoire collective.
Avec ce beau premier roman, David Frèche signe un texte sensible, dense, qui nous invite à réfléchir à ce que nous recevons de nos pères et à ce que nous transmettrons à nos enfants.
Le roman se conclut par ailleurs avec une magnifique lettre qu’Adam adresse à son fils James
et qui reprend cette idée d’une transmission libératrice :
« Le flambeau qu’un père tend à son fils peut assombrir sa vie en l’empêchant. Je veux que cette torche que je mets dans ta main te réchauffe pour toujours de l’intérieur. Que cette petite flamme que tu sentiras brûler soit un logis éternel. Avec cette petite lampe, tu pourras aimer tout ce que tu veux de neuf et rejeter ce que tu veux d’ancien.
Détruire tout est une folie, ne rien ajouter un échec ou du moins d’un grand ennui.
J’aurais pu t’écrire tout ce que les pères peuvent écrire à leur fils : bien sûr, mon fils, nous irons en haut des montagnes et parcourrons les mers.
Toi aussi, si tu le souhaites, tu nageras jusqu’à la tête de chien, mais tout ce qui fait partie de
mon histoire n’est qu’un champ des possibles. »
Un roman sur la mémoire, la filiation, et sur ce fil fragile qui relie les générations entre elles,
à découvrir donc avant de plonger dans les (nombreux) romans de cette rentrée littéraire !
Production : Fondation Bersier – Regards protestants
Remerciements : Camille Perrier
Entretien mené par : David Gonzalez
Technique : Horizontal pictures