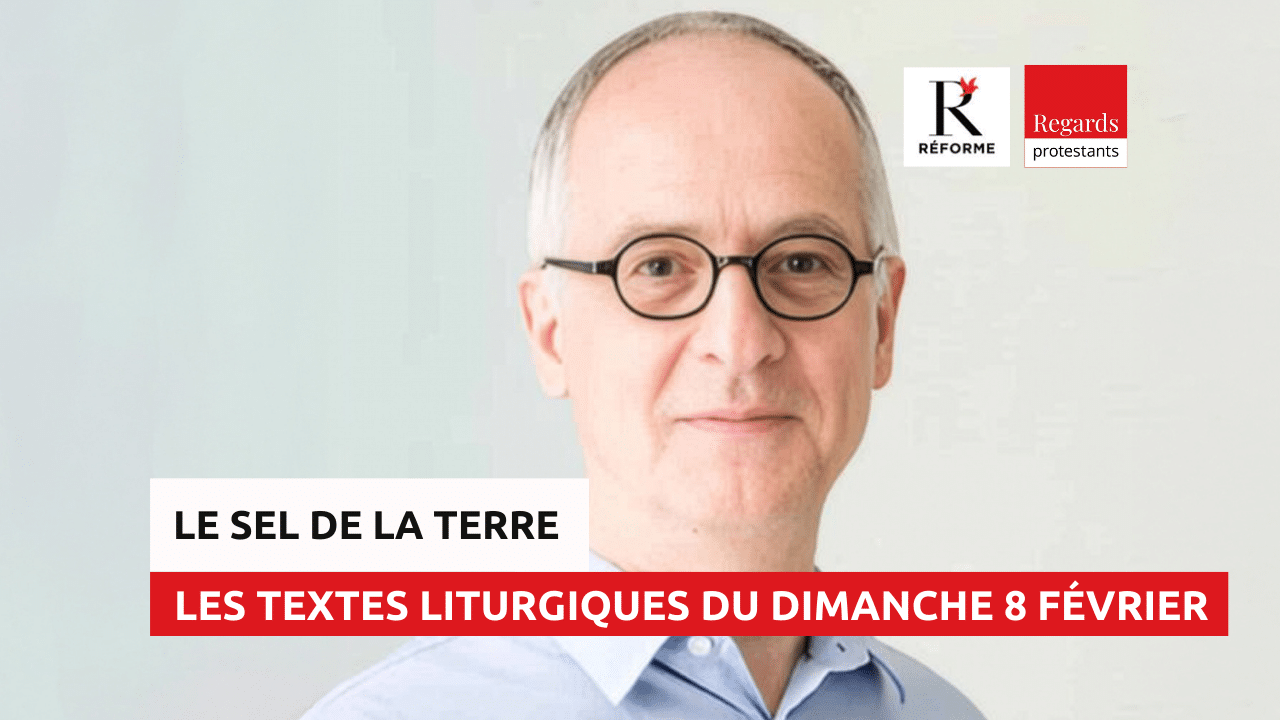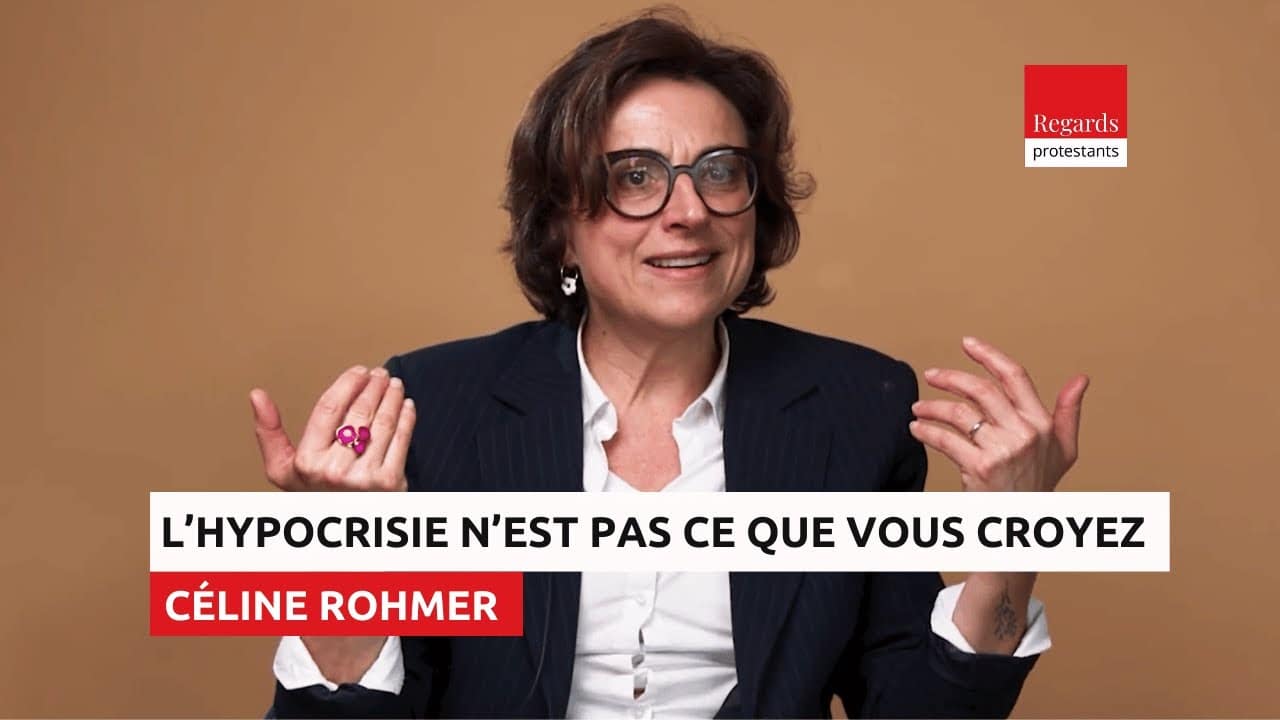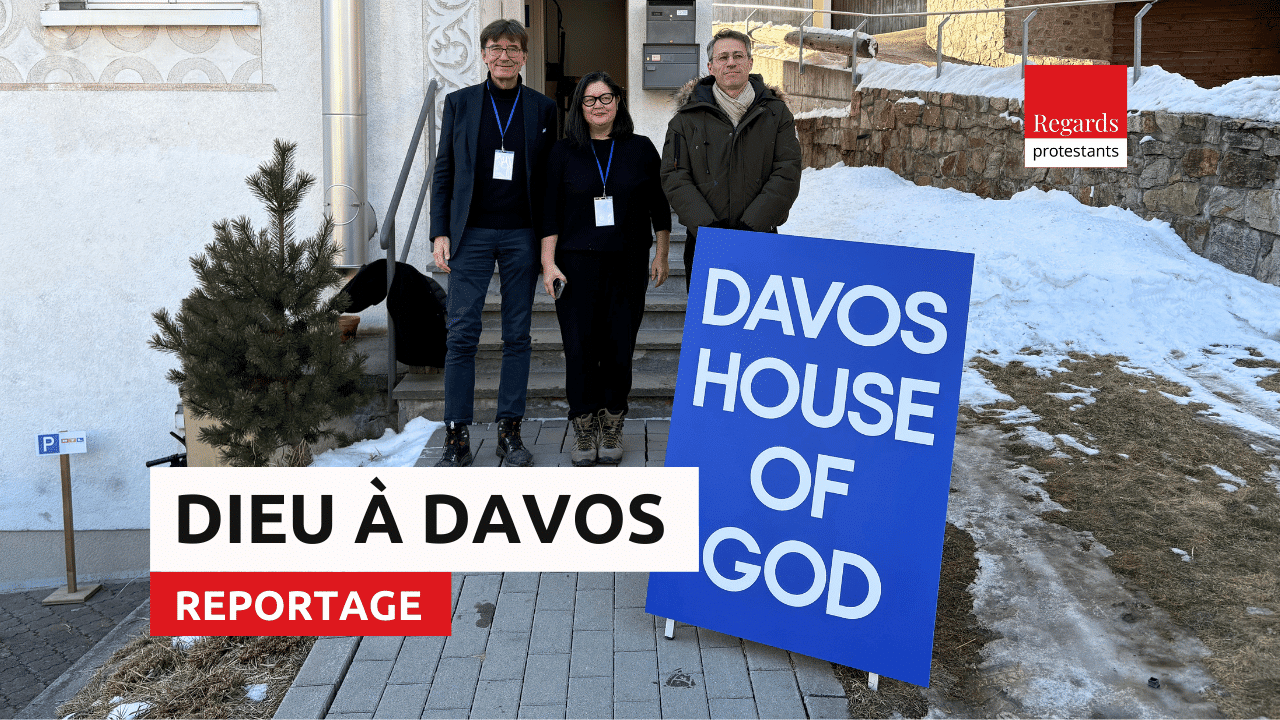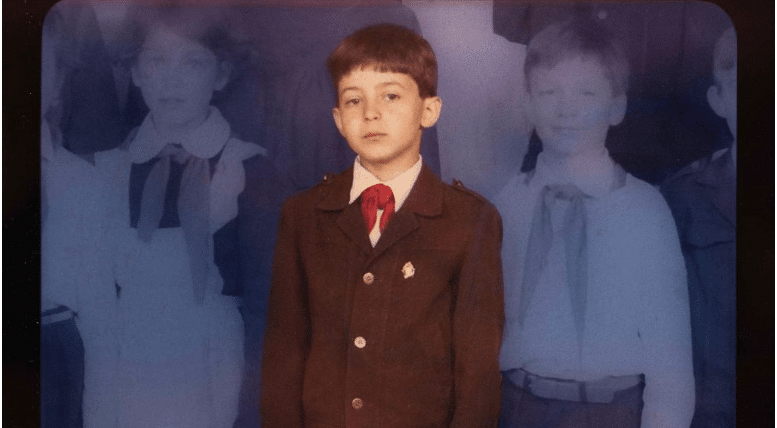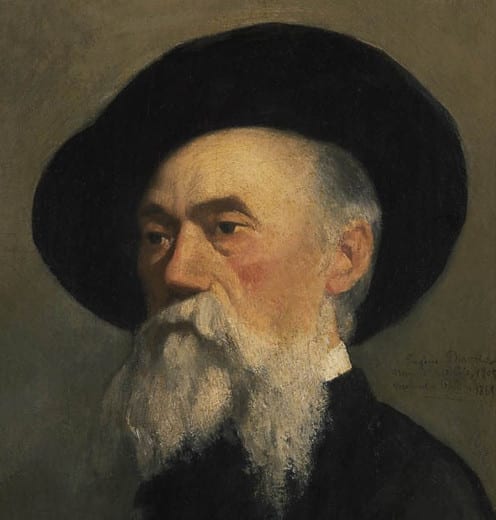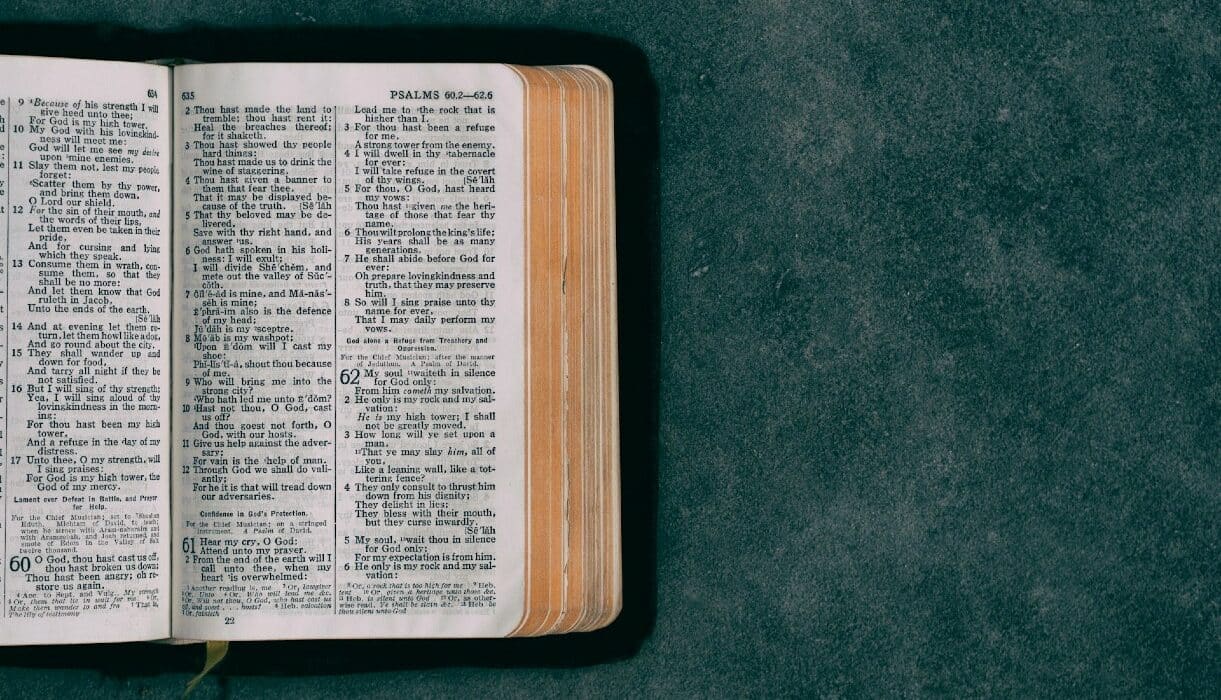Le 26 octobre 1553, Michel Servet est condamné au bûcher comme hérétique par le Grand Conseil de la république de Genève. Il est brûlé le lendemain à Champel, aux portes de la ville. Pourquoi ce théologien était-il traqué par les catholiques comme par les réformés ? Quelle était sa théologie ?
Avant l’affaire : l’hérésie dans la chrétienté
Depuis les origines, dès que l’on fixe une orthodoxie, surgissent des courants hétérodoxes qualifiés d’hérésie (du grec héterodidaskalein : « enseigner autrement »). À partir de l’Antiquité tardive, surtout sous Théodose, puis tout au long du Moyen Âge, l’hérétique est traqué car perçu comme une double menace : il rompt l’unité de l’Église et fragilise l’ordre social, dans une société où religieux et politique forment un bloc.
La Réforme du XVIᵉ siècle ne change pas ce cadre : au contraire, l’effervescence religieuse multiplie prédicateurs, polémistes et « dogmatisateurs errants », redoutés tant par Rome que par les premières institutions protestantes.
Michel Servet, un esprit universel et provocateur
Michel Servet (né près de Saragosse) est médecin, mais aussi astrologue, bibliste, imprimeur et géographe. L’astrologie médicale est alors commune, même si Calvin la pourfendra plus tard dans son traité contre l’« astrologie judiciaire ». Esprit brillant, Servet nourrit un projet radical : un « monothéisme de synthèse ».
Marqué par l’Espagne de l’après-Reconquista, où coexistent encore minorités juives et musulmanes, il estime que l’obstacle majeur au rapprochement est la Trinité. D’où ses écrits retentissants, notamment De Trinitatis Erroribus (Des erreurs de la Trinité), qui le dressent contre toutes les chrétientés instituées – Rome, Wittenberg, Genève.
Fascination et heurts avec Calvin
Servet se polarise sur Calvin — figure montante de la Réforme, jeune, brillant, auteur d’une Institution devenue best-seller, et artisan d’une réorganisation religieuse à Genève. Servet tente Strasbourg (où Bucer finit par l’écarter), puis Bâle, sans succès.
S’ouvre alors une correspondance avec Calvin autour d’un second grand ouvrage, la Restitution du christianisme, écrit en réponse à l’Institution de la religion chrétienne. Le ton devient provocateur : Servet renvoie des feuillets de l’Institution barrés et annotés d’invectives. Calvin met fin aux échanges. Servet les reproduira en annexe de sa Restitution, s’affichant comme interlocuteur d’égal à égal du réformateur genevois.
Dénonciation, arrestation à Vienne… et fuite
Établi à Vienne (Dauphiné) comme médecin, Servet publie sa Restitution. Il est dénoncé à l’Inquisition et arrêté. Un procès s’ouvre ; la condamnation au bûcher tombe. Il s’évade ensuite – fuite facilitée, semble-t-il, par une surveillance lacunaire.
L’épisode alimente rumeurs et soupçons de dénonciation venue de Genève. Quoi qu’il en soit, Servet disparaît plusieurs mois, puis réapparaît à Genève à l’automne 1553.
Genève, 1553 : arrestation et ouverture du procès
Arrivé à Genève, Servet assiste au sermon du temple de la Madeleine, est reconnu, arrêté et inculpé. Le procès n’est pas inquisitorial : il relève d’un tribunal civil saisi sur plainte ecclésiastique, conformément à l’idée, chez Calvin, d’un bras séculier protecteur de la vraie doctrine.
Calvin n’est pas magistrat ; il n’a jamais jugé. Mais il pèse : par la chaire (ses sermons ont valeur d’opinion publique) et par son prestige. Il veut une condamnation, allant jusqu’au chantage à la démission : « si vous n’êtes plus d’accord, je m’en vais ». Dans la Genève réformée, ce levier politique compte.
La controverse doctrinale : la Trinité au banc d’essai
Au cœur du procès : la Trinité. Une joute s’engage entre Servet et Calvin. Les greffiers peinent à suivre l’argumentation technique et finissent par proposer des mémoires écrits. En quelques heures, les deux hommes produisent des traités serrés.
Inégalité criante : Servet, au fond d’un cachot, malade et transi ; Calvin, libre, entouré. La dureté des conditions est un fait de procédure que relèveront plusieurs contemporains.
Condamnation au bûcher et exemplarité punitive
Le verdict tombe : bûcher, peine usuelle contre l’hérésie. Calvin s’oppose aux supplices additionnels (mutilations, langue coupée), comme il l’avait déjà fait dans d’autres affaires (par ex. sorciers de Vandoeuvres).
La Genève réformée se veut exemplaire — quasi « nouvelle Jérusalem ». Sous l’œil scrutateur de l’Église catholique européenne, la cité entend montrer sa cohésion doctrinale. Servet, en pleine conscience, semble assumer la logique du martyre : suivre le Christ jusqu’au bout pour « faire triompher la vérité ».
Réceptions et critiques : la faille morale
Dès l’origine, l’exécution suscite protestations : à Genève (où Calvin a des adversaires, les « libertins » partisans des franchises civiques), et dans d’autres Églises suisses sollicitées pendant l’instruction. Plusieurs soutiennent la sentence ; d’autres, comme le Bernois Zurkinden, perçoivent une impasse morale.
Dans un climat encore humaniste, l’affaire donne l’image d’un déséquilibre entre « moucheron et éléphant » : un dissident isolé face à une machine institutionnelle.
Calvin se justifie (1554)
Face aux polémiques, Calvin publie en 1554 sa Défense de la vraie foi (à la suite du bûcher d’octobre 1553), exposant les motifs théologiques et politiques de la condamnation : protection de l’Église, sauvegarde de la vérité, responsabilité du magistrat civil.
Reste l’énigme d’un Calvin à la fois juriste de la parole et politique malgré lui : inventeur d’un ordre scripturaire (académie, formation, langues bibliques) mais, en l’occurrence, acculé à une issue que nombre de contemporains — et la postérité — jugeront moralement intenable.
Ce qu’enseigne l’affaire Servet
L’« affaire Servet » dévoile la tension constitutive des Réformes : tenir ensemble liberté de conscience, unité ecclésiale et paix civile. Servet, théologien anti-trinitaire et provocateur, a heurté de plein fouet un monde où doctrine et ordre public ne font qu’un.
Genève en sort durablement marquée ; Calvin aussi, sommé de justifier l’injustifiable aux yeux de beaucoup. L’épisode restera l’un des nœuds éthiques majeurs du protestantisme naissant.
Allez directement aux chapitres :
0:20 L’affaire Michel Servet
16:20 Pourquoi Servet se rend-t-il à Genève ?
21:36 Servet est brulé et ça ne dérange personne ?
Pour aller plus loin :
Production : Fondation Bersier
Journaliste : Jean-Luc Mouton
Réalisation : horizontal pictures
Invité : Vincent Schmid