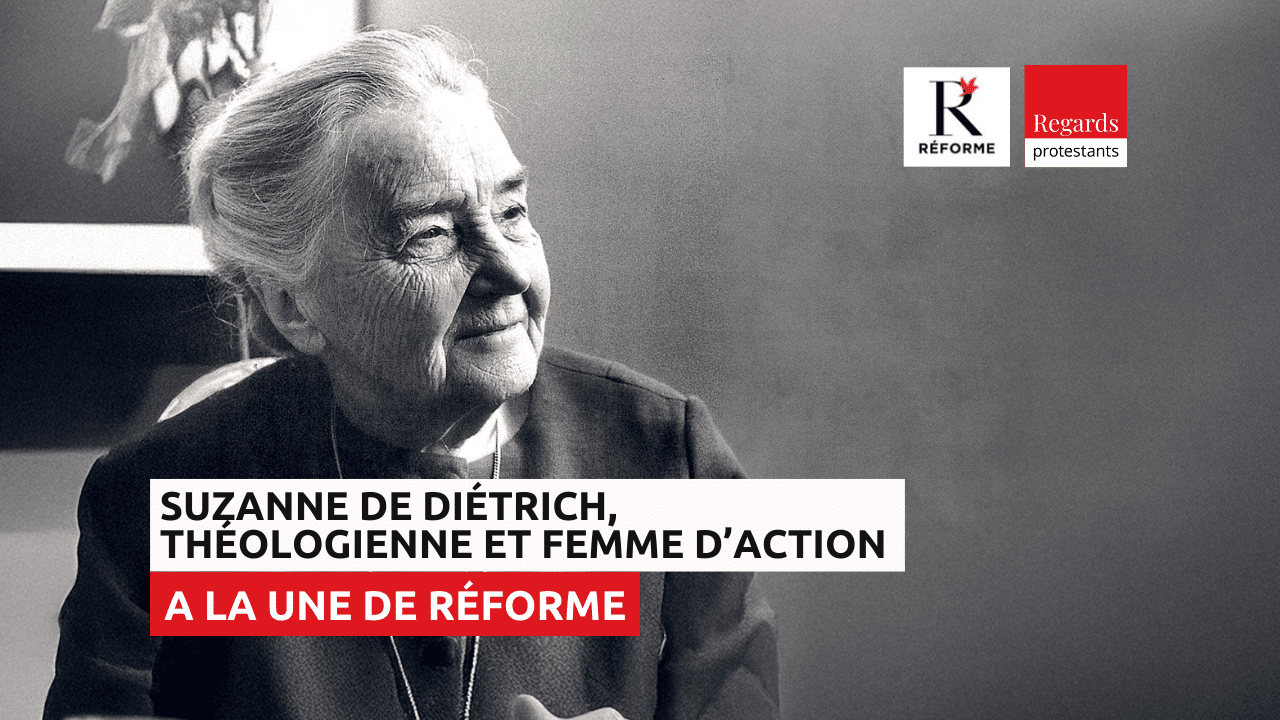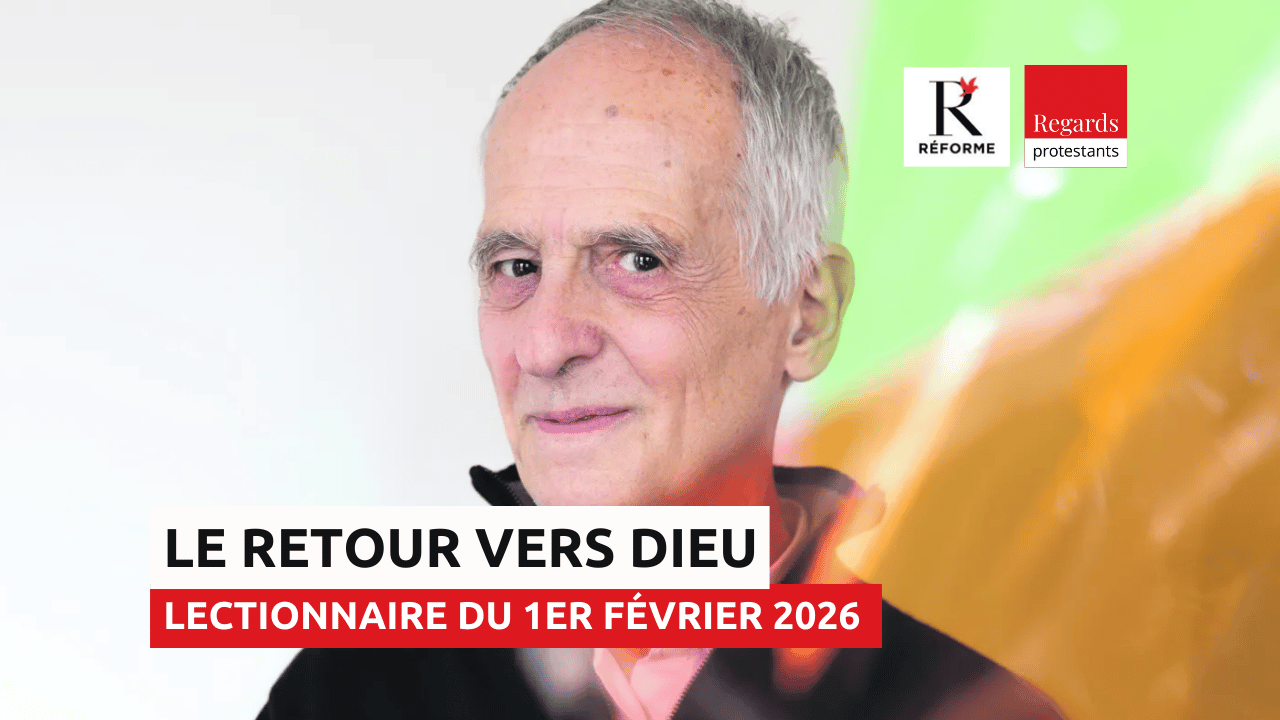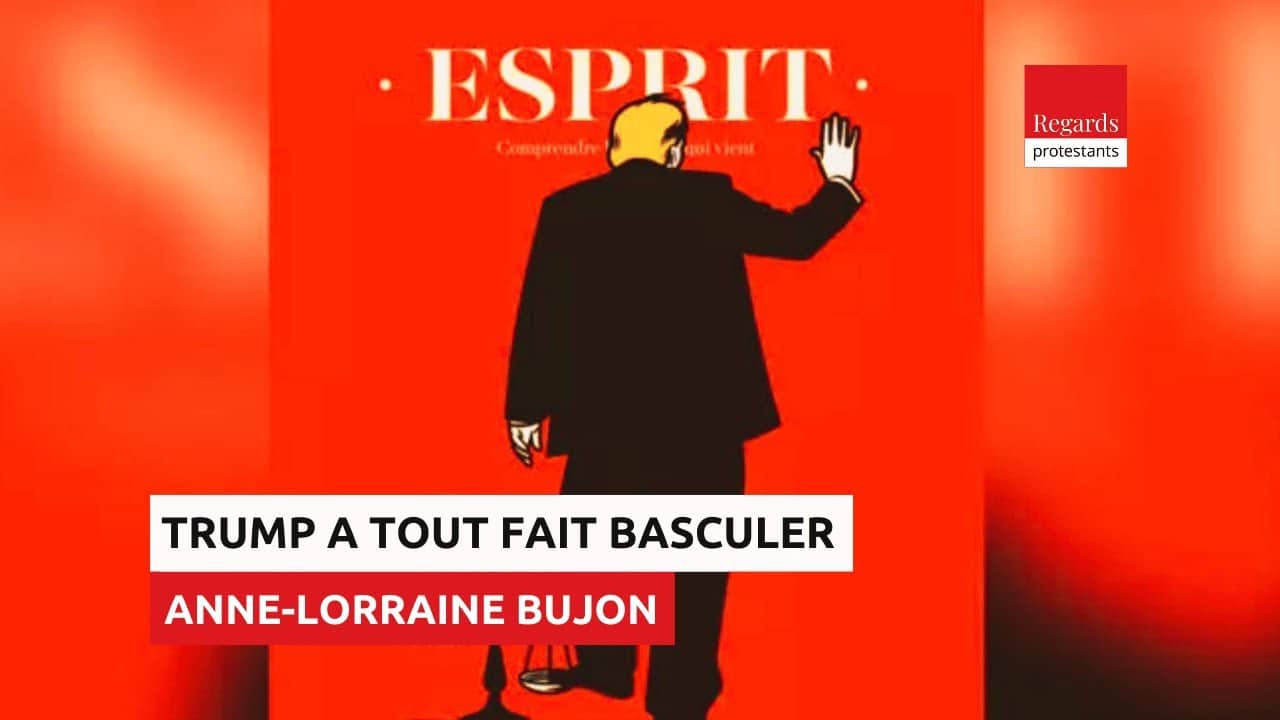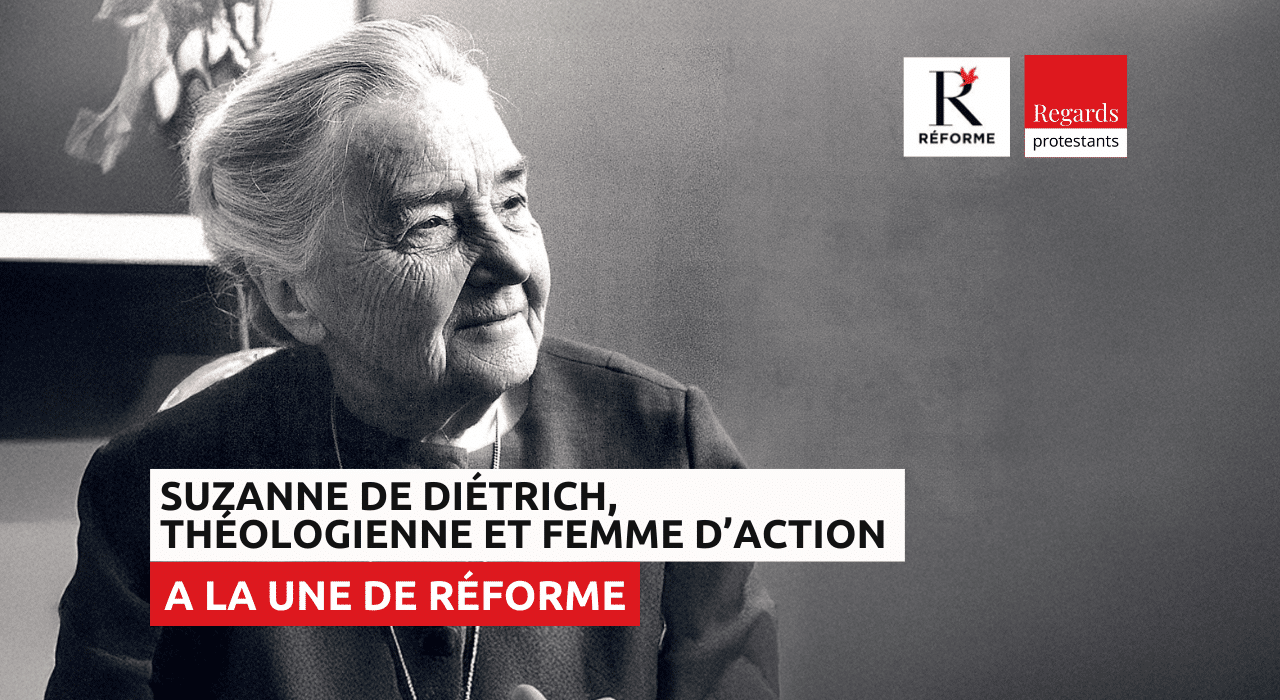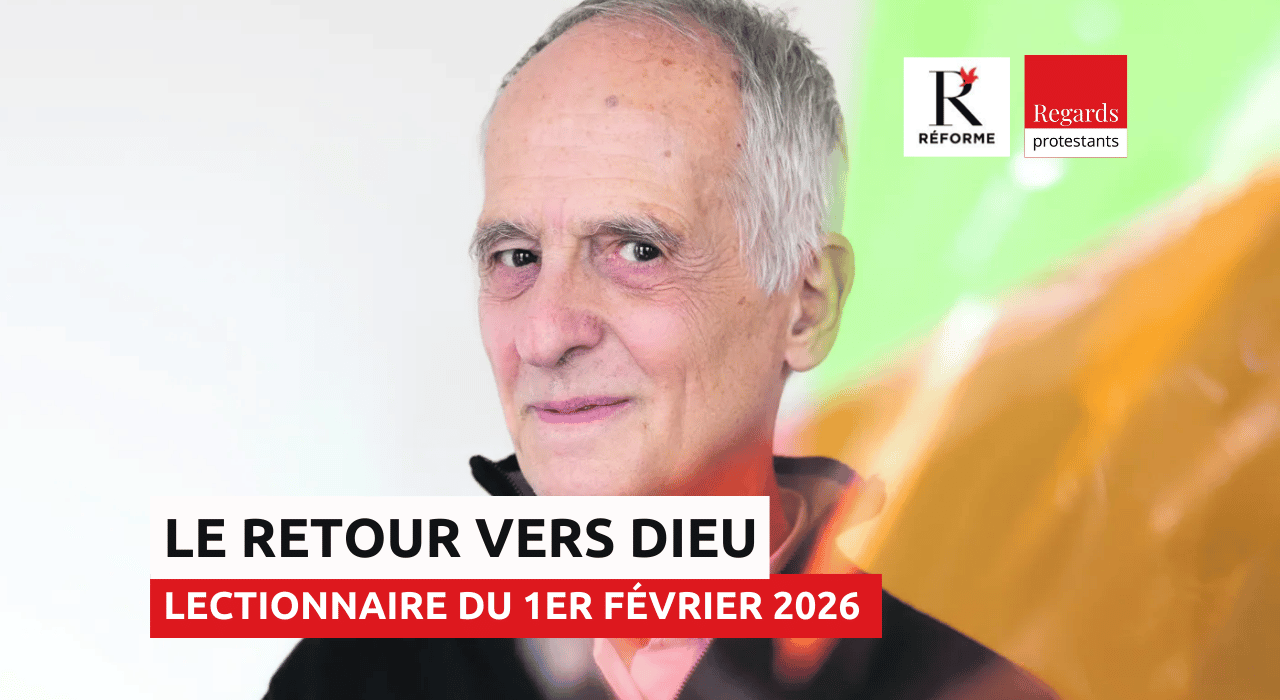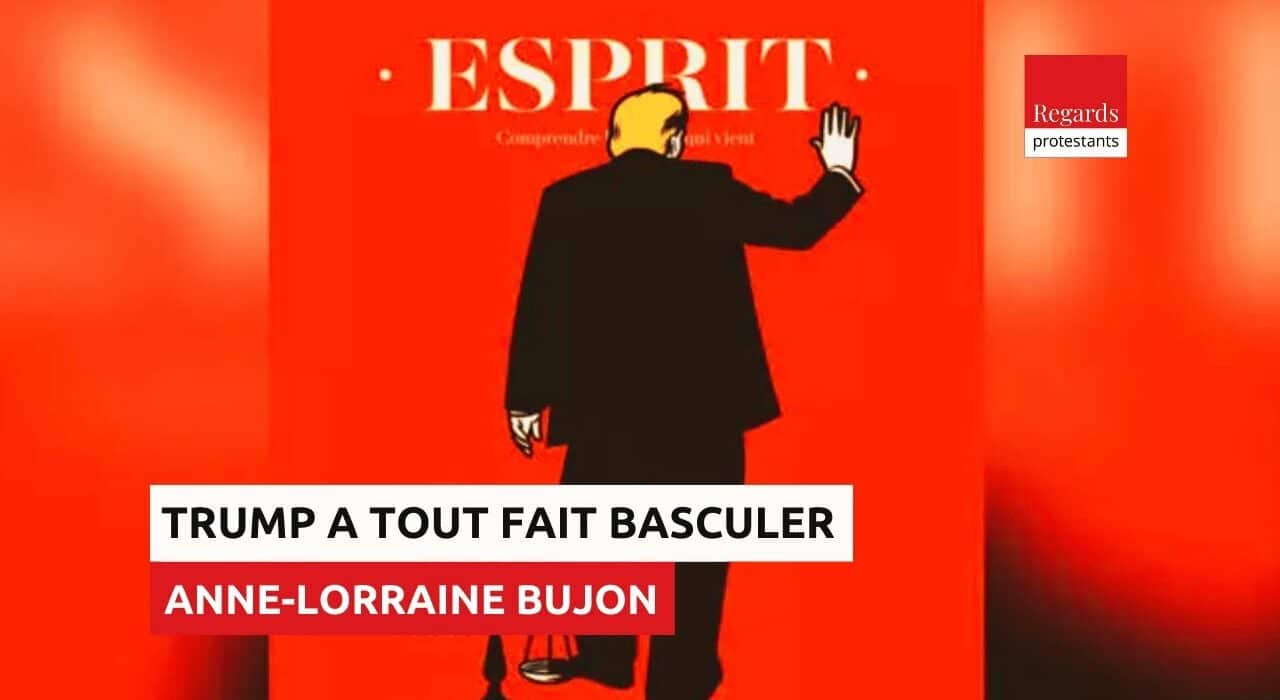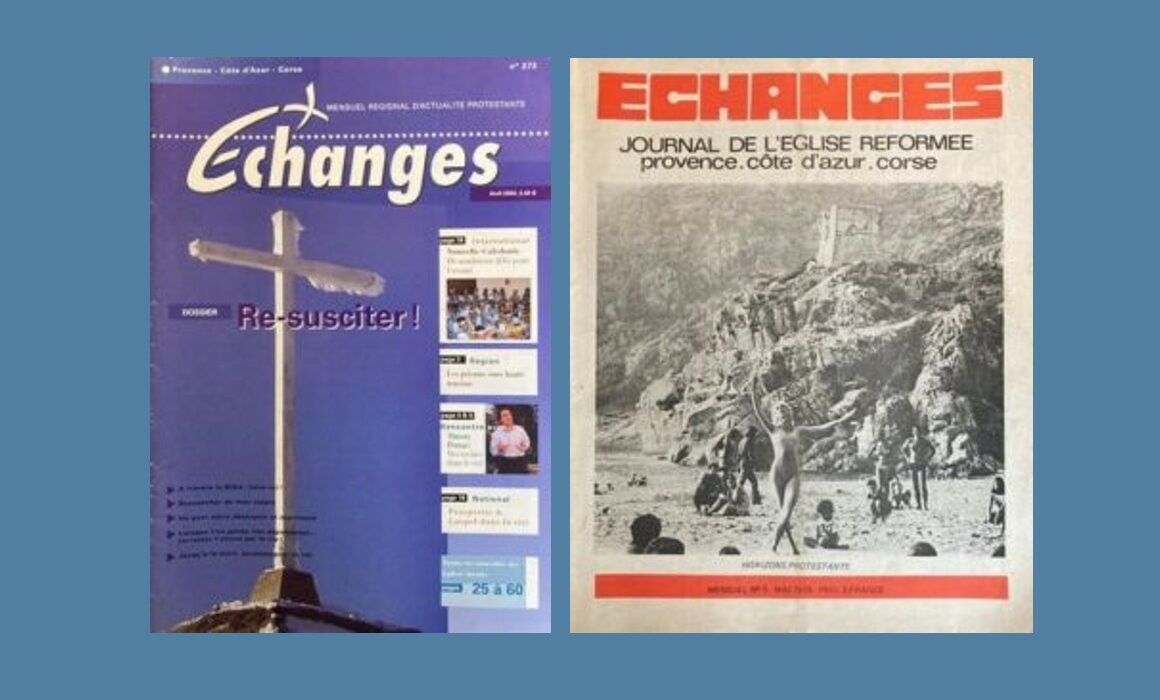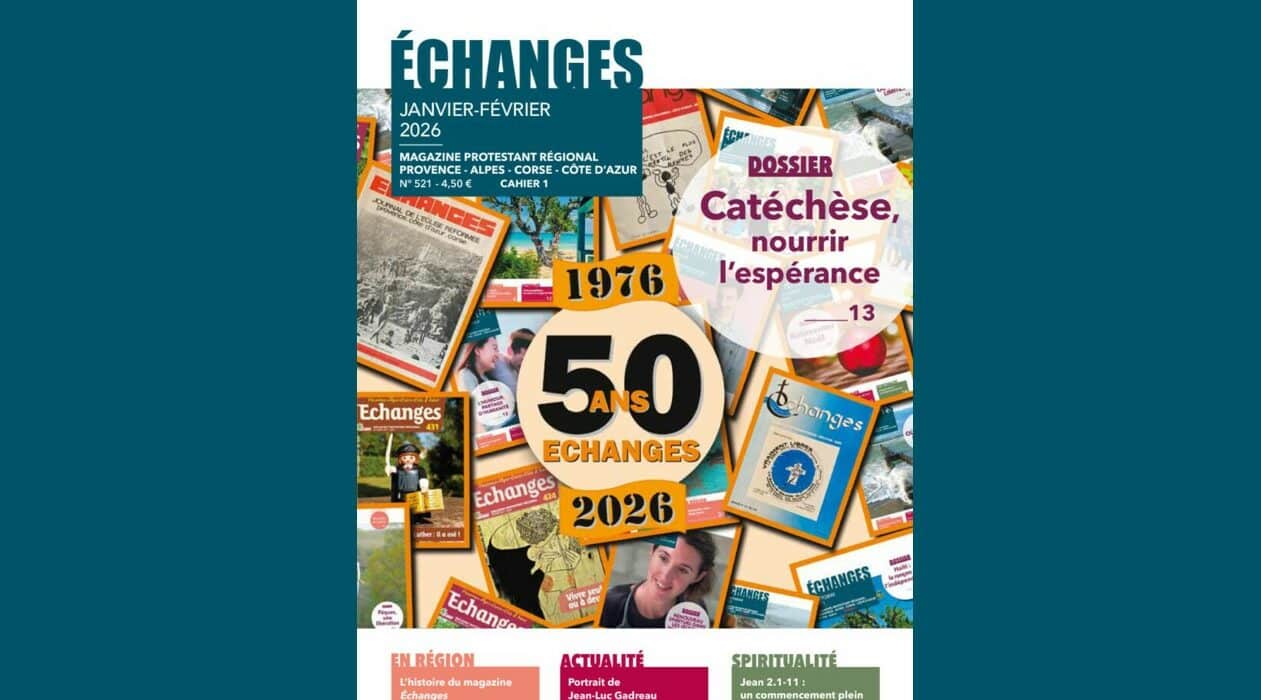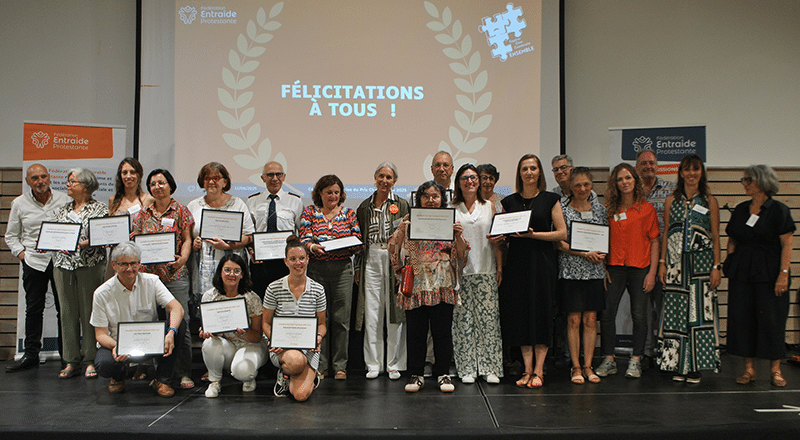Début avril 1933, le philosophe et théologien allemand Paul Tillich est révoqué de son poste à l’université de Francfort par le régime nazi, fraîchement installé au pouvoir. En novembre de la même année, conscient de la menace totalitaire et de la restriction de sa liberté de penser, il quitte l’Allemagne et embarque pour New York. Là, il rejoint l’Union Theological Seminary, alors fleuron de la pensée théologique mondiale, où d’anciens étudiants lui offrent un poste. Tillich y enseignera jusqu’en 1955.
Au séminaire protestant de New-York, les professeurs sont invités à prêcher lors des cultes à la chapelle universitaire. Sans obligation, mais avec insistance, cette mission permet à Tillich de renouer avec la prédication, qu’il avait abandonnée depuis son activité de pasteur en banlieue berlinoise et d’aumônier militaire pendant la Grande Guerre. Après une période d’adaptation à l’anglais, il s’adresse à un auditoire très différent : des universitaires, des théologiens, mais aussi des chercheurs de diverses disciplines, croyants et non-croyants, venus avec des attentes intellectuelles et spirituelles élevées.
Tillich soigne méticuleusement ses prédications. Contrairement à ses conférences, souvent griffonnées, ses sermons sont longuement rédigés. Leurs échos résonnent d’un monde en ruines : la guerre, la Shoah, Hiroshima, l’exil, la faim, les camps. Il évoque avec gravité une époque hantée par la possibilité d’un anéantissement total. Dans un sermon de 1945, il proclame que l’Apocalypse n’est plus une image religieuse, mais une réalité physique. Pourtant, Tillich refuse de sombrer dans le catastrophisme. Il ne nie pas l’horreur, mais il refuse de céder au désespoir.
Sa foi s’inscrit dans la lignée luthérienne du « malgré tout« . « La providence ne signifie pas que tout finira bien », affirme-t-il. La foi ne nie pas le mal, elle lui résiste. Elle ne garantit pas l’espoir, mais donne la force d’affronter l’absurde, l’effroi, la douleur. Face à l’effondrement du monde, Tillich annonce un courage de croire sans illusions : « Même au fond de l’abîme, il n’y a pas le néant, mais l’amour. »
Au-delà des circonstances dramatiques, ses prédications explorent des questions universelles : Qui est Dieu ?, Qui est le Christ ?, Qu’est-ce que le temps ? Tillich répond en philosophe du spirituel. Dieu n’est pas une image rassurante : il est profondeur, attente, rupture. Le Christ, non un dogme figé, mais une force de transformation intérieure. Quant à l’éternité, elle n’est pas un ailleurs futur, mais une dimension à vivre ici et maintenant.
Pour approfondir la pensée de Paul Tillich, une compilation en trois volumes de ses sermons a été publiée : Le Monde en Suspens (1948), Le nouveau être (1955) et L’Éternel Maintenant (1963). Autant de jalons d’une pensée en lutte contre les ténèbres du siècle, enracinée dans une foi lucide, exigeante, et résolument tournée vers l’humain.
Production : Fondation Bersier – Regards protestants
Intervenant : André Gounelle
Cette vidéo est une rediffusion du 11 janvier 2022.
A voir aussi :
A lire aussi :