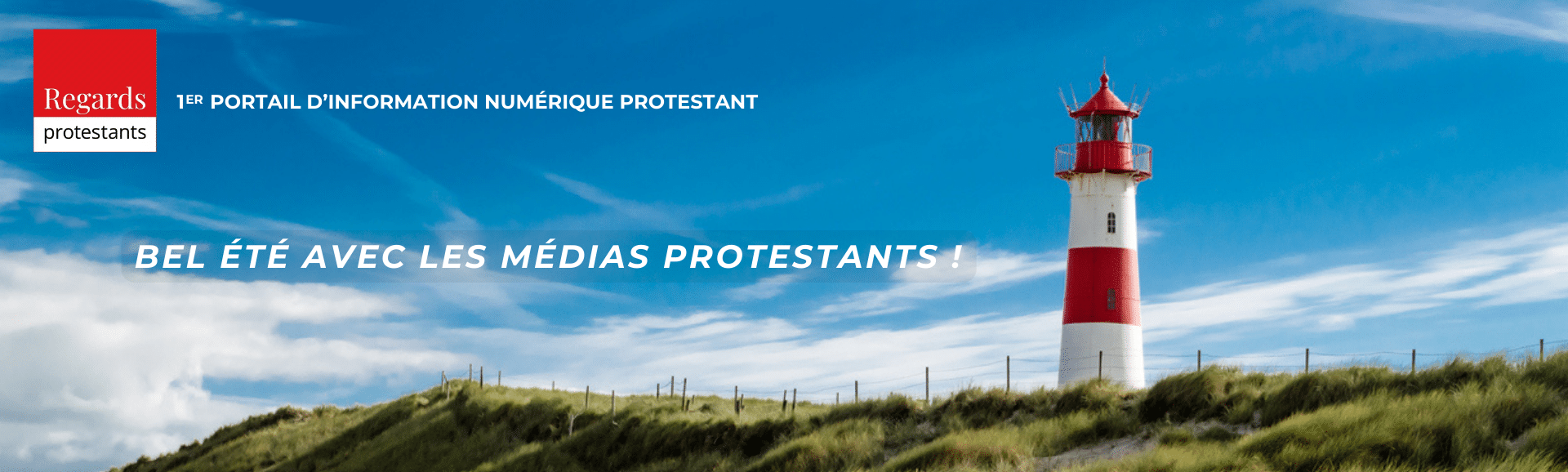Comment est-on arrivé à l’éclosion actuelle du marché Gospel francilien ? Un retour par l’histoire inscrit cette production musicale, ancrée dans le protestantisme, dans un contexte marqué par la contre-culture et les recompositions post-coloniales.
Certaines publicités pour des chorales Gospel jouent toujours aujourd’hui sur l’illustre référentiel états-unien. Une affiche, régulièrement placardée dans Paris, évoque ainsi « les chants authentiques de l’Église afro américaine »(1). Ces renvois à la référence américaine sont attendus et s’expliquent aisément par l’histoire. Né aux États-Unis, et à un moindre degré dans les Caraïbes, dans le sillage de la tradition des Negro Spirituals composés à l’époque de l’esclavage et de l’économie de plantation, le genre Gospel s’est autonomisé d’abord dans le Sud des États-Unis. C’est là qu’il s’est imposé avec le jazz, le blues, la country comme « le quatrième grand genre de musique populaire »(2) . Il est longtemps resté, pour les Français et les Parisiens, un genre exotique, nord-américain, connoté par l’héritage de l’esclavage atlantique et de l’émancipation conquise au fil du XIXe siècle. « Let my people go ! »
Golden Gate Quartet et Mahalia Jackson
De rares prestations musicales sont néanmoins proposées au public parisien dès la fin du XIXe siècle, dans les années 1870, après la guerre de Sécession : c’est ainsi que se produisent à Paris les Fisk Jubilee Singers. Mais c’est surtout après la Seconde Guerre Mondiale que le genre commence à se répendre. Les concerts mémorables de Mahalia Jackson et de Sister Rosetta Tharpe à Paris, commencent à populariser un genre toujours perçu comme « américain ».
Ce n’est pas l’installation du Golden Gate Quartet à Paris à partir de 1959, ni celle du fameux John Littleton, qui changeront la donne. En dépit de la création, dès 1947, du premier groupe Gospel francilien (et français), « Les compagnons du Jourdain », la musique Gospel reste un genre identifié aux noirs américains, à une forme de contre-culture chrétienne à contenu émancipateur. Une musique appréciée d’un public averti, tel celui du festival de jazz de Juan-les-pins à Antibes, en 1968, qui réserve un triomphe à l’amie de Martin Luther King qu’est Mahalia Jackson, venue chanter jusqu’au bout de la nuit.
Impact de l’immigration post-coloniale
Les recompositions post-coloniales marquent un virage. Elles découlent de l’indépendance des Etats africains anciennement rattachés à l’AOF (Afrique Occidentale Française) et à l’AEF (Afrique Equatoriale Française). Un nouveau mode de relation Afrique-Europe se met peu à peu en place. Confrontés à l’essor démographique et au mal-développement, les nouveaux Etats indépendants d’Afrique de l’Ouest vont nourrir, à partir de la fin des années 1970, des flux d’émigration croissants vers l’Europe et la France. De moins de 20.000 an début des années 1960, les migrants subsaharien sont environ 700.000 en France cinquante ans plus tard (chiffres INSEE). Et parmi eux, beaucoup de chrétiens, catholiques et… de protestants déjà francophones.
L’arrivée de nombreux Français antillais en métropole, dans les années 1970, constitue un autre facteur d’évolution. Ces populations francophones et chrétiennes, souvent plus pratiquantes que les métropolitains, apportent avec elles une richesse et créativité musicale dont la France métropolitaine, et particulièrement l’île-de-France, vont s’inspirer. Jusqu’aux Happy Seventies, la musique Gospel reste perçue, en France, comme un genre exclusivement nord-américain : avec l’arrivée des années 1980, une nouvelle page va s’ouvrir sous l’effet de la créativité apportée par ces nouveaux protestants venu des « territoires circulatoires » francophones.