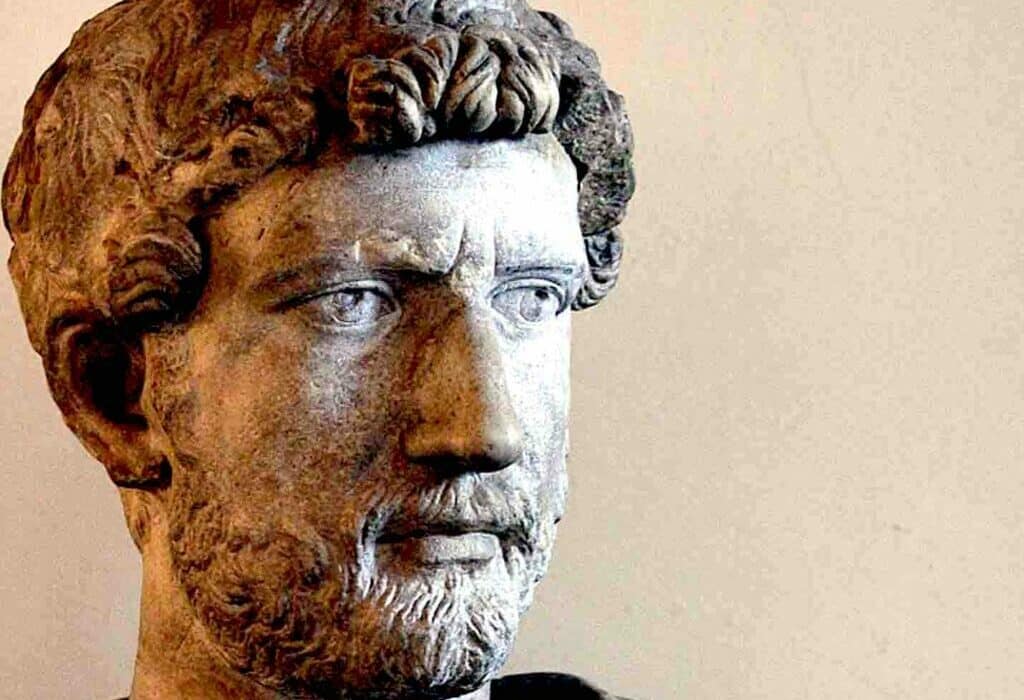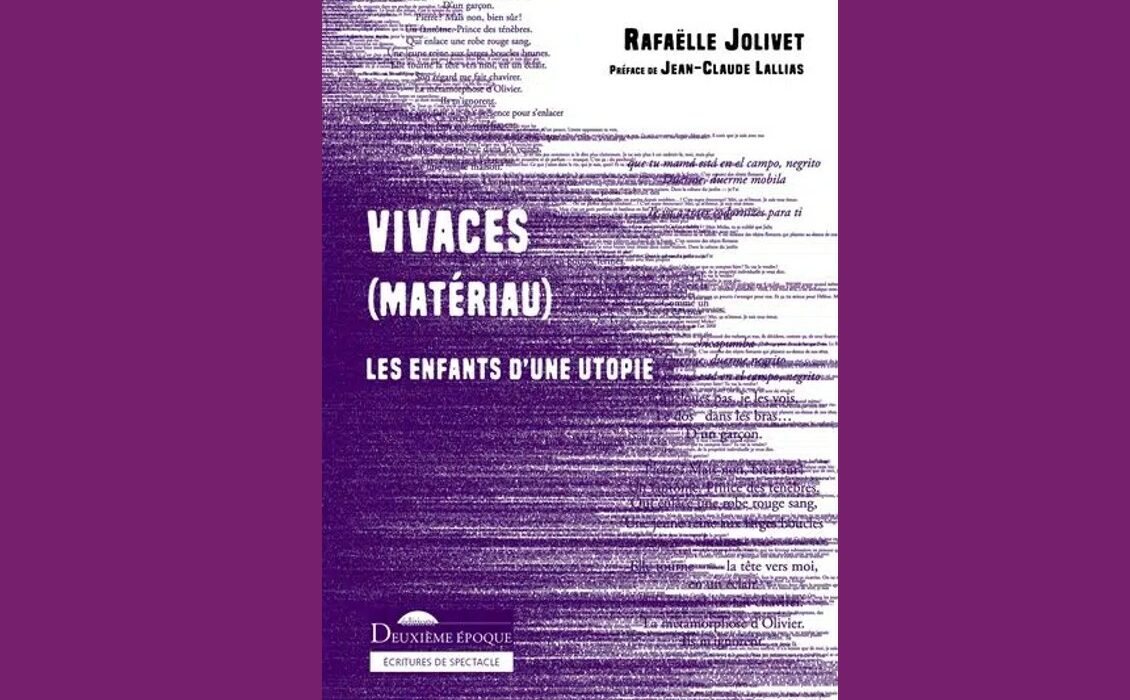«… Si l’éthique de détresse est confrontée à des situations où le choix n’est pas entre le bien et le mal, mais entre le mal et le pire — même alors le législateur ne saurait donner sa caution» (Paul Ricœur (1)).
«Nous ne pouvons agir de manière responsable et historique que dans l’ignorance dernière de notre bien et de notre mal, à savoir dans la dépendance de la grâce» (Dietrich Bonhoeffer (2)).
Il n’est pas du tout dans notre intention d’entrer de plain-pied dans un débat idéologique où chacun choisirait son camp. Les positions de notre Église sont suffisamment nuancées tout en étant fermes (3), pour nous inviter à inscrire avec humanité nos modestes réflexions dans l’horizon large qui s’ouvre entre le sixième commandement: «Tu ne commettras pas de meurtre» (Exode 20,13) et la parole de Paul aux Romains: «L’amour ne fait point de mal au prochain: l’amour est donc l’accomplissement de la loi» (Épître aux Romains 13,10).
Nous avons déjà laissé entendre, ici même (4), notre doute, sinon notre réticence, devant la volonté d’inscrire au paradigme des libertés civiques le droit à «mourir dans la dignité», en ayant recours à l’euthanasie ou au suicide assisté. Nous nous garderons bien de superposer la volonté d’un homme bien portant défendant une cause que l’on peut fort bien entendre, aux désirs ou aux volontés, parfois contradictoires, de l’homme souffrant, sentant sa mort prochaine. L’éthique de la liberté du premier ne peut se confondre à ce que nous imaginons être l’éthique de la détresse du second. À partir d’une lecture de Ricœur et de Bonhoeffer, et en passant par une réflexion sur l’éthique de la détresse et la sagesse du tragique, nous tentons ici de tracer l’itinéraire difficile (non méthodologique) allant d’une approche protestante informée à un possible regard protestant sur la loi concernant la fin de vie.
Une approche protestante
La lecture de la Résolution adoptée par le synode national de l’ÉPUdF (Lyon, 12 mai 2013 (5)) témoigne que la position des protestants ne fait pas de cette proposition de loi un simple texte juridique. Que nous ne nous égarons pas non plus dans l’illusoire clarté des positions tranchées. Ce texte engage des valeurs fondamentales: la liberté individuelle, la dignité, la solidarité. Preuve en est: la citation de Bonhoeffer que nous mentionnons en exergue y figure. Une autre également:
«Lorsqu’un malade incurable constate que son état et les soins qu’il requiert entraînent la ruine matérielle et psychique de sa famille et qu’il délivre celle-ci par sa libre décision, on ne pourra le condamner» (6).
Hors de tout esprit dogmatique, cette Résolution tente d’ouvrir l’espace non à la position ou à la décision définitive, mais à la réflexion, voire à la méditation.
Peut-être ne parle-t-on vraiment de la mort que lorsqu’on commence à sentir sa vie imperceptiblement basculer, même si la finitude est toujours incertitude, rejetée dans «le flou de la durée, et bannie de l’instant» pour reprendre de mémoire les mots de Jankélévitch. On connaît dans quelles circonstances historiques Bonhoeffer a rédigé ces lignes; il savait que sa vie était menacée, et ces deux citations de l’Éthique sont à interpréter dans ce contexte. Nous y reviendrons.
L’éthique de détresse et le Droit à l’épreuve du tragique
Le jugement de Paul Ricœur nous semble mettre en relief la tension cruciale entre éthique, responsabilité et droit. Tension dans laquelle tous les débatteurs de l’Assemblée pourraient inscrire aujourd’hui leurs discours ou leurs amendements. C’est cette tension que nous voudrions d’abord analyser, porteuse d’implications philosophiques et suggérant des limites juridiques.
L’éthique de détresse suggère une réflexion à portée morale dans des contextes extrêmes, c’est-à-dire exceptionnels, tragiques. Lorsque les conditions normales du jugement moral sont bouleversées. Lorsqu’aucun choix ne semble le bon. Lorsque nous sommes confrontés à des dilemmes que nous percevons insolubles. Lorsque le mal ne peut être évité, seulement minimisé ou hiérarchisé (7). Situation tragique, puisque chaque décision implique une forme de faute et suscite inévitablement un sentiment de culpabilité. La morale n’est plus une référence indiquant la direction du bien; il s’agit d’une morale du moindre mal, d’un mal devenu incontournable. Dans ces situations extrêmes, le législateur ne saurait donner sa caution. Si le droit s’aventure à légitimer le mal, il perd sa fonction normative et universelle. Ceux ou celles s’étant livré par compassion à des actes euthanasiques ont pour certains bénéficié de circonstances atténuantes que la justice ne doit pas transformer en règles nouvelles. Elle ne doit pas non plus légitimer un acte qui demeure immoral et vécu comme tel par son auteur. La clémence n’est ni absolution, ni légitimation. Face au mal inévitable, l’éthique de détresse met à nu la fragilité humaine. Ricœur invite à résister à la tentation de normaliser ce qui doit rester l’exception. Si le législateur peut comprendre le mal, il ne peut pas le cautionner.
La réflexion de Paul Ricœur trouve évidemment une résonnance profonde dans le débat sur la fin de vie, notamment en ce qui concerne l’aide active à mourir (euthanasie et suicide assisté (8)). L’éthique de détresse désigne une situation où la décision morale ne se joue pas entre un bien et un mal clairement identifiés, mais entre deux maux. Ces cas-limites — soins palliatifs impuissants, souffrances incurables, volonté persistante de mourir — confrontent le soignant comme le souffrant à une tragédie du choix, où l’acte juste est celui qui cause le moins de tort, sans jamais annuler le mal. L’éthique de détresse ricœurienne est une éthique de la tension, c’est une éthique du tragique.
Dans les interstices de la morale
C’est dans ces interstices de la morale, si l’on peut dire, que surgissent des demandes d’euthanasie ou de suicide assisté. L’éthique tente alors de répondre à la souffrance. Le droit est sollicité pour encadrer ou autoriser des pratiques jusqu’ici interdites. La mise en garde que Ricœur adresse au législateur a peut-être inspiré celle du doyen Jean Carbonnier, citée par le Conseil d’État lorsqu’il a été saisi par le gouvernement, le 15 mars 2024, du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades en fin de vie:
«Ne légiférer qu’en tremblant, préférer toujours la solution qui exige moins de droit et laisser le plus aux mœurs et à la morale».
Référence implicite à la prudence et à l’humanisme de la loi Claeys-Leonetti (mars 2015) qui, au fond, supposait chez les soignants «une certaine simplicité d’esprit et de cœur» (Jankélévitch, La Mort). Et respectait leur liberté de conscience (10). Jean Carbonnier saisit parfaitement l’épreuve du tragique qui menace le législateur, qu’il invite à l’humilité et à la retenue, et l’exprime en termes explicites (11). L’éthique de détresse implique des choix sans gloire, et peut-être sans rédemption. Mais le législateur peut-il les normaliser – voire les ériger en principes – sans perdre l’essence du droit qui est la visée du juste, trahissant le caractère tragique et précaire de la condition humaine ? L’éthique de la détresse chez Ricœur n’abolit pas les repères moraux, mais en suspend l’applicabilité. Les décisions qu’elle inspire, toujours douloureuses et exceptionnelles, tragiques, n’ont aucune vocation à être […]