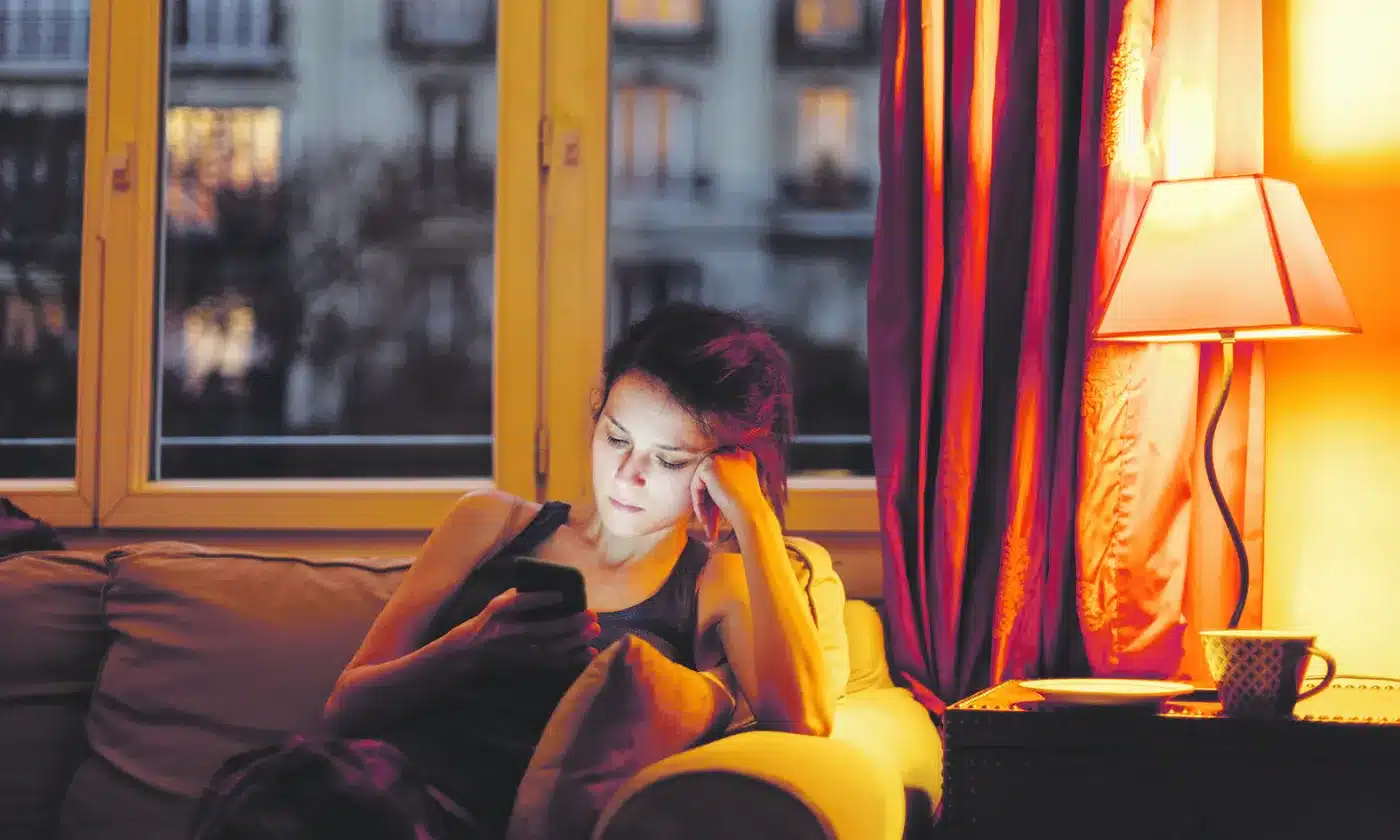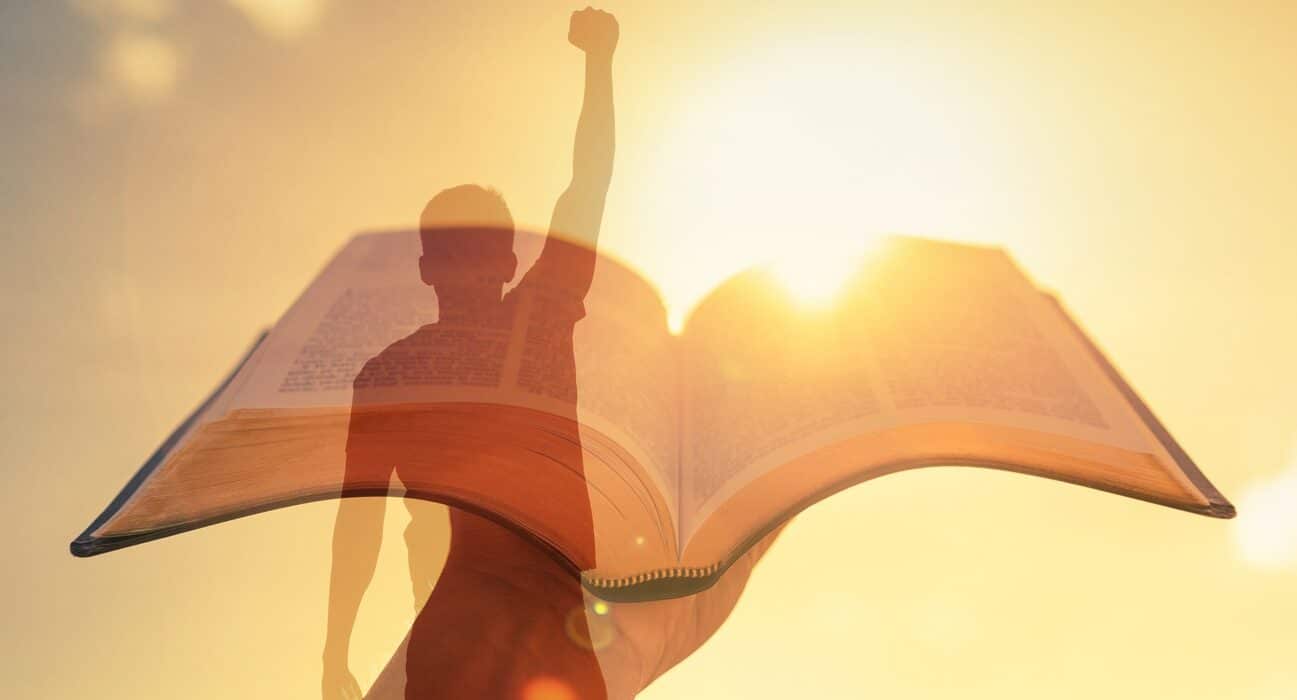Revendications sur le Groenland et le Canada, changement de nom du golfe du Mexique, Donald Trump a multiplié les exigences et les coups de gueule à un rythme effréné dans les jours qui ont suivi son investiture, en janvier dernier.
Dans le cadre de ses relations internationales, le président républicain n’hésite pas à user de son pouvoir. «Le chantage a remplacé la démocratie», résume un éditorial de 24 heures et de la Tribune de Genève, prenant pour exemple les menaces de taxation de la Colombie et du Venezuela, si ceux-ci ne consentent pas à accueillir leurs ressortissants expulsés.
«Ce qui est inquiétant, c’est que Trump a probablement capté l’humeur du temps et répond à une exaspération populaire, justifiée ou non, s’estimant victime de la mondialisation et des mouvements de population qu’elle encourage», poursuit l’éditorialiste. «Si la démocratie et ses diplomates, l’ONU et ses agences ne se donnent pas les moyens d’être efficaces, la brutalité en politique pourrait se propager encore.»
Thérapie de choc
Est-ce à comprendre que l’on assiste à une nouvelle forme de communication politique? Pas tant que ça, pour Philosophie Magazine, qui cite La Stratégie du choc (Actes Sud, 2007) dans un éditorial de février: «Intervenir immédiatement pour imposer des changements rapides et irréversibles à la société éprouvée par le désastre» est une méthode qui trouve déjà sa place aux Etats-Unis, que ce soit dans les milieux militaires ou économiques, selon l’autrice de cet essai, Naomi Klein.
«Les partisans de la stratégie du choc croient fermement que seule une fracture radicale – une inondation, une guerre, un attentat terroriste – peut produire le genre de vastes pages blanches dont ils rêvent.» Une démarche proche de ce que préconisait Machiavel au XVIe siècle.
De l’intimidation
L’usage du rapport de force dans le milieu économique existe. Nicolas Besson, pasteur actif au sein de l’aumônerie vaudoise dans le monde du travail, déclare rencontrer régulièrement des personnes vulnérables que l’on intimide ou à qui l’on […]