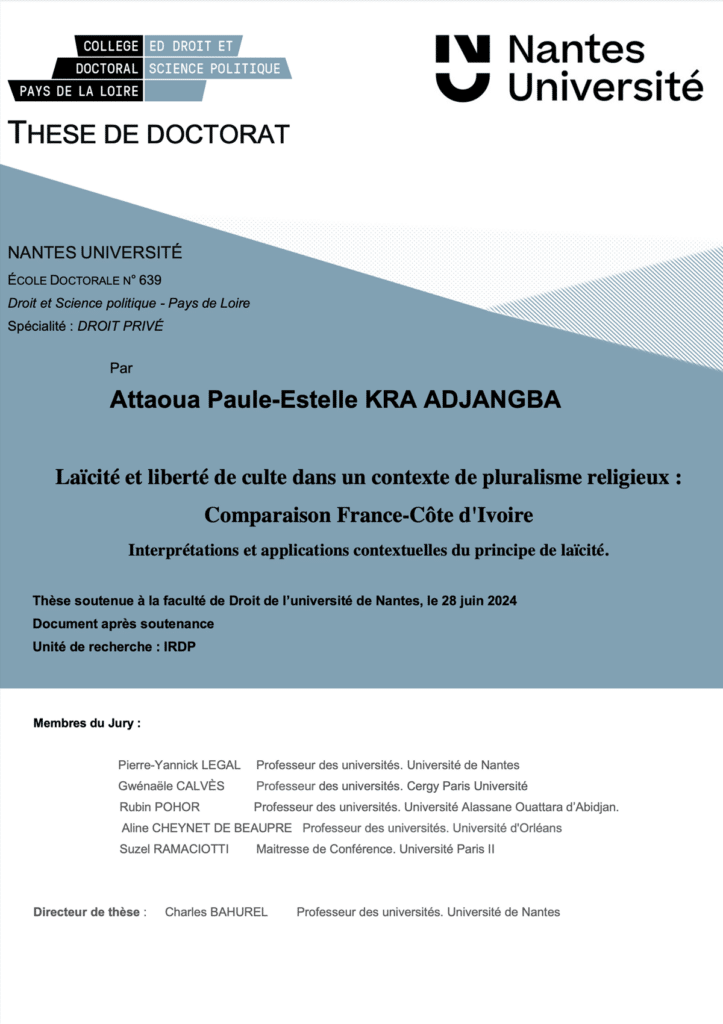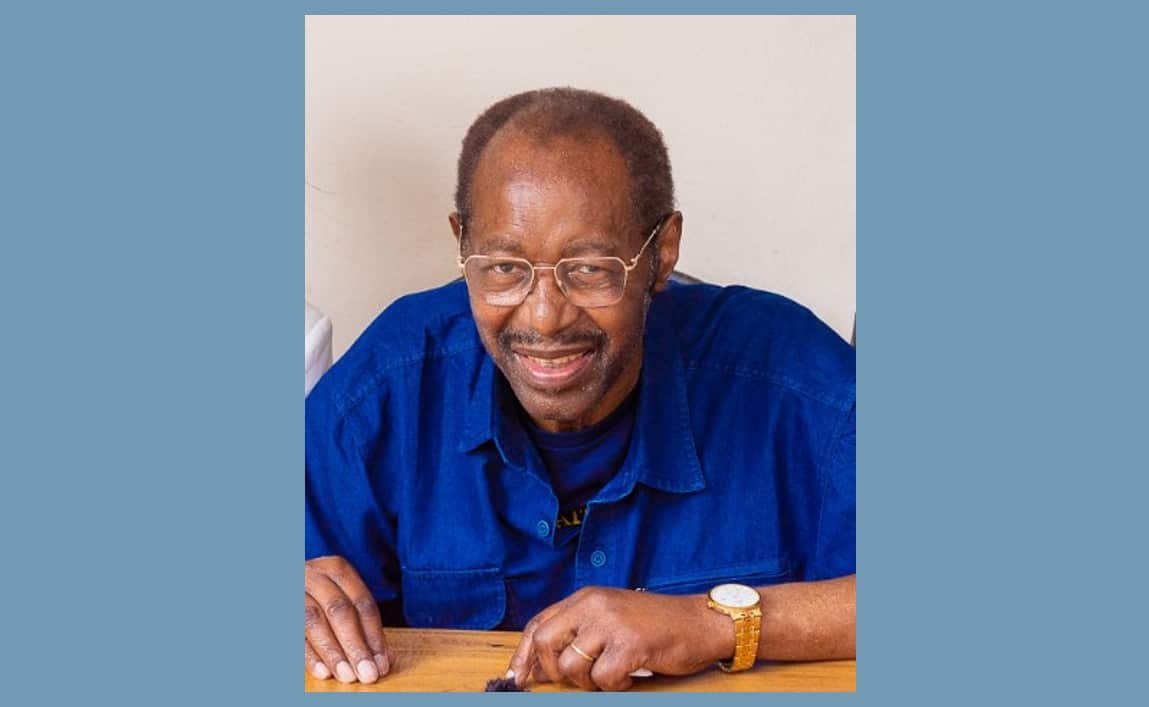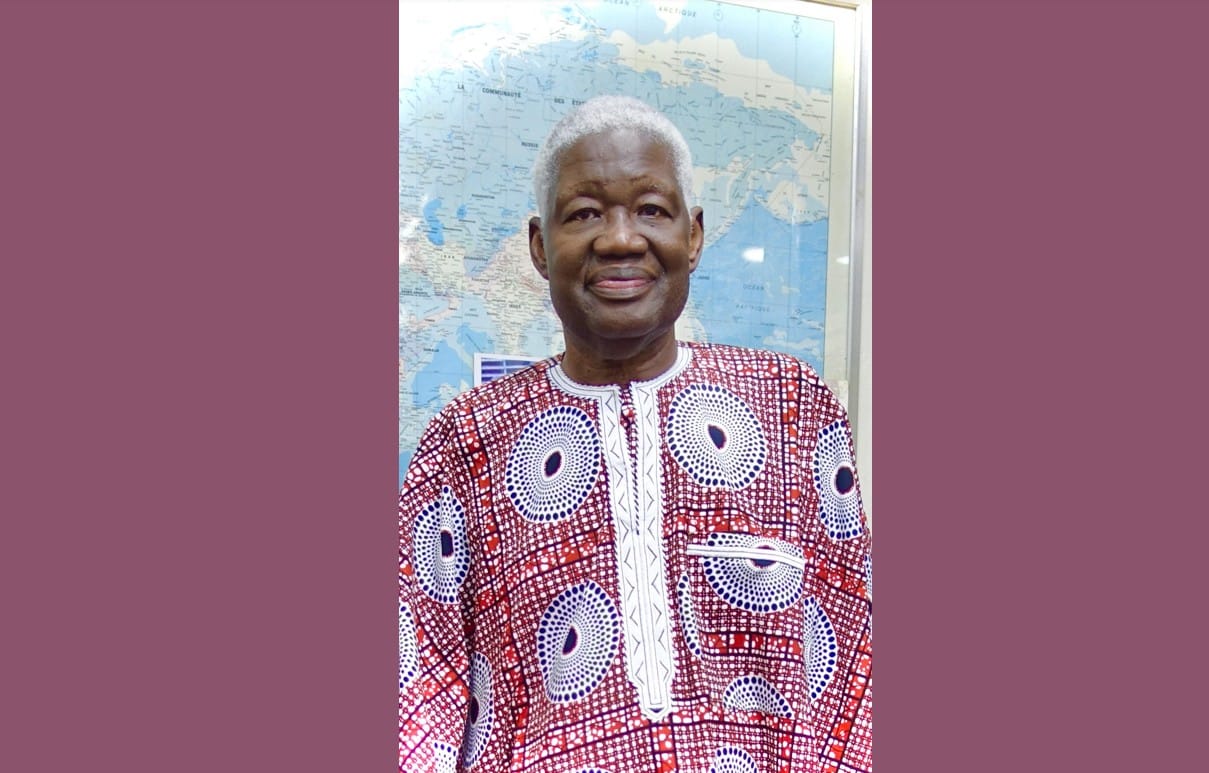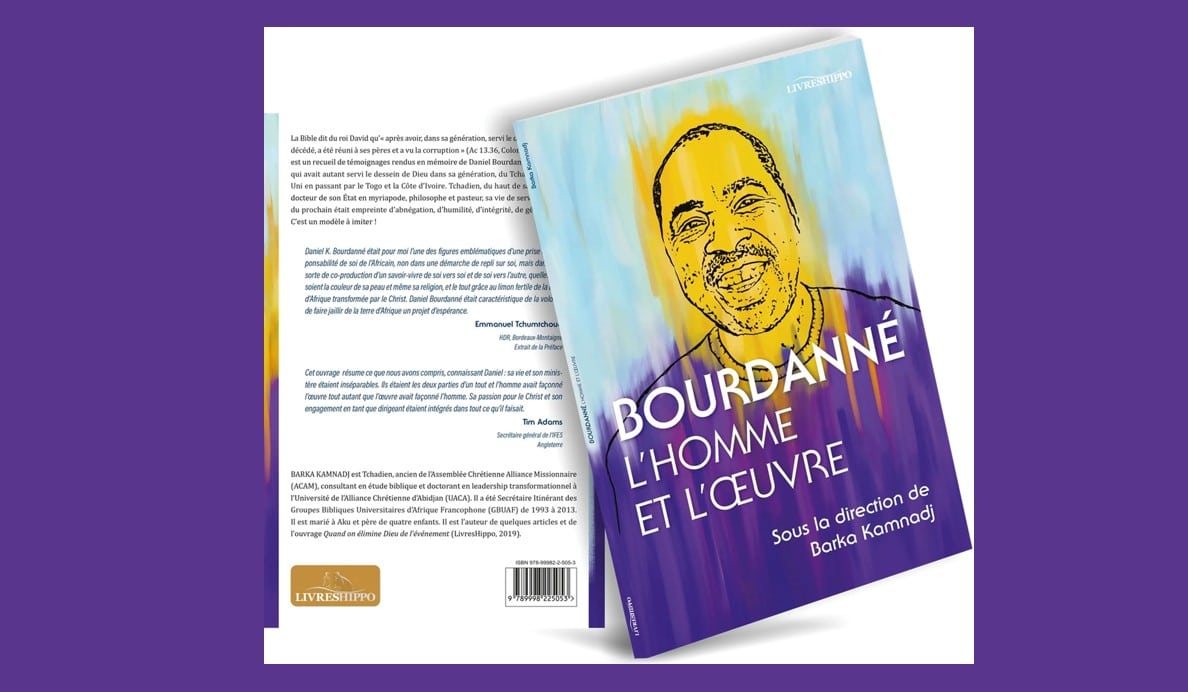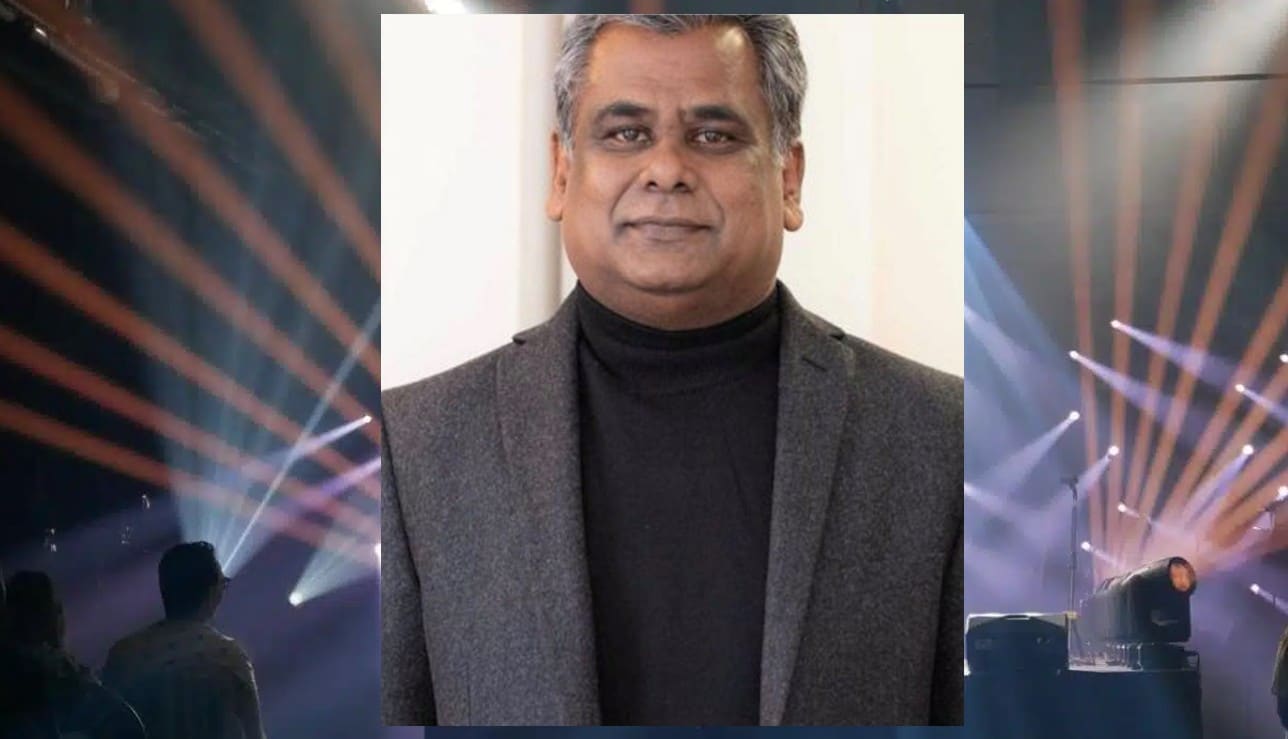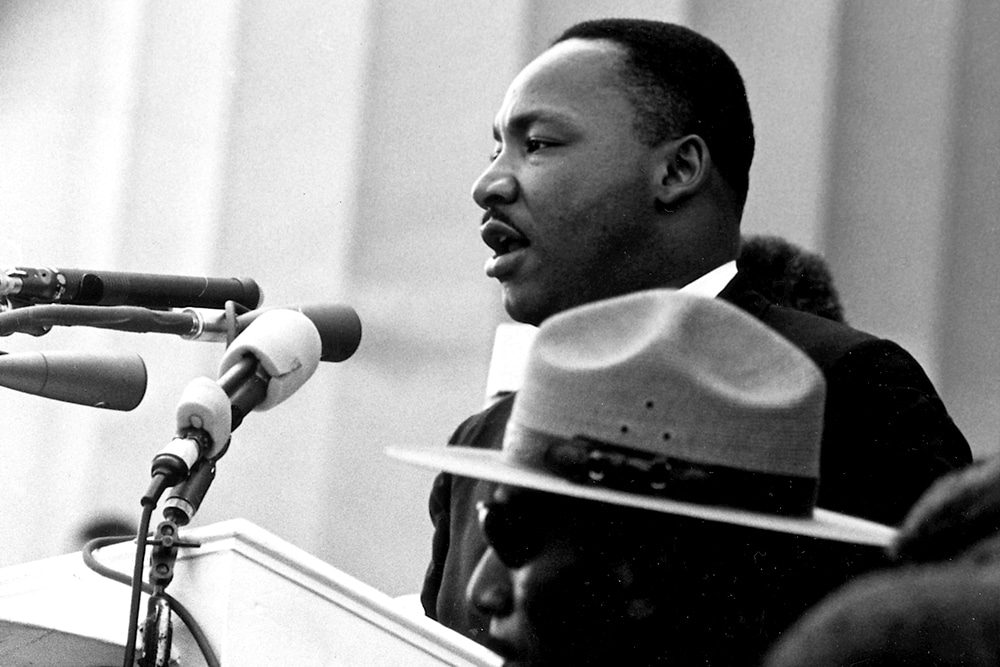Il reste encore beaucoup apprendre sur « l’Afrique des laïcités » (1). Grâce à la thèse de doctorat soutenue avec succès à l’Université de Nantes (2024) par Mme Attaoua Paule Estelle Kra Adjamgba, on en sait désormais beaucoup plus sur l’originalité de la laïcité ivoirienne. En attendant la publication, très attendue, de cette superbe thèse, en voici un résumé, grâce aux éléments communiqué par Mme Kra Adjangba, que nous remercions.
Le parcours intellectuel de Attaoua Paule Estelle Kra Adjangba s’ancre dans une exploration approfondie de l’influence juridique française sur ses anciennes colonies. En 2005, son DEA en histoire du droit à l’université Paris Val-de-Marne, sous la direction du professeur Alain Desrayaud, porte sur les conventions conclues entre les colonisateurs français et les chefs indigènes sur les côtes de ce qui deviendrait la Côte d’Ivoire. Cette étincelle, un temps atténuée par des contraintes personnelles, s’est ravivée, aboutissant à une thèse de doctorat consacrée à la manière dont la laïcité et la liberté religieuse se déploient dans ces deux nations unies par l’histoire (2).
Tout commence par un principe constitutionnel commun : la laïcité. Malgré ce fil conducteur, l’interprétation et l’application de la laïcité tissent des tapisseries bien différentes en France et en Côte d’Ivoire.
En France, la laïcité est un concept vivant, souvent source de débats passionnés, façonné par des compromis qui reflètent sa nature plurielle. De l’autre côté de l’Atlantique, en Côte d’Ivoire, ce même terme revêt une autre portée, influencé par l’héritage colonial français et le pluralisme d’une société moins sécularisée, où religion et politique s’entrelacent de longue date.
Cette divergence soulève cette question : comment un même concept juridique peut-il prendre des significations si variées dans deux pays liés par l’histoire, et comment la Côte d’Ivoire peut-elle élaborer un cadre formel pour une laïcité qui lui soit propre ?
Une laïcité, deux réalités
Le constat établi par Attaoua Paule Estelle Kra Adjangba est double. D’abord, bien que la laïcité soit inscrite dans les constitutions des deux pays, son application diverge sensiblement, particulièrement dans les anciennes colonies africaines comme la Côte d’Ivoire, où l’influence juridique française reste palpable. Ensuite, même en France, la laïcité n’est pas une notion monolithique. Elle est plurielle, tiraillée par des interprétations conflictuelles et adoucie par des aménagements, tant en métropole qu’au-delà.
Ces observations mènent à une question centrale : quelle est la portée juridique de la laïcité en France et en Côte d’Ivoire, et comment, à partir d’une même base constitutionnelle, peut-on envisager une laïcité spécifique en Côte d’Ivoire, fondée sur une collaboration formelle entre l’État et les cultes ?
Pour répondre à cette question, le travail de recherche développé par Attaoua Paule Estelle Kra Adjangba s’articule autour de plusieurs objectifs. Tout d’abord, elle s’attache à explorer la signification et l’application de la laïcité dans deux États liés par la colonisation et aujourd’hui partenaires sur les plans politique, diplomatique, économique et scientifique. Ces deux nations partagent un même pluralisme religieux, mais leurs contextes historiques et sociaux façonnent des approches distinctes, avec des degrés de sécularisation très différents. Ensuite, à travers l’exemple de la France et de la Côte d’Ivoire, elle cherche à démontrer comment les contextes historiques, sociaux, politiques et économiques influencent l’interprétation et l’évolution de la laïcité. Enfin, alors que la France débat activement de ce concept, la Côte d’Ivoire souffre d’un vide juridique sur la question, que son travail ambitionne de combler en proposant des pistes concrètes.
Au travers d’une approche pluridisciplinaire, mêlant sociologie historique, droit comparé, et droit public et privé pour illustrer les applications pratiques de la laïcité, Mme Kra Adjangba explore, dans la première partie de sa thèse, l’interprétation de la laïcité, en s’appuyant sur le contexte socio-historique de chaque pays. En France, la laïcité est née d’un long conflit entre le pouvoir politique et l’Église catholique, culminant avec la loi de 1905, qui consacre la séparation entre État et religion dans un contexte de sécularisation progressive. En Côte d’Ivoire, en revanche, la société, historiquement non sécularisée, a toujours mêlé religion et politique. Le colonisateur français, paradoxalement issu de la Troisième République, a collaboré avec les religions pour asseoir son autorité, et à l’indépendance, la laïcité a été inscrite dans la constitution par mimétisme, sans véritable séparation.
Cette divergence se manifeste dans deux éléments clés : la neutralité et le non-financement des cultes. En France, la neutralité implique une abstention de l’État, qui ne reconnaît ni ne finance les cultes, bien que des aménagements existent pour garantir la liberté religieuse. En Côte d’Ivoire, la neutralité est fonctionnelle : l’État n’exerce pas de fonctions religieuses. Les religions n’ont pas de rôle politique direct, mais elles jouent un rôle social reconnu, bénéficiant même de financements publics, notamment dans le cas des Églises protestantes, en plein essor. Cette reconnaissance soulève la question de l’égalité entre les cultes.
La seconde partie de la recherche conduite par Attaoua Paule Estelle Kra Adjangba examine l’application concrète de la laïcité à travers trois prismes : l’école, les jours fériés et le mariage. En France, l’école est un champ de bataille historique pour la laïcité, mais aussi un lieu de coopération depuis la loi Debré de 1959, qui garantit la liberté d’enseignement. En Côte d’Ivoire, l’école est avant tout un enjeu de scolarisation dans un pays où l’analphabétisme reste à réduire. L’État y collabore avec les écoles confessionnelles, musulmanes, catholiques, protestantes, pour intégrer ces structures au système éducatif, bien que l’égalité dans ces partenariats demeure un défi juridique.
Les jours fériés, quant à eux, reflètent en France une lutte idéologique pour la sécularisation, avec des débats sur les fêtes d’origine religieuse. En Côte d’Ivoire, ces fêtes, héritage colonial, s’élargissent pour inclure d’autres religions, signe d’une prise en compte du pluralisme, mais là encore, l’équité reste un enjeu. Le mariage, enfin, illustre l’inefficacité d’une laïcité à la française en Côte d’Ivoire. Alors que le mariage civil est le seul reconnu juridiquement, les mariages traditionnels et religieux prédominent, révélant les limites d’une tentative d’uniformisation. Face à cette coexistence de droits concurrents, une harmonisation des cadres juridiques s’impose.
Vers une laïcité ivoirienne juridiquement plus étayée
Pour combler le vide juridique en Côte d’Ivoire, Attaoua Paule Estelle Kra Adjangba propose une définition constitutionnelle de la laïcité adaptée au contexte local : « La laïcité en Côte d’Ivoire s’entend cumulativement de la liberté de conscience et la liberté de pratique religieuse, individuelle ou collective, de l’égalité entre les citoyens quelles que soient les croyances et la non-discrimination pour motif religieux. Elle s’entend également de la neutralité confessionnelle de l’État et de son égale distance vis-à-vis de toutes les confessions religieuses. Cette définition inclut que l’État et les cultes, dans un objectif de cohésion sociale, de paix et de développement intégral et global, mettent en commun leurs ressources et collaborent étroitement dans des domaines et des proportions définis et réglementés ».
Cette proposition vise à formaliser une laïcité de collaboration, respectueuse du pluralisme religieux et des réalités socio-historiques ivoiriennes, tout en s’inspirant de l’héritage juridique français, mais sans le reproduire aveuglément. Ainsi, la laïcité, loin d’être un concept figé, s’adapte et s’enrichit des contextes qui la portent, offrant à la Côte d’Ivoire une voie vers une coexistence harmonieuse entre État et religions.
(1) Gilles Holder, Moussa Sow (dir), L’Afrique des laïcités, IRD Editions, 2014
(2) Attaoua Paule Estelle Kra Adjangba , Laïcité et liberté de culte dans un contexte de pluralisme religieux : Comparaison France-Côte d’Ivoire. Interprétations et applications contextuelles du principe de laïcité, thèse de doctorat soutenue à la Faculté de Droit de l’Université de Nantes, le 28 juin 2024, sous la direction de Charles Bahurel (Université de Nantes)