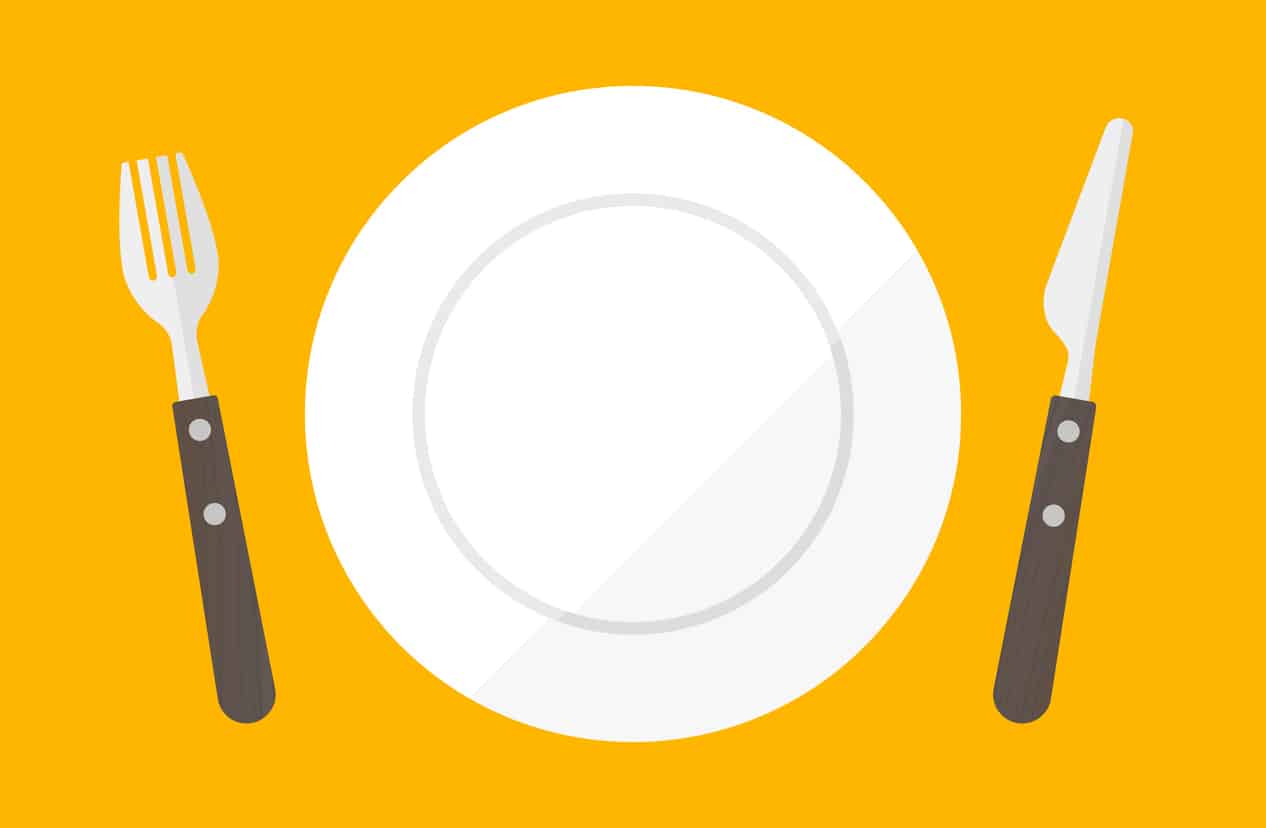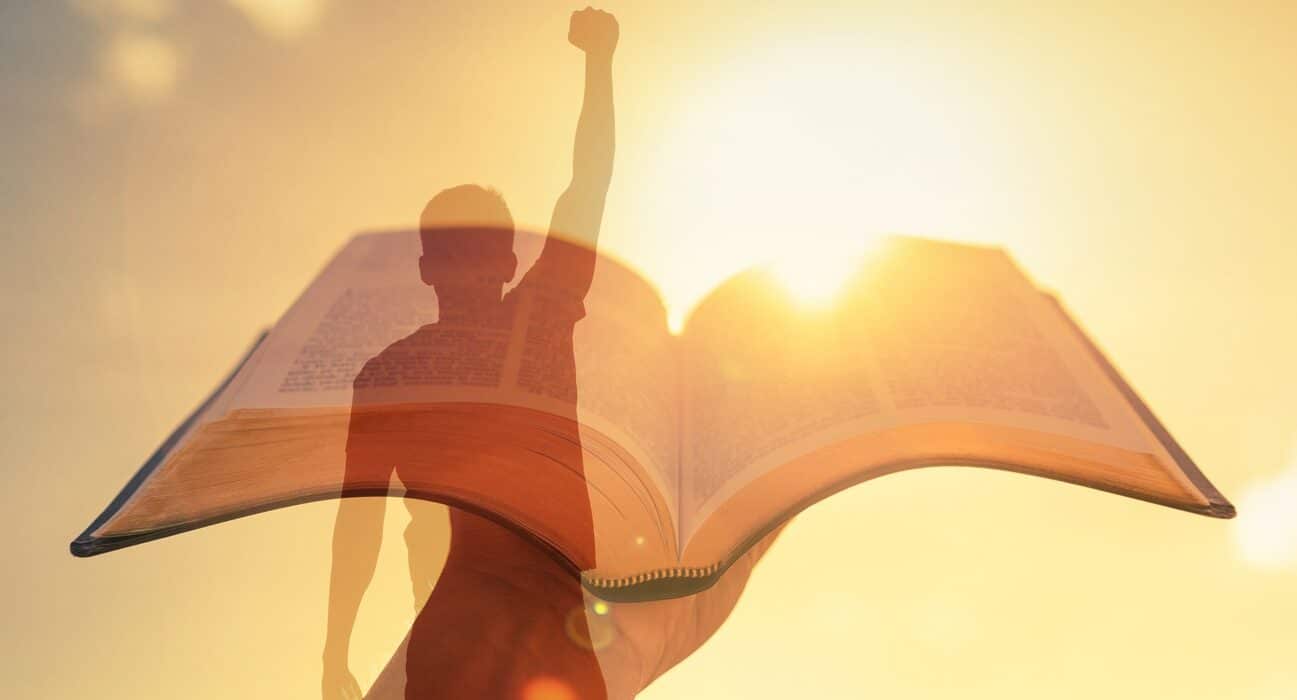Quelle place occupe la femme dans l’action sociale ? La question peut sembler simple. Tenter d’y répondre ne l’est guère car les enjeux ne manquent pas : lutte contre les violences faites aux femmes et reconstruction des victimes, émancipation féminine par la reconnaissance et surtout le libre exercice de tous les droits, valorisation de l’engagement au féminin dans l’action sociale du monde protestant… Mais faut-il parler de la femme envisagée comme une catégorie générique ou des femmes dans la diversité de leurs vécus ? Et s’agit-il de la place de la femme plutôt que des places des femmes dans la vie sociale ?
Des femmes et des places
Recourir au pluriel permet de mieux reconnaître parcours et expériences personnelles. Le pluriel permet aussi de discerner des groupes dans ces parcours (par exemple, les migrantes) et expériences (les femmes victimes de violences). Est-ce toutefois suffisant pour mieux saisir les vécus ? De son côté, l’emploi du singulier renvoie à la représentation abstraite de la femme à travers une fonction, un rôle, une place dans la vie sociale. Peut-on ignorer ici le risque de l’assignation, cette réduction des personnes à des qualités abstraites (par exemple, l’intuition féminine), à un rôle ou un statut prédéfini (épouse et mère) ? Les assignations propagent souvent un stéréotype de genre, préjugé banalisé ou opinion hostile aux effets délétères « dès lors qu’il limite la capacité des femmes et des hommes de développer leurs compétences personnelles, d’exercer un métier et de prendre des décisions concernant leur vie » (Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, Stéréotypes de genre, 2014).
Des inégalités genrées
Il convient donc aussi de questionner les représentations idéologiques qui sous-tendent les inégalités autant que les engagements solidaires qui les combattent. Les inégalités genrées envers les femmes ne sont cependant ni homogènes, ni même uniformes dans le temps, l’espace et les sociétés humaines. Malgré les progrès d’un droit supposé plus protecteur, elles croisent souvent une variété d’autres discriminations et violences : familiales, générationnelles, sanitaires, économiques, juridiques, culturelles, ethniques, religieuses… Ainsi, l’arsenal juridique français a été régulièrement renforcé ces dernières années contre les violences exercées dans la sphère conjugale ou familiale, les violences sexuelles, le harcèlement ou les outrages sexistes, les mutilations sexuelles ou le travail forcé. Pourtant, en 2023, 85 % des victimes déclarées de violences sexuelles ou sexistes sont des femmes, dont 57 % sont mineures. Le nombre de femmes majeures concernées est de 230 000, soit la population de Lille (Observatoire national des violences faites aux femmes, Lettre n°19, 2024).
Parmi les personnes vulnérables, les femmes sont souvent au carrefour des tensions qui traversent les sociétés et les cultures. Au niveau mondial, le taux de non-scolarisation des filles est toujours plus élevé que celui des garçons lorsque l’éducation n’est ni obligatoire ni gratuite. Seulement un tiers des filles mariées ou enceintes et des jeunes mères bénéficient d’un droit à l’éducation (Unesco, SonAtlas : outil de plaidoyer interactif sur le droit des filles et des femmes, 2023). De même, des millions de femmes sont privées d’accès aux soins, notamment en matière gynécologique ou obstétrique (Institut national d’études démographiques, Population & Sociétés, n° 625, 2024). Dans les pays du Nord, l’action sociale accompagne fréquemment des femmes ayant subi des traumatismes liés à leur migration ou aux normes de leur milieu familial. Et ces femmes n’ont souvent pas eu accès à l’éducation ni à la santé dans leurs pays d’origine.
Une contribution mal reconnue
L’engagement féminin et sa reconnaissance répondent en écho à la question de la place des femmes dans l’action sociale. Cet engagement prend deux formes principales : le bénévolat et le travail social. Les bénévolats féminin et masculin offrent des traits différenciés. Minoritaires dans le sport (32 %), les femmes sont majoritaires dans les activités caritatives et humanitaires (60 %), l’éducation et la formation (68 %), ou encore la défense de causes et d’intérêts (54 %). En revanche, leur taux d’adhésion, leur disponibilité et leur durée d’engagement sont inférieurs à eux des hommes. Quant à la gouvernance associative, « la part des femmes décroît quand le niveau de responsabilité s’élève. Alors que les femmes représentent la moitié des membres d’associations, elles ne sont que quatre sur dix à exercer une présidence » (Observatoire de l’égalité femmes-hommes dans l’économie sociale et solidaire, Genre et bénévolat, 2020).
Ces tendances se retrouvent dans les emplois largement féminins du secteur social et médico-social. Près de huit salariés sur dix y sont des femmes et on compte deux femmes pour trois emplois de responsable de service ou de direction d’établissement. Mais bien qu’elle soit massive et indispensable à la société, cette contribution professionnelle des femmes est peu visible, mal connue et encore mal reconnue. Quant aux directions générales, elles restent majoritairement masculines dans six associations sur dix (Véronique Bayer, « Le genre dans le travail social », Revue des politiques sociales et familiales, nos 146-147, 2023). Ainsi, « si les directrices rappellent combien l’accès au poste est un cheminement, implique un investissement dans les études et des mobilités de postes et de secteur d’intervention, les directeurs, quant à eux, montrent que leur immobilité (d’employeur, de secteur et géographique) les conduit à évoluer facilement vers les fonctions de direction » (« Le travail social n’est pas qu’une affaire de femmes », Actualités sociales hebdomadaires, 2024).
Pour une éthique expérientielle
Il y a là une série de défis sociopolitiques et managériaux, mais aussi un enjeu éthique majeur si l’on veut témoigner des places des femmes dans l’action sociale et y réfléchir dans une perspective humaniste, chrétienne et protestante. Toute éthique prend son sens dans le respect de la dignité humaine. Et aucune éthique ne peut être agissante sans reconnaître l’interdépendance des deux polarités genrées incarnées dans l’humanité. L’action sociale responsable s’éprouve prioritairement au travers d’expériences de vie et de rencontres avec et pour les plus vulnérables. Elle appelle donc une éthique expérientielle, non une morale abstraite postulant des normes de justice sociale : c’est ce que défend l’éthique du care. Trop souvent réduite à un maternage relationnel – ce qu’il n’est pas –, l’éthique du care met en avant le caractère fondateur du soin et de l’attention dus à chaque être humain. Sa perspective morale critique est d’inspiration féminine certes, mais est ouverte à tous, hommes et femmes, pour construire une société plus humaine (Fabienne Brugère, L’Éthique du « care », Paris, PUF, « Que-sais-je ? », 2011).
En grec ancien, la place, lieu de la vie sociale et démocratique, se dit agora. La place des femmes dans l’action sociale est aussi une agora.