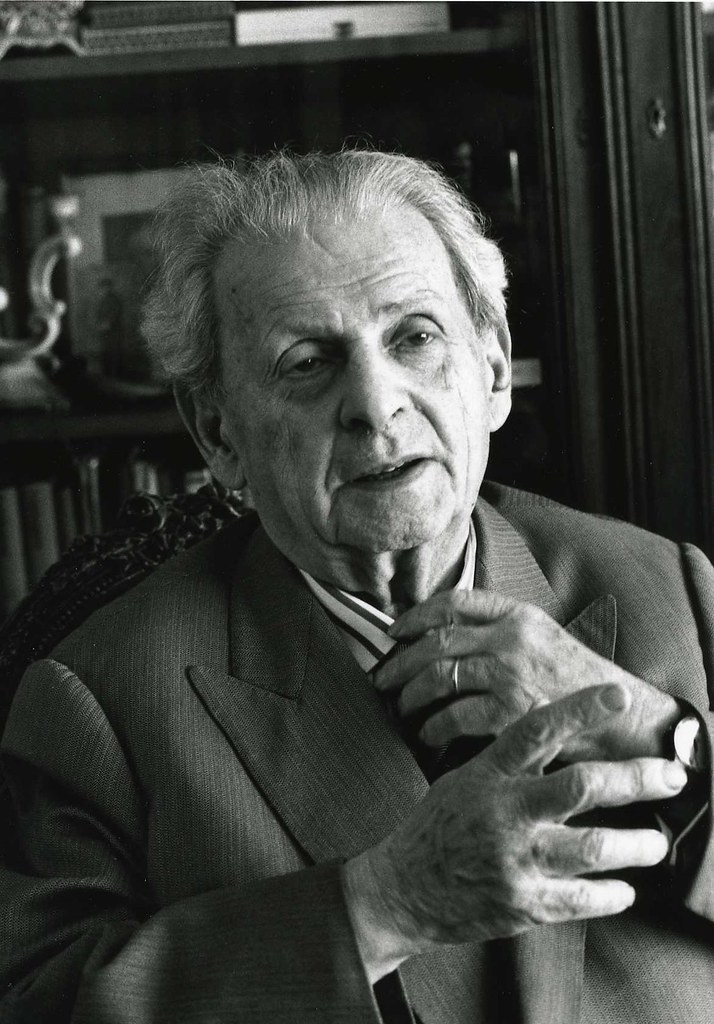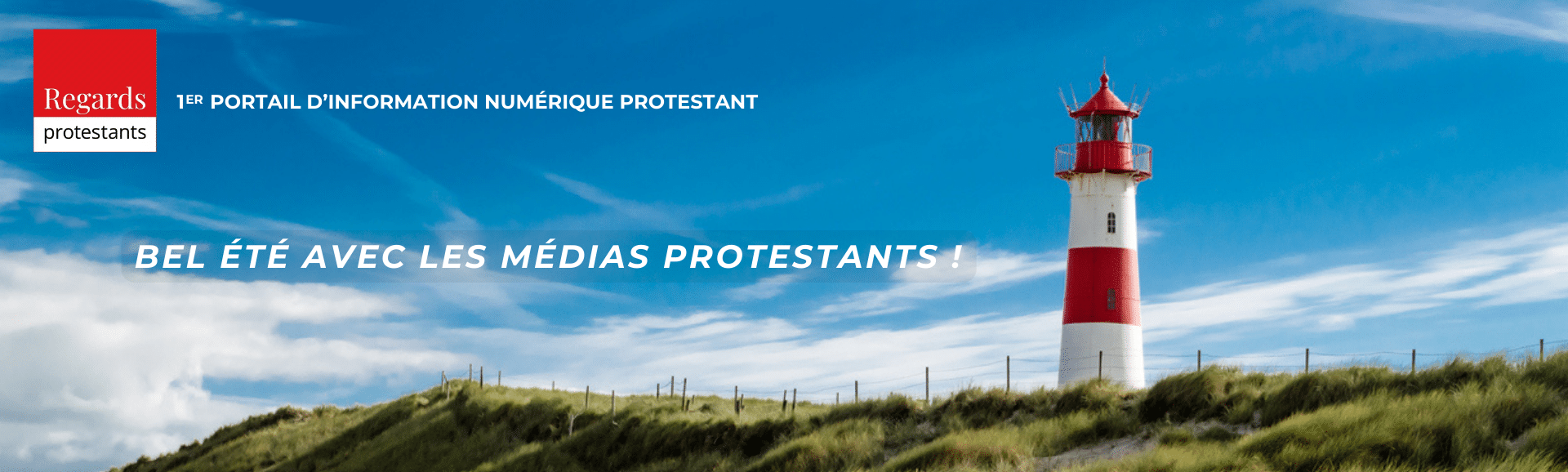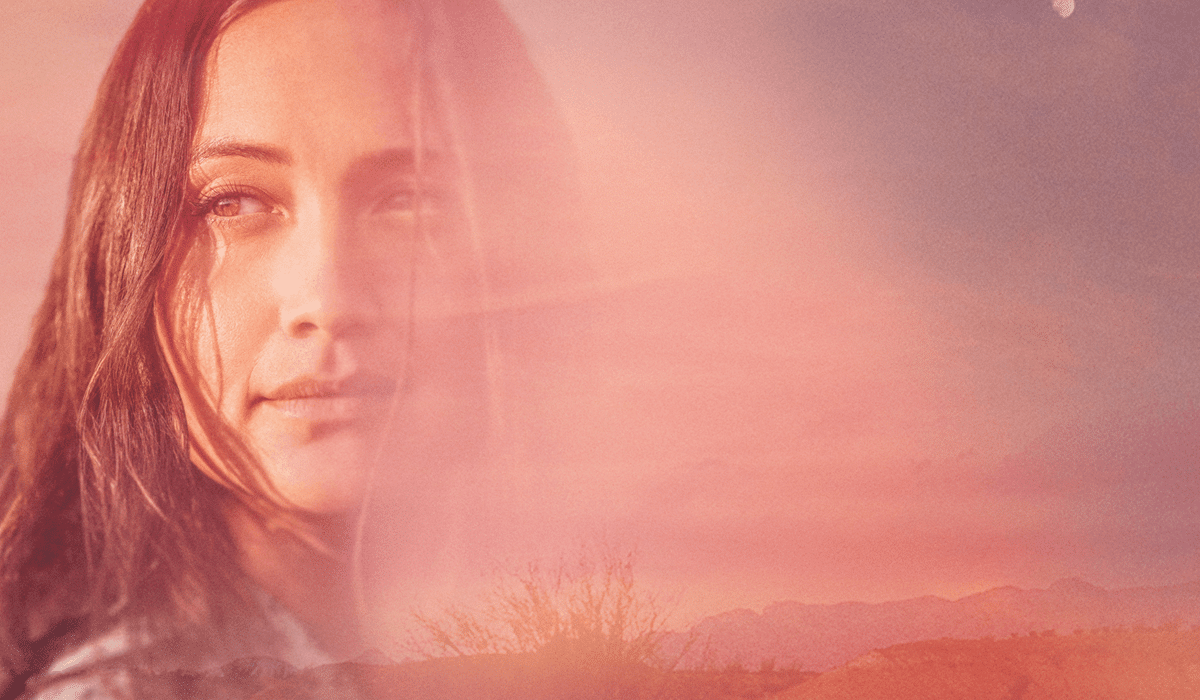Un être humain trébuche et s’effondre dans la rue. Chacun se précipite. L’heure n’est pas à réfléchir sur les inégalités tragiques de notre société mais à solliciter son altérité dans l’urgence. Le sauvetage abolit toute réticence à prodiguer une aide. L’homme est conduit à l’hôpital, la médecine le soigne avec dévouement. Quand l’homme sort de l’hôpital, il retrouve immédiatement le même environnement responsable de sa chute, les mêmes passants. Les regards se détournent. Le sentiment d’altérité a disparu. Les institutions retrouvent leurs propres lourdeurs, leur impuissance, et les citoyens, leurs engagements.
La perception de la misère est ainsi soumise à une double temporalité. Lorsque la situation est dramatique et urgente (en Ukraine par exemple), l’entraide est efficace et immédiate. Mais dès lors que la misère devient chronique – alors qu’elle n’est pas moins dramatique –, l’entraide perd de sa nécessité. C’est un phénomène habituel que l’on retrouve en médecine.
Les financements sont affectés à 99 % aux soins urgents et immédiatement efficaces (cancers, infections, maladies génétiques, etc.) et à 1 % à la prévention. Pourtant, la prévention limite aujourd’hui les maladies qui seront considérées demain comme urgentes. L’interaction entre les conditions sociales et les maladies est une évidence, mais cette relation ne parvient pas à susciter le moindre intérêt.
L’entraide sauve mais ne prévient pas. Le cortex cérébral ne se mobilise qu’en fonction de l’urgence. Si l’humanité n’avait réagi que de cette façon, elle aurait disparu. C’est en prenant soin des plus vulnérables, au-delà de l’urgence, qu’elle a survécu. Il faudrait s’en souvenir.