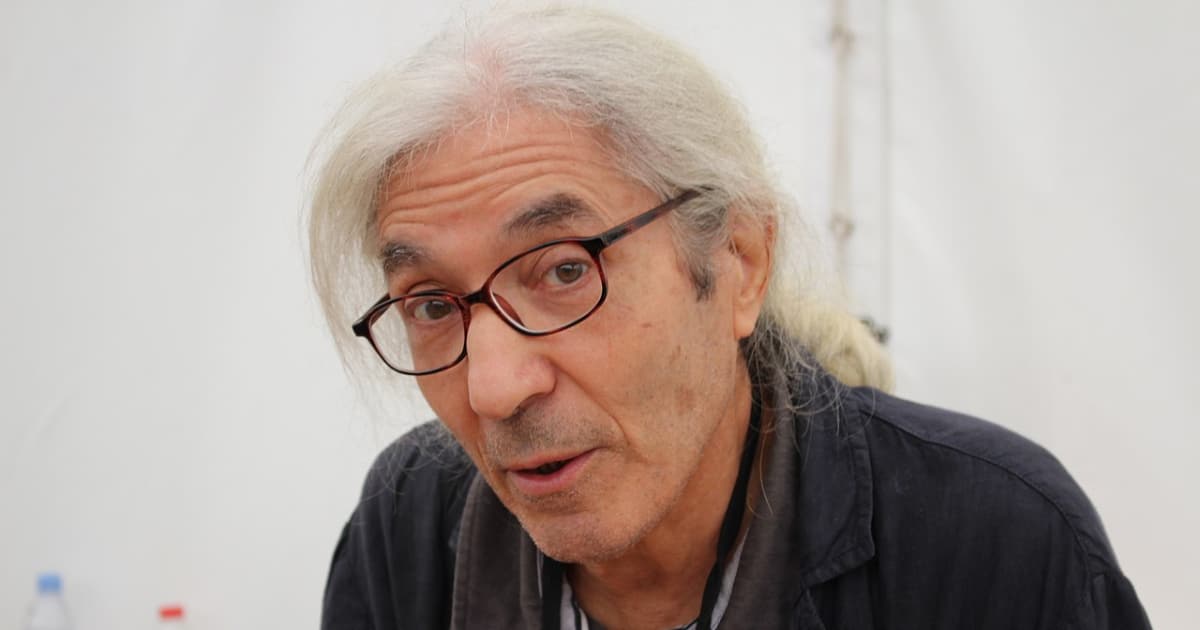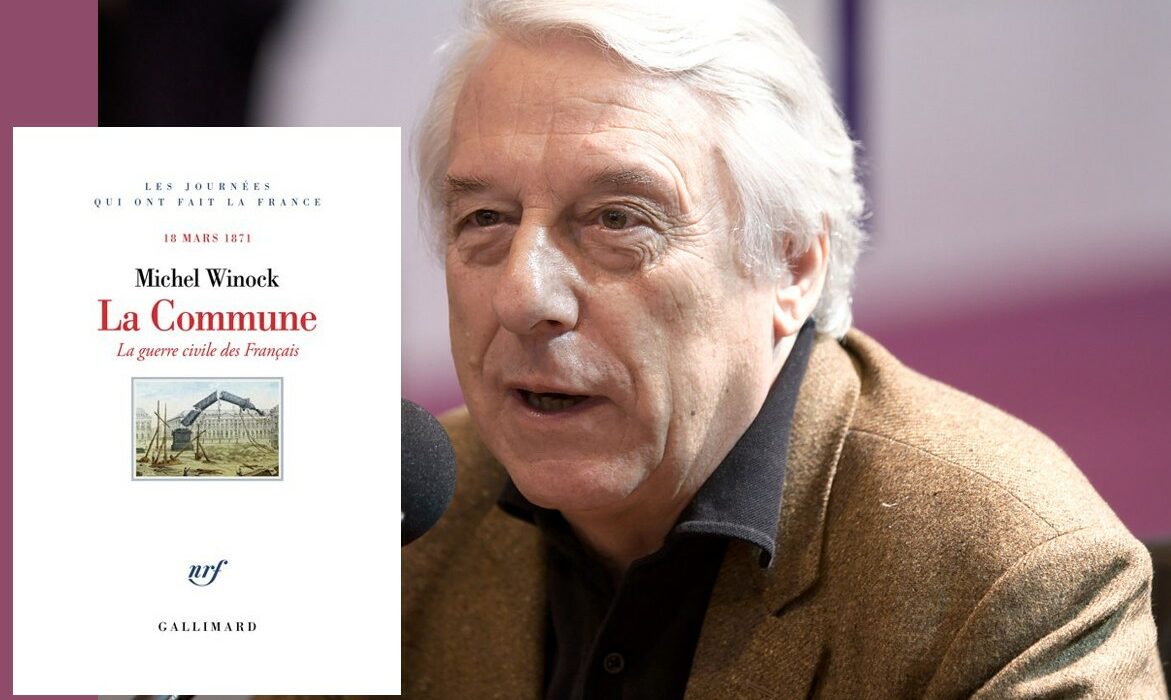Une diversité de peuples, de langues, de coutumes. Les peuples autochtones comptent près de 476 millions de personnes à travers le globe, selon les chiffres de l’Organisation des Nations unies (ONU). S’ils ne forment que 6 % de la population mondiale, ces peuples cumulent ensemble près de cinq mille cultures et sept mille langues différentes. Un patrimoine d’une incommensurable richesse que l’ONU espère participer à conserver.
À l’occasion de la Journée internationale des peuples autochtones, célébrée chaque année le 9 août depuis 1994, l’ONU fait un point sur les enjeux de l’essor de l’intelligence artificielle (IA) pour ces peuples. Cette technologie « peut être source de défis majeurs et d’opportunités prometteuses », estime ainsi l’organisation sur son site.
Le potentiel de l’IA pour les peuples autochtones
L’intelligence artificielle pourrait « contribuer à préserver les langues et les traditions orales menacées de disparition, à cartographier les terres ancestrales et à diffuser largement la sagesse autochtone afin de lutter contre le changement climatique », observe le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, dans une vidéo publiée sur le sujet.
Certains systèmes d’intelligence artificielle se font ainsi un point d’orgue à participer à la conservation du patrimoine mondial. C’est le cas, par exemple, de l’entreprise américaine Microsoft qui avait communiqué en juillet dernier sur le déploiement de son initiative Culture IA de Microsoft. Celle-ci « contribue à préserver les langues, les monuments et les objets culturels par le biais de répliques numériques et de partage de données », affirme la société dans un communiqué de presse.
« Lorsqu’une langue est insuffisamment représentée en ligne, elle risque d’être exclue des futurs services d’IA », avait ainsi expliqué Microsoft, indiquant « s’associer à des partenaires européens afin d’accroître la disponibilité des données multilingues », en Europe afin de « garantir que la richesse culturelle de l’Europe soit représentée et accessible dans le monde numérique ».
La nécessité d’inclure les peuples dans l’usage de la technologie
L’envers de l’IA pourrait toutefois représenter une menace pour la sauvegarde des cultures autochtones. Celle-ci peut refléter des biais, préjugés et préconçus déjà présents au sein des sociétés humaines. « Sans protection, l’IA peut renforcer les biais préjudiciables et l’exclusion, et conduire à une appropriation accrue de la culture et du savoir des peuples autochtones sans leur consentement », indique l’ONU sur son site. L’IA « risque de perpétuer d’anciens schémas d’exclusion, de présenter une image déformée des cultures et d’enfreindre des droits fondamentaux », prévient d’ailleurs le secrétaire général de l’ONU.
Pour éviter de renforcer ces effets dont sont déjà victimes les sociétés autochtones, le secrétaire général estime nécessaire « d’éliminer les obstacles qui entravent l’accès des peuples autochtones aux nouvelles technologies » ainsi que de « protéger la souveraineté de ces peuples en matière de données et leur droit à la propriété intellectuelle ». Pour cela, l’Instance onusienne permanente sur les questions autochtones a recommandé en avril dernier que « les entités des Nations Unies participant à la mise au point, à la gouvernance et à la mise en application d’outils d’intelligence artificielle et de technologies numériques veillent à ce que les peuples autochtones soient véritablement inclus dans les processus connexes afin qu’ils en tirent parti ».
Les peuples autochtones « ne sont pas seulement des utilisateurs de l’IA, ils sont aussi des cocréateurs, des décideurs et des détenteurs de droits », rappelle d’ailleurs une note d’intention des commémorations organisées ce vendredi 8 août (la Journée internationale des peuples autochtones tombant un samedi).