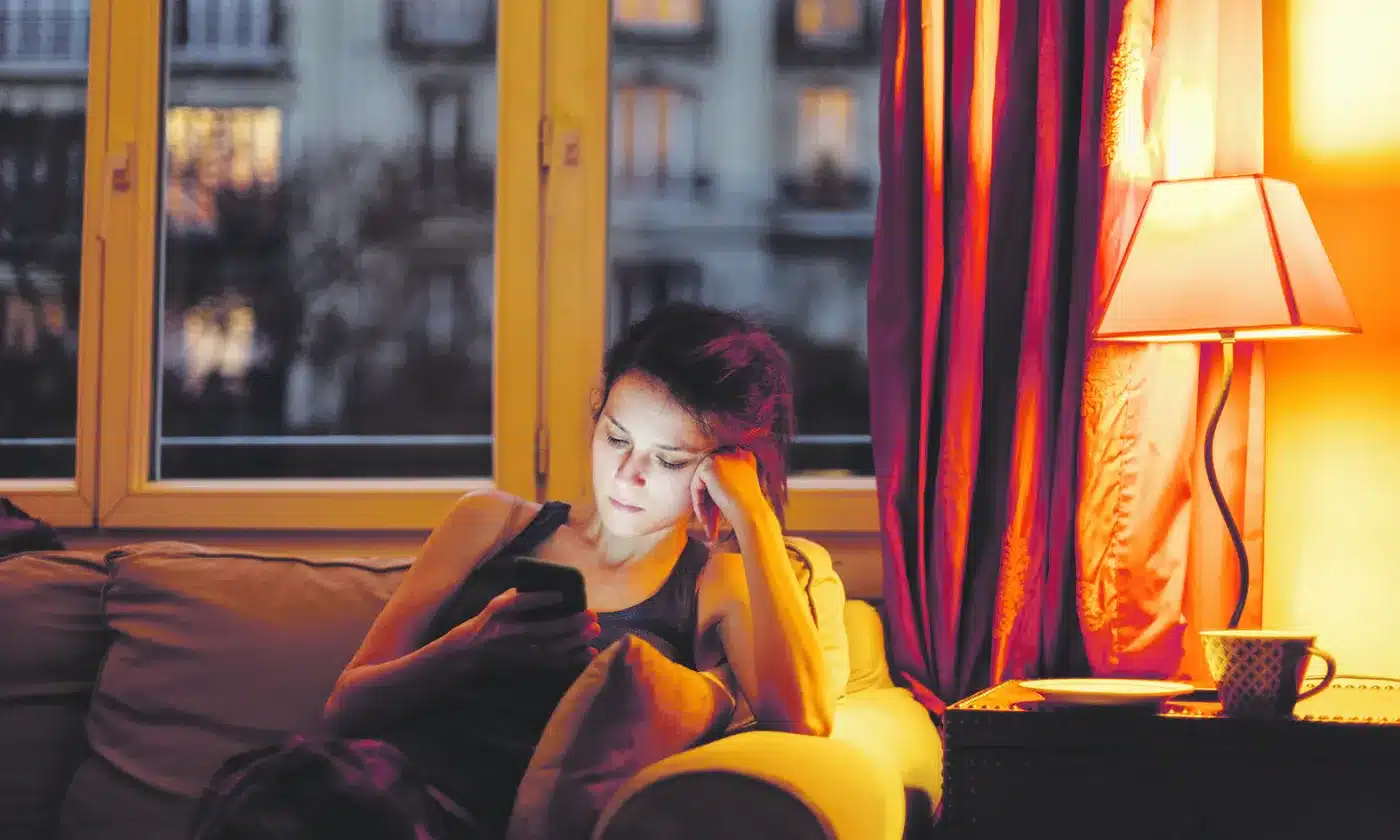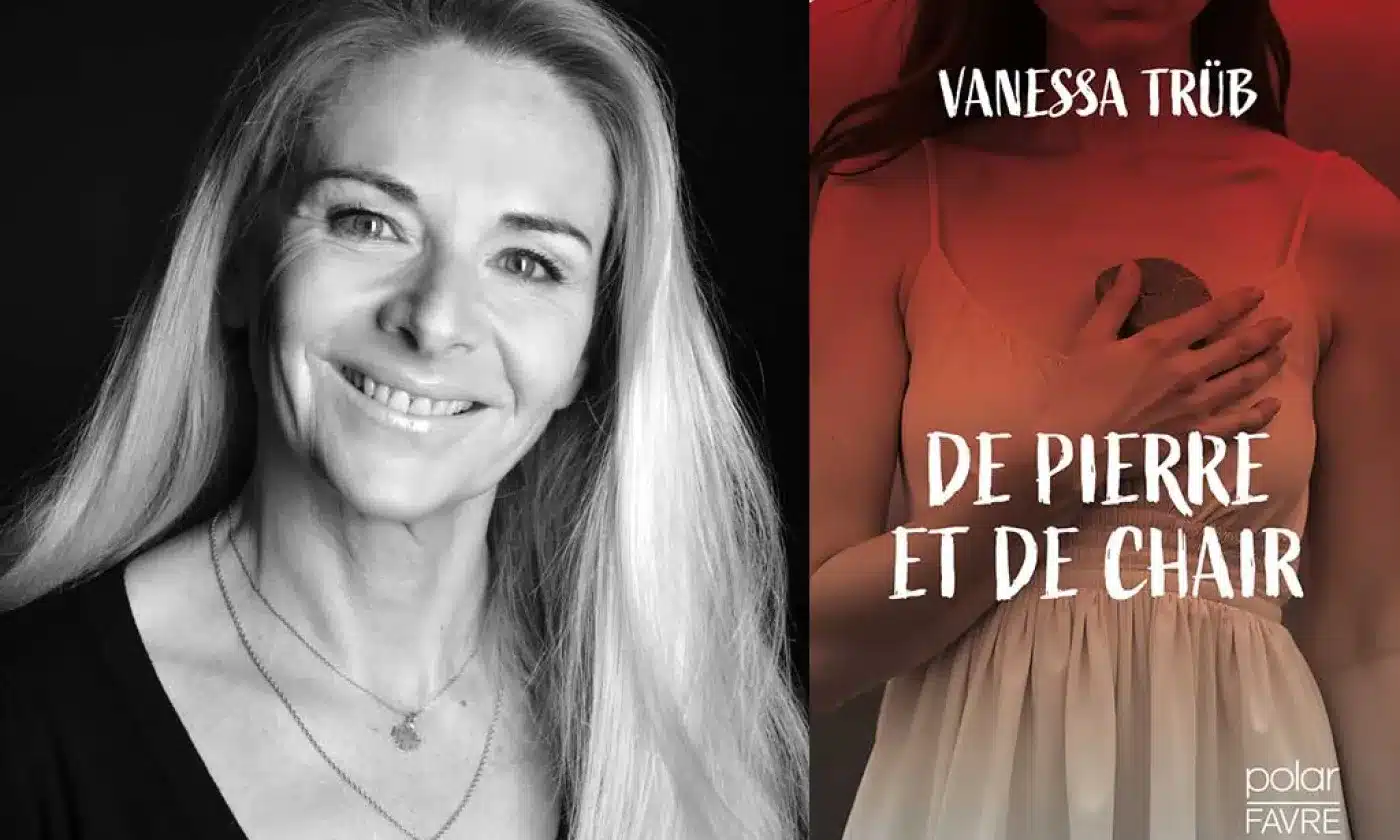C’est en étudiant l’activisme de femmes musulmanes féministes dans les années 2000, qui se sont mobilisées contre les lois interdisant le port du voile en Turquie et en France, qu’Amélie Barras, chercheuse en sciences sociales à l’Université de York (Canada), a eu l’idée de se pencher sur les ONG religieuses actives à l’ONU. « Ce qui m’a intéressée, c’est le discours de ces activistes qui expliquaient que même si elles ne parvenaient pas à changer le droit dans leur pays, elles souhaitaient pouvoir placer leur question à l’agenda international. » Une sorte de « pied dans la porte » pour faire avancer leurs idées.
Amélie Barras s’est donc demandé ce qui motivait les acteurs religieux actifs au sein de l’ONU et notamment de son Conseil des droits de l’homme, « où sont discutés de nouveaux standards, un espace intéressant si l’on réfléchit aux droits humains comme concepts en mouvement », réuni trois fois par an au Palais des Nations de Genève. Elle a réalisé une enquête de terrain entre 2016 et 2020, constituée d’observations, d’études de documents et d’entretiens avec des acteurs et des experts.
Quelles sont les ONG religieuses actives à Genève ?
Amélie Barras : La majorité d’entre elles sont des organisations chrétiennes, même si l’on trouve aussi d’autres groupes comme les bahaïs (religion monothéiste fondée au XIXe siècle en Iran, NDLR). C’est pourquoi ma recherche se focalise sur […]