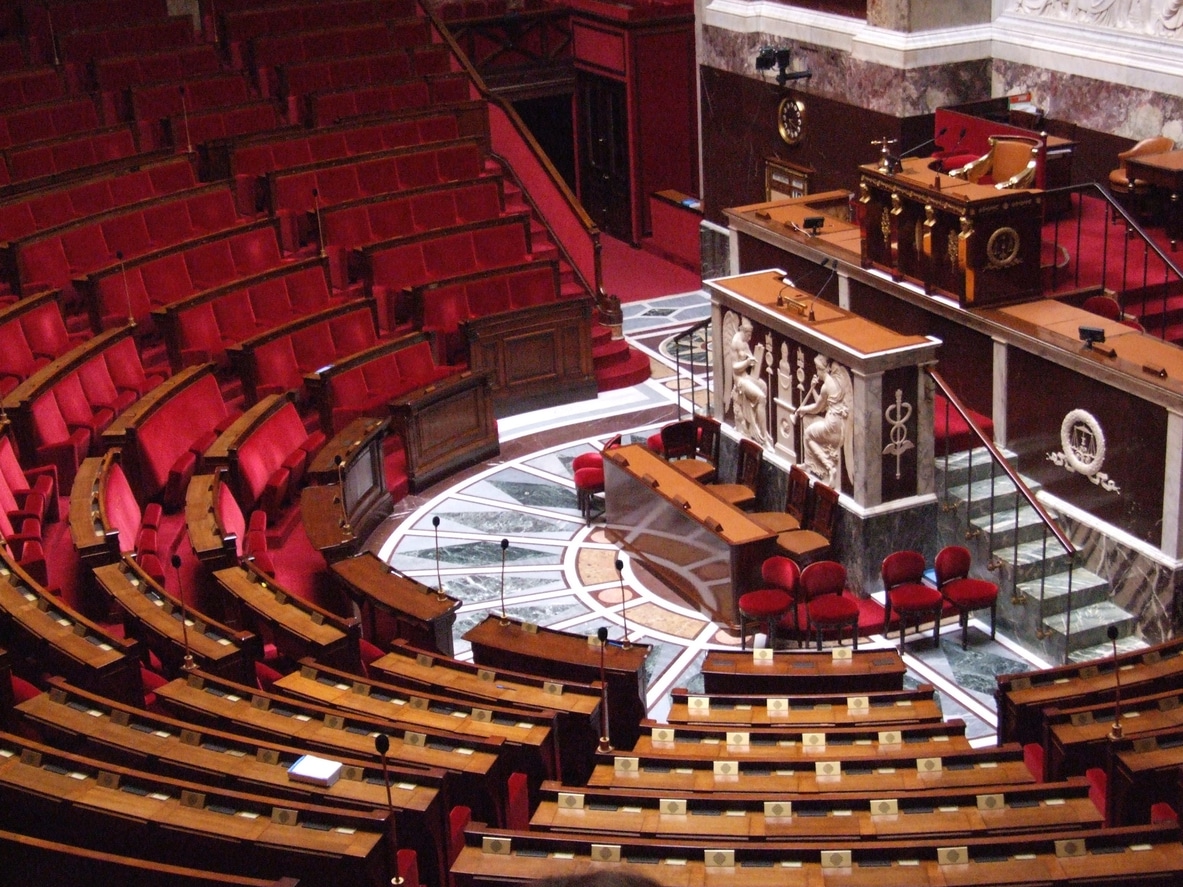«Qu’est-ce que l’Europe? C’est la Bible et les Grecs». Attirée par le vide et toujours «en guerre contre elle-même», l’Europe est tiraillée depuis longtemps entre tous ses héritages et traditions «dont aucune n’a jamais réussi à faire taire les autre», entre Socrate et Jésus. Ce qu’il y a de commun entre les deux, la notion d’infini (questionnement infini chez Socrate, singularisation infinie chez Jésus), elle en a fait l’outil de tous les débordements, de sa réussite et de son malheur. Aujourd’hui en pleine crise d’identité et de puissance, l’Europe ne pourra sortir du scepticisme et du nihilisme qu’elle a imposé à la planète qu’en assumant sa propre existence, en ayant «le désir, la confiance en soi, l’intelligence critique, la force imaginative de «se dépayser dans ses propres origines»».
Comme l’écrivait le grand philosophe tchèque Jan Patočka dans ses Écrits hérétiques sur l’histoire et dans son éblouissant Platon et l’Europe, le vingtième siècle a été marqué par le suicide de l’Europe. Depuis, dans notre frénésie reconstructrice, tout nous a conduit à éviter ses conflits fondateurs, par crainte de nous entredétruire encore.
En résumé: parce que nous avons subi le joug des pires États totalitaires, nous avons reconstitué des États les plus faibles possibles. Parce que nous avons eu naguère le capitalisme le plus sauvage, nous n’avons eu de cesse de le brider — alors qu’ailleurs il triomphe. Enfin, l’effroi des guerres de religion et de l’intolérance nous a conduit à une forme de sécularisation irreligieuse très spécifiquement européenne.
L’Europe s’est construite sur ce vide central, qui pourrait être pensé délibérément comme une chance, mais qui semble vécu comme un affaissement, un sol dérobé sous nos pas, un vertige. Or, comme disait Malraux, on marche mal sur le vide ! Telle est aujourd’hui la question européenne, et c’est l’objet de mon dernier livre sur l’Europe (1), dont je voudrais ici reprendre la ligne de crête.
En effet, cependant, le vieux monde européen existe et persiste, en dépit de sa fragilité, et de cette sorte d’évidement, d’énucléation de ce que Ricœur aurait appelé son noyau éthico-mythique. C’est ce noyau que nous tenterons d’interpréter, notamment dans l’écart fondateur entre Socrate et Jésus, entre la tradition philosophique et la tradition chrétienne, mais cet écart ne saurait eclipser bien d’autres écarts non moins inventifs, et pleins de promesses inachevées.
Et c’est à partir de ce noyau que nous tenterons de penser le devenir européen dans la mondialisation, et dans un monde de plus en plus vulnérable, moins menacé par un fin du monde apocalyptique que rongé par une sorte de scepticisme, de dérobade face à nos responsabilités (soit par la recherche d’un perpétuel ailleurs, soit par le leurre d’une clôture protectrice), de relativisme désabusé quant à l’existence même du monde, quant à l’existence des autres et finalement de nous-mêmes.
La question européenne : l’attrait du vide
L’Europe semble au bord de l’implosion, et le monde disserte de la question européenne comme jadis les Européens traitaient de la question orientale ! C’est le résultat de son histoire singulière, chaque grand défi appelant des grandes réponses, mais soulevant de nouveaux problèmes… Reprenons. La réponse aux guerres de religion qui ont déchiré l’Europe a été l’absolutisme étatique, mais surtout la sécularisation entendue comme une sortie de la religion. La réponse à la brutalité de l’essor du capitalisme a été le socialisme et finalement l’Europe sociale. La réponse aux pouvoirs totalitaires du 20e siècle a été la démocratie et les Droits de l’Homme, mais aussi finalement un immense affaiblissement politique. Or cette faiblesse est très dangereuse dans une époque comme la nôtre, une époque de périls mais aussi de réorientations énergiques nécessaires face aux fractures migratoires, aux fractures sociales, aux sociétés qui se défont, face aussi aux périls écologiques planétaires, et même face au choc des cultures, ou des incultures.
Il faut dire que l’Europe et le monde moderne dont elle a été, pour le meilleur et pour le pire, le champion et le héraut, ont été victimes d’un triple mythe, qui provient lointainement peut-être d’une certaine théologie du salut, ou peut-être des Lumières, mais qui s’impose au 19e et au 20e siècles : le mythe du dépérissement de l’État, celui du dépérissement du Capital, et celui du dépérissement de la Religion. C’est à l’ombre de ce mythe du dépérissement qu’on a vu se déployer les États les plus totalitaires de l’histoire humaine, que s’étend aujourd’hui le capitalisme le plus prédateur, et que nous arrivent des formes de religion ensauvagées, justement parce que nous avons renoncé à les canaliser, à les instituer et les réguler. Le paradoxe, c’est que ce sont les pays les plus marqués par la croyance dans la fin inéluctable du capitalisme qui se trouvent aujourd’hui parmi les pays où le capitalisme le plus dérégulé propage ses effets les plus désastreux. Le mythe du dépérissement de la religion, semblablement, a autorisé la prolifération d’un n’importe quoi religieux, à la fois hors institutions et hors tradition critique, ce qui a interdit d’en penser tant les formes spécifiques […]