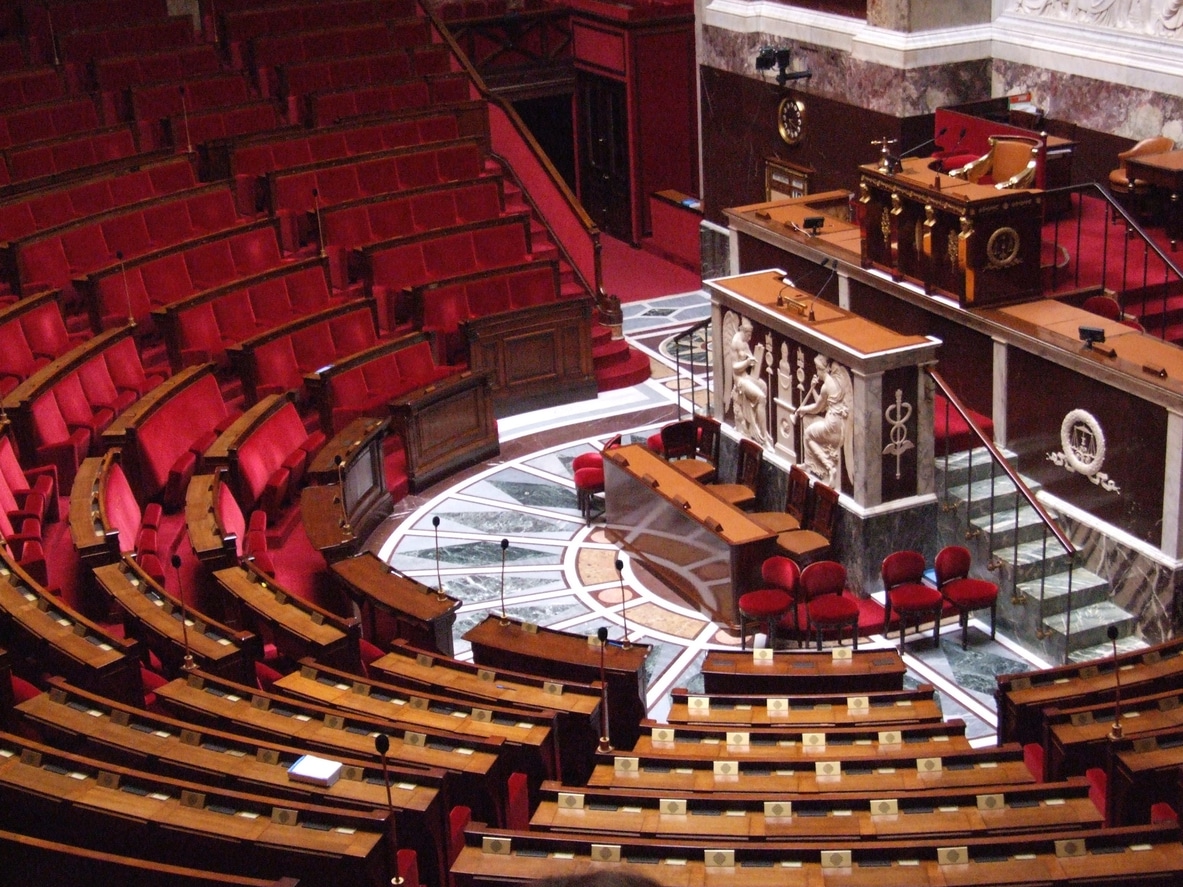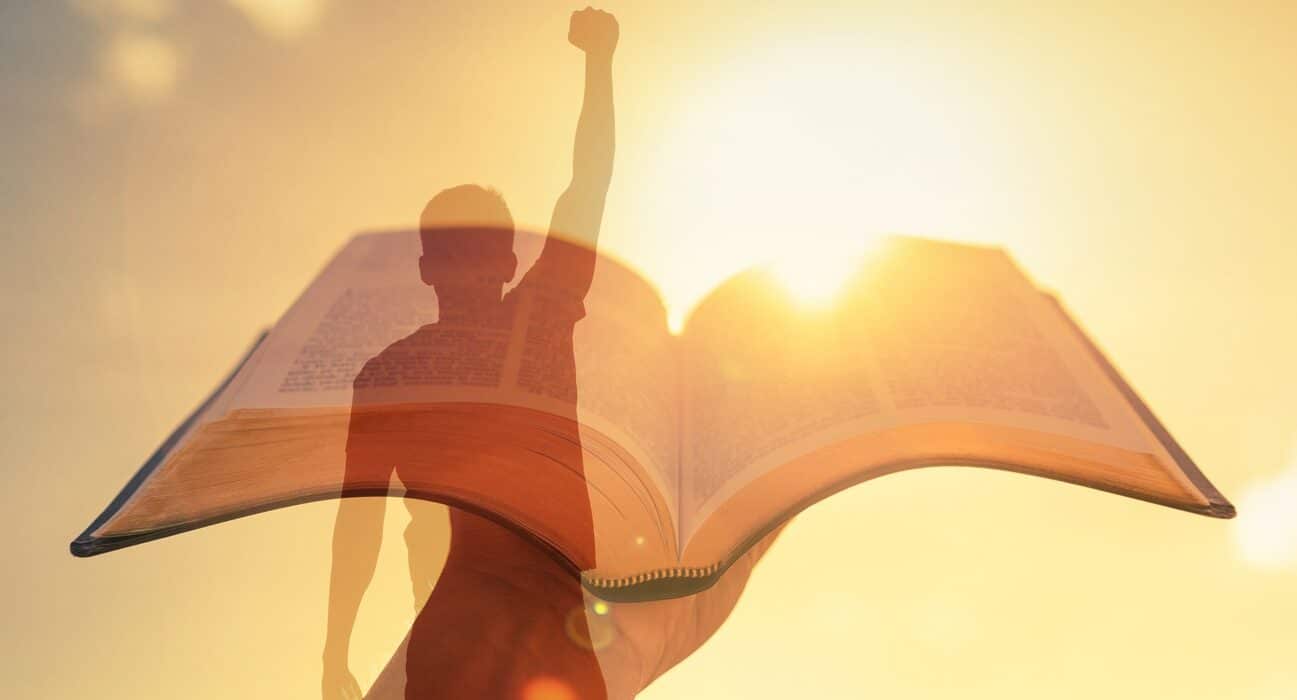Questions africaines
L’Occident s’interroge, actuellement, sur la politique africaine qu’il a menée dans les décennies passées. Peut-être a-t-il fallu que le Sud global, selon l’expression actuelle, l’incite vivement à reconnaître ses connivences avec des régimes corrompus et son soutien apporté sans scrupule à des ethnies alliées devenues meurtrières, et à réparer autant que faire se peut les blessures de la mémoire.
En ce qui concerne la France, le 12 août dernier notamment, une lettre rendue publique du président Emmanuel Macron adressée à Paul Biya, son homologue camerounais, a établi la responsabilité de notre pays dans la guerre menée contre des groupes insurrectionnels luttant pour l’indépendance, et dans la persistance de ces actions même après la décolonisation. Dans ces périodes agitées, des massacres de masse ont eu lieu.
Pour le Rwanda, toute clarté ne semble pas avoir été faite dans le parti pris par la France à l’égard du génocide des Tutsi: le 21 août, il y a quelques jours, deux juges d’instruction parisiennes ont ordonné un non-lieu en faveur d’Agathe Habyarimana, soupçonnée d’entente en vue du déclenchement du génocide et installée en France sans statut légal, après avoir été exfiltrée de son pays en avril 1994. Cette décision scandalise le Parquet national antiterroriste et les parties civiles; elle est dénoncée comme une «aberration révoltante» par le collectif de leurs associations (1). L’instruction «incompréhensiblement bâclée», selon leurs termes, laisse peser la suspicion, de leur point de vue, sur l’impartialité de la justice et fait planer l’idée que l’examen de conscience n’est pas achevé, dans ce cas précis.
L’actualité brûlante du sujet se manifeste aussi à travers les productions des artistes et des intellectuels: Michel Bussi, célèbre écrivain, vient tout juste de publier un roman, Les ombres du monde, qui raconte cent jours de terreur et de sang des massacres rwandais, sur un mode à la fois historique et fictionnel. Au micro des stations de radio où il est invité à présenter son livre en cette rentrée littéraire, il appelle avec véhémence la France à clarifier son récit des événements, sinon son action passée (2).
Il se trouve que la rentrée littéraire des éditions Jas sauvages fera écho à ces sujets, avec la parution du recueil intitulé Sous l’arche d’eucalyptus (3), qui évoque lui aussi les événements du génocide rwandais. Jacqueline Wosinski, qui fréquente les paroisses de l’Église protestante unie dans la vallée du Buëch, nous a confié cette collection de textes, écrits entre avril 1994 et la commémoration des trente ans du massacre, en avril 2024.
Le génocide rwandais à travers un recueil de poèmes
Pourquoi ajouter un recueil de poésie à la littérature abondante qui se diffuse sur cette période de l’histoire récente ? Sans doute parce qu’il s’agit là d’un genre littéraire bien particulier, qui affine notre perception et notre sensibilité humaine. On pourrait lui appliquer les vertus qu’un personnage de Dostoïevski reconnaît à la prière, dans Les Frères Karamazov, car ces deux voies d’inspiration éclairent mystérieusement les […]