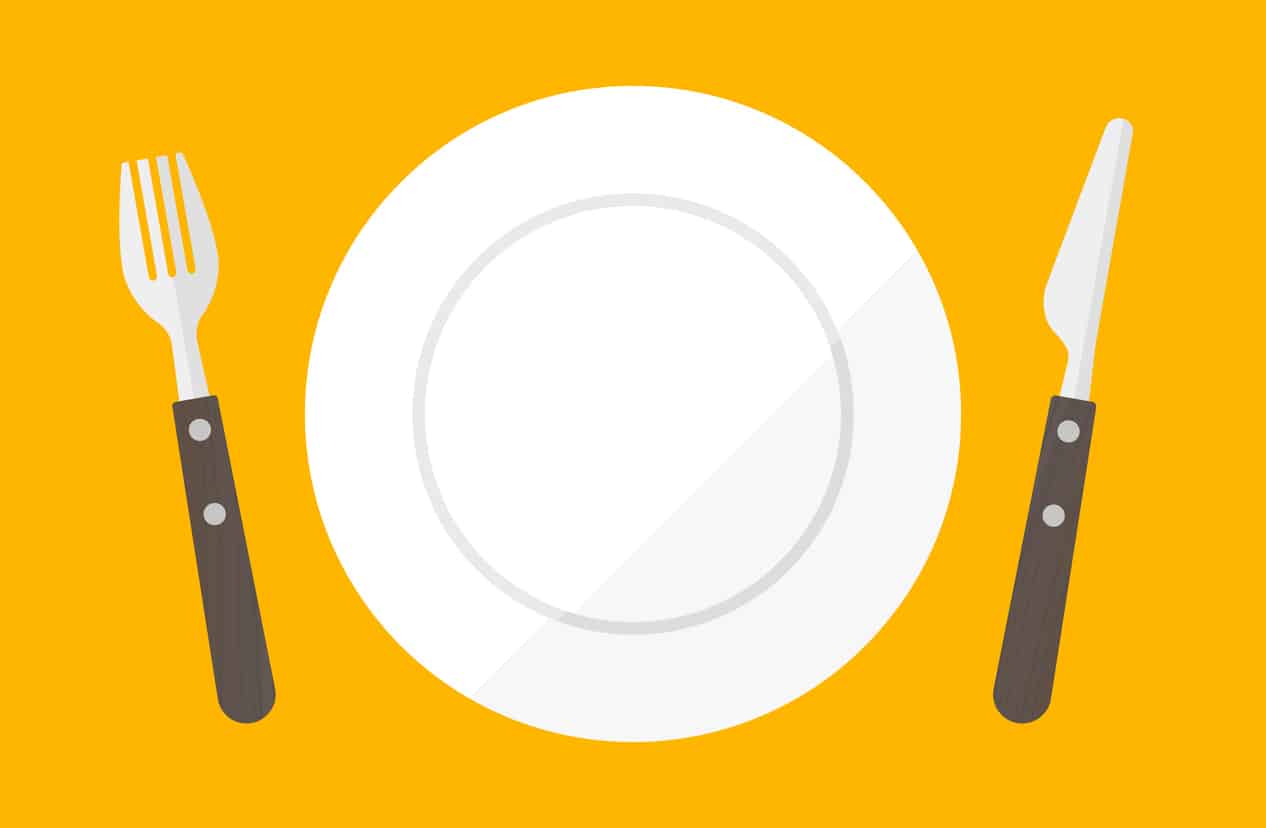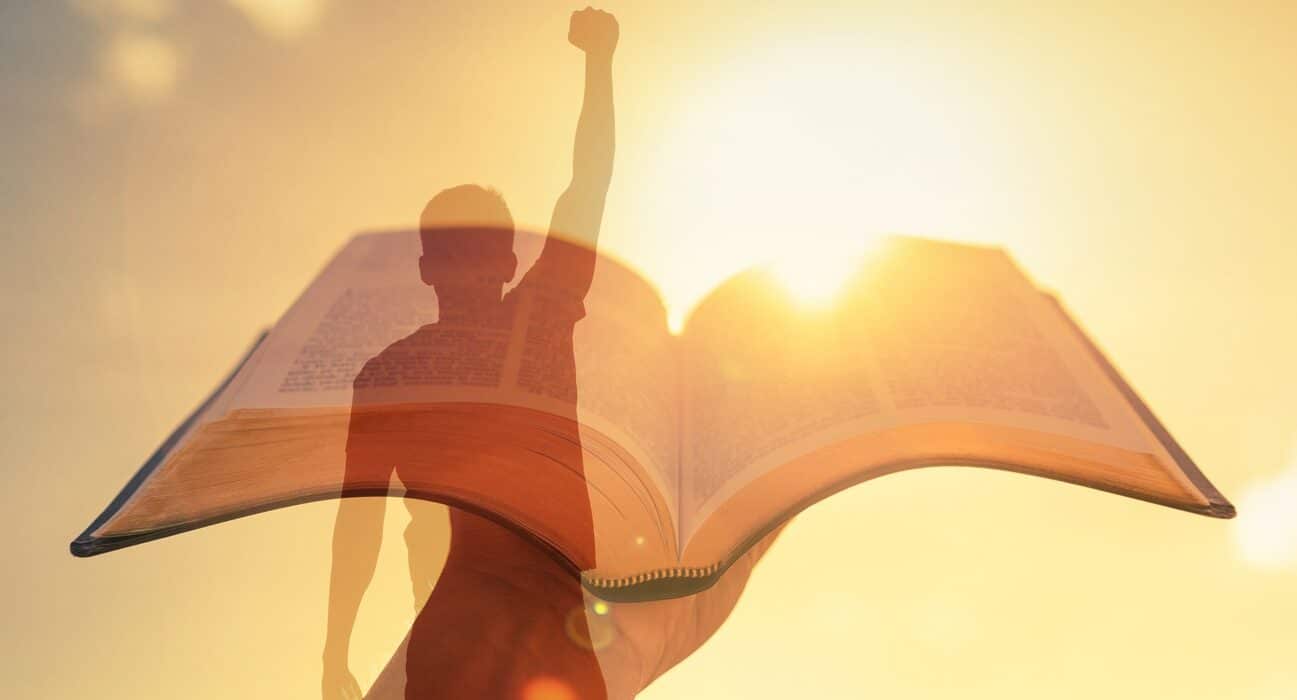Dans un hôpital parisien, la responsable de la chambre funéraire termine un soin du visage pour un patient décédé quelques heures plus tôt. Ses mains trahissent une douceur infinie. Elles semblent planer, comme bénissant ce corps inconnu.
Prendre soin est si naturel
Comme on l’interroge, elle ose quelques mots : « Vous voyez, je prépare ce monsieur, je fais passer les gens. » Ce que sont sa pratique, sa religion, son inspiration du moment, nul ne le sait vraiment. Mais cette femme allie le soin à la spiritualité, avec un naturel imprévu dans un établissement aussi hautement technicisé.
Que ce naturel soit imprévu, cela amène à s’interroger. Jadis et jusqu’au milieu du XIXe siècle, la quasi-totalité des soins prodigués en institutions l’était par des femmes. Religieuses ou laïques, elles aidaient les personnes qui leur étaient confiées à guérir physiquement et passer un cap difficile sur les plans psychique et spirituel.
Le religieux chassé du soin
Mais avec les grandes découvertes médicales, la spécialisation des soins a augmenté leur technicité. L’industrialisation a également modifié la gestion des établissements, en limitant l’acte de soin à un geste technique calibré dans une procédure et dans le temps. L’espace spirituel ou religieux du « prendre soin », fait de rencontre et de gratuité, était dès lors écarté pour rejoindre la sphère de l’intime et de la conviction personnelle.
Dans le même temps, la société se laïcisait. Les réponses religieuses peinaient à s’adapter au progrès scientifique. Les sœurs s’éloignaient de salles de soin technicisées. La quête de sens de celui qu’on nommait « l’usager » n’était alors pas réellement identifiée.
Promouvoir l’humain
Il apparaît aujourd’hui que ces progrès techniques et rationnels risquent de morceler l’être humain, disloqué entre son corps, son mental, ses relations sociales et son espérance. Certes, de plus en plus d’établissements souhaitent intégrer le patient au cœur du soin. Certes, l’État a rendu nécessaire l’existence d’une aumônerie dans les lieux de privation de liberté. Mais face aux enjeux humains, ces décisions paraissent anecdotiques.
Certains lieux comme la fondation Les Diaconesses de Reuilly choisissent en revanche d’innover, en remettant la spiritualité au cœur du soin. Par la réflexion éthique, par la place donnée à l’accompagnement spirituel, ils revendiquent l’unité de l’être : corps, psychisme, lien social et spiritualité. On ne peut prendre soin de l’une des dimensions sans impliquer les autres.
Résistance spirituelle
Est-ce le reflet d’une manière plus féminine de prendre en compte la vie humaine ? Le fait est que lors des formations à l’écoute, à l’éthique ou à la spiritualité, les soignantes sont les premières à témoigner d’une vocation initiale vidée de son sens par le rythme et l’automatisation des gestes médicaux. La responsable de la morgue aux mains inspirées n’est pas une exception: elle témoigne d’une résistance spirituelle de femmes dans l’ombre.
Historiquement, les institutions qui ont maintenu un accompagnement fort ont principalement été inspirées par des femmes, laïques engagées ou sœurs de communautés religieuses.