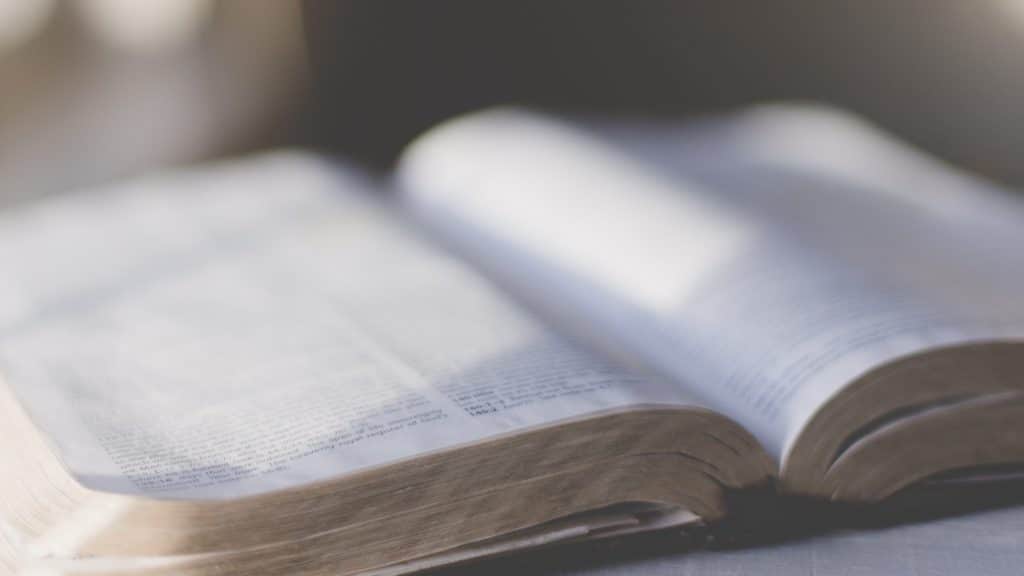Ce mardi 8 juillet, l’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, dite loi Duplomb, du nom du sénateur qui en est l’auteur.
Nous considérons que contrairement à ce que son intitulé indique, ce texte n’est pas à même de répondre aux revendications du monde agricole, qui souhaite avant tout pouvoir vivre dignement de son travail et qui s’inquiète au sujet du renouvellement des générations, véritable défi pour la décennie à venir. En effet, il se cantonne à revenir sur un certain nombre de normes environnementales qui permettent une production de qualité sur le sol français. Parmi les reculs les plus problématiques, nous noterons :
- L’article 2, qui vise à réautoriser des néonicotinoïdes, appelés « tueurs d’abeilles » en raison de leur impact nocif sur les pollinisateurs. Soumise à une simple clause de revoyure à trois ans, cette autorisation n’est pas temporellement limitée tant qu’il n’y a pas d’alternative « techniquement fiable (…) et financièrement acceptable ». Cette définition, au-delà de sa formulation ambigüe, revient à écarter les techniques de biocontrôle, efficaces mais souvent plus complexes à mettre en œuvre, ainsi que des approches alternatives de lutte contre des ravageurs telles que la diversification des cultures.
- L’article 3, qui permet de relever les seuils des élevages nécessitant une autorisation environnementale de 40 000 à 85 000 poulets et de 2000 à 3000 porcs par exemple.
- L’article 5, qui consacre les mégabassines comme « d’intérêt public majeur », réduisant donc les recours possibles alors que ces infrastructures ne bénéficient qu’à un nombre réduit de producteurs, principalement de maïs destiné à l’alimentation d’animaux d’élevage, et préempte une ressource en eau plus que jamais à préserver dans un contexte de changement climatique.
Les conséquences néfastes de ces articles pour la biodiversité, la santé humaine et le bien-être animal sont préoccupantes.
De plus, le parcours chaotique de cette loi est problématique d’un point de vue démocratique. En effet, l’adoption d’une motion de rejet préalable par les partisans du texte à l’Assemblée nationale a privé les citoyens d’un débat parlementaire pourtant essentiel sur les sujets agricoles et liés à l’alimentation. De ce fait, le texte a été discuté en Commission mixte paritaire, par un groupe de sept députés et sept sénateurs, à huis clos. De plus, les dispositions adoptées sont loin de faire l’unanimité parmi la population. Un sondage récent a par exemple montré que 83 % des citoyens français sont favorables au maintien de l’interdiction des néonicotinoïdes[1].
Sensible aux conséquences des activités humaines sur la création, A Rocha France regrette l’adoption de ce texte qui ne répond pas aux véritables enjeux de l’agriculture. Celui-ci pousse à une industrialisation de la production alimentaire au détriment de la biodiversité, d’un partage équitable de la ressource en eau, ou encore de la qualité des sols et des nappes phréatiques.
Convaincus qu’agriculture et nature ne doivent pas être opposées, nous considérons que d’autres voies sont possibles pour atteindre la souveraineté alimentaire.
S’aligner sur des États moins-disant en terme environnemental est une fausse bonne idée, puisqu’il ne sera jamais possible d’être compétitif avec des pays où les coûts de main-d’œuvre notamment sont bien moindres et c’est donc sur la qualité de l’alimentation que la France et l’Europe doivent se distinguer.
[1] www.generations-futures.fr/actualites/sondage-duplomb-pesticides