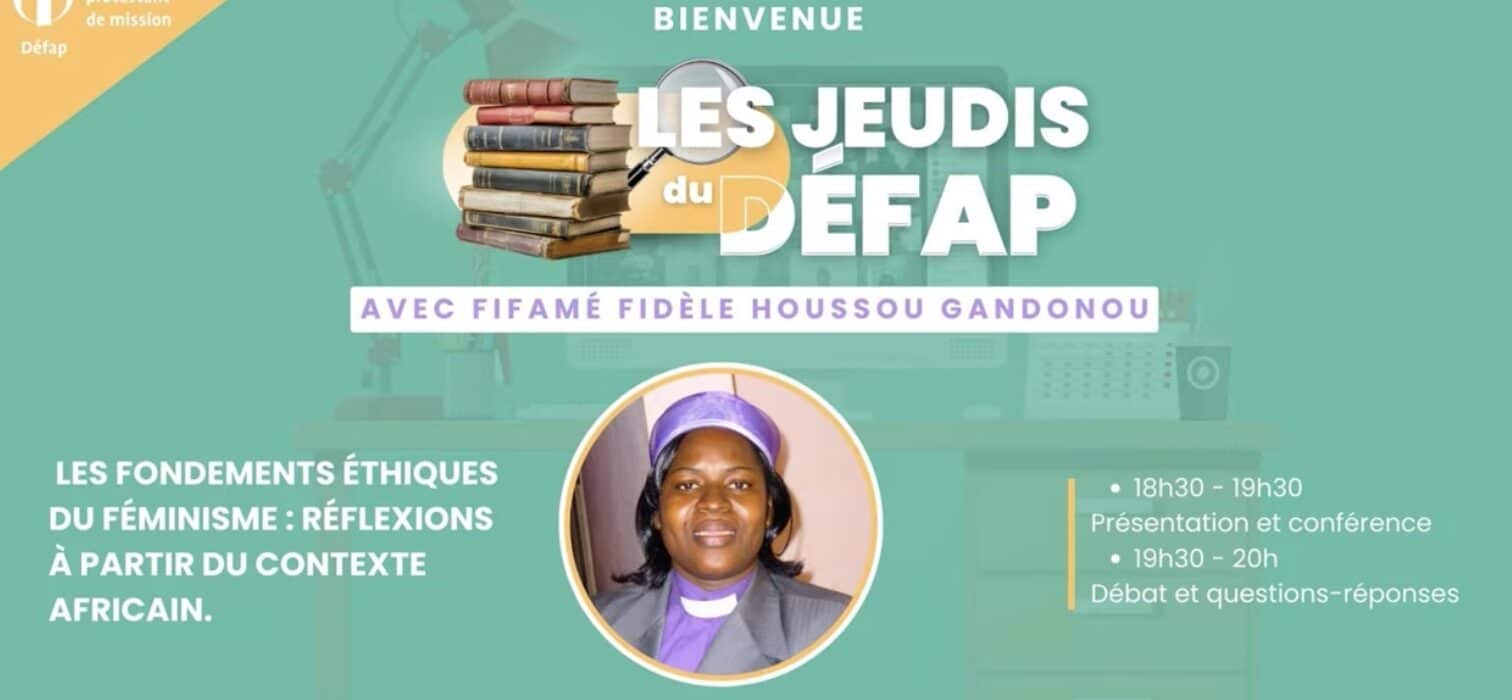Pour l’historien Vincent Genin, “la laïcité est devenue une religion civile”. Dans un entretien accordé à Ouest France, l’auteur d’Histoire intellectuelle de la laïcité, de 1905 à nos jours, s’est plongé dans l’histoire de celle-ci. Son ouvrage débute en 1905, au moment de la loi de 1905 qui marque la séparation de l’Église et l’État. “Elle a été suivie de trois autres lois pour que la pilule soit moins dure à avaler pour l’Église catholique qui ne supportait pas l’idée, notamment dans l’Ouest, de devoir faire un inventaire de ses biens”, explique l’historien. Il rappelle que bien qu’athée, le député Aristide Briand, chargé d’appliquer la loi, était dans la pratique très tolérant à l’égard de l’Église. “Il était pour la liberté religieuse et de conscience. Il n’opprimait pas les religions. N’était-ce pas là une attitude républicaine ?” souligne-t-il.
L’historien ajoute que, si l’on parle généralement de la laïcité, il y en a plusieurs. “Sur le plan juridique, il y a sept régimes de laïcité au sein de la République française”, confirme-t-il. En plus de la loi de 1905, qui régit les relations entre l’État et les cultes, il y a du concordat en Alsace et en Moselle. Là, les cultes sont financés par de l’argent public des cultes. Il y a aussi les lois Ferry sur la laïcisation de l’école publique. Celles-ci ont été votées en 1882. “L’outre-mer est également un laboratoire passionnant. En Guyane par exemple, il y a un autre régime de régulation des cultes”, poursuit l’historien.
Un “glissement”
Pourtant, plus d’un siècle plus tard, le principe de laïcité est encore régulièrement au cœur de débat. “Depuis l’affaire dite du foulard en 1989 [trois élèves avaient été exclues d’un collège de Creil, dans l’Oise, car elles refusaient d’enlever leur voile], la laïcité est devenue une valeur. Des juristes, des éditorialistes, des philosophes, que l’on entend beaucoup et que les pouvoirs politiques écoutent beaucoup, ont contribué à ce glissement”, décrit Vincent Genin.
Pourtant, aux yeux du spécialiste, ces personnes ont une expertise très limitée en matière de laïcité. Or le passage de principe à une valeur s’apparente à une orthodoxisation. “Comme lorsque Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l’Éducation nationale, estimait qu’il fallait s’habiller à l’école publique de façon laïque. Il y a aussi eu cette campagne de communication en 2021 qui s’appelait ‘C’est ça la laïcité’ et montrait des enfants dans différentes situations. Mais qu’est-ce que cela veut dire ?” illustre-t-il.
“Je partage la vision de Paul Ricœur”
L’historien ajoute que la loi de 2004 sur l’interdiction des signes ostensibles à l’école publique a été un autre moment clé. Selon lui, elle a eu pour effet de sacraliser l’école, d’en faire une sorte de sanctuaire. “Mais les enfants se parlent, se confrontent, se bagarrent aussi parfois à l’école… Je partage la vision de Paul Ricœur qui plaidait plutôt pour une laïcité de confrontation. C’est assez irresponsable de concevoir l’école comme une espèce de cocon. La confrontation n’est pas belliqueuse, elle permet de limer son cerveau au cerveau de l’autre, comme disait Montaigne”, explique Vincent Genin à Ouest France.
Si bien qu’aujourd’hui, il estime que la laïcité est devenue “une religion civile. Concevoir la laïcité comme des libertés qui existent dans les limites de l’ordre public est une conception malheureusement assez minoritaire aujourd’hui. Elle est devenue plus bruyante avec un goût du fait divers. On parle de laïcité quand il s’agit de cantine scolaire, de voile, d’une altercation… Parce qu’elle est méconnue, la loi est totémisée”, continue-t-il.
“Distinguer ce qui relève ou non de la laïcité”
Si bien qu’aujourd’hui, la société attend trop de choses de la laïcité. “Il faut savoir distinguer ce qui relève ou non de la laïcité. On l’a vu avec le dramatique assassinat de Samuel Paty. Le problème relevait de la liberté d’expression, pas de la laïcité. Cette confusion fait que l’on confond laïcité, Islam, immigration…” différencie-t-il. L’historien rappelle également qu’il n’y a qu’en France que la laïcité est considérée comme une valeur républicaine. Si bien qu’elle est associée à ses problèmes qu’on attend d’elle qu’elle soit la panacée.
Ainsi, dans la pratique, en France le nationalisme passe par la laïcité. “Elle en est le vecteur malheureux et malgré elle”, juge Vincent Genin. Originellement défendu par la gauche et la droite modérée, le principe de la laïcité a peu à peu été récupéré par l’extrême droite. Il y a d’abord eu le rapport de François Baroin sur la nouvelle laïcité au début des années 2000, puis la loi de 2004. Le détachement du droit vers le politique a engendré une idéologisation.
“Racisme”
“Quand on parle de comportement laïque, pour moi, c’est une violation même du principe de laïcisation. On veut réintégrer le corps à un nouveau dogme, au nom de valeurs républicaines qui cachent très mal un nationalisme ou un racisme anti-musulman. Ce principe détourné à coups de glissements politique et sémantique mérite que l’on sonne quelques alarmes. Sans être alarmiste, mais avec fermeté”, conclut l’historien.