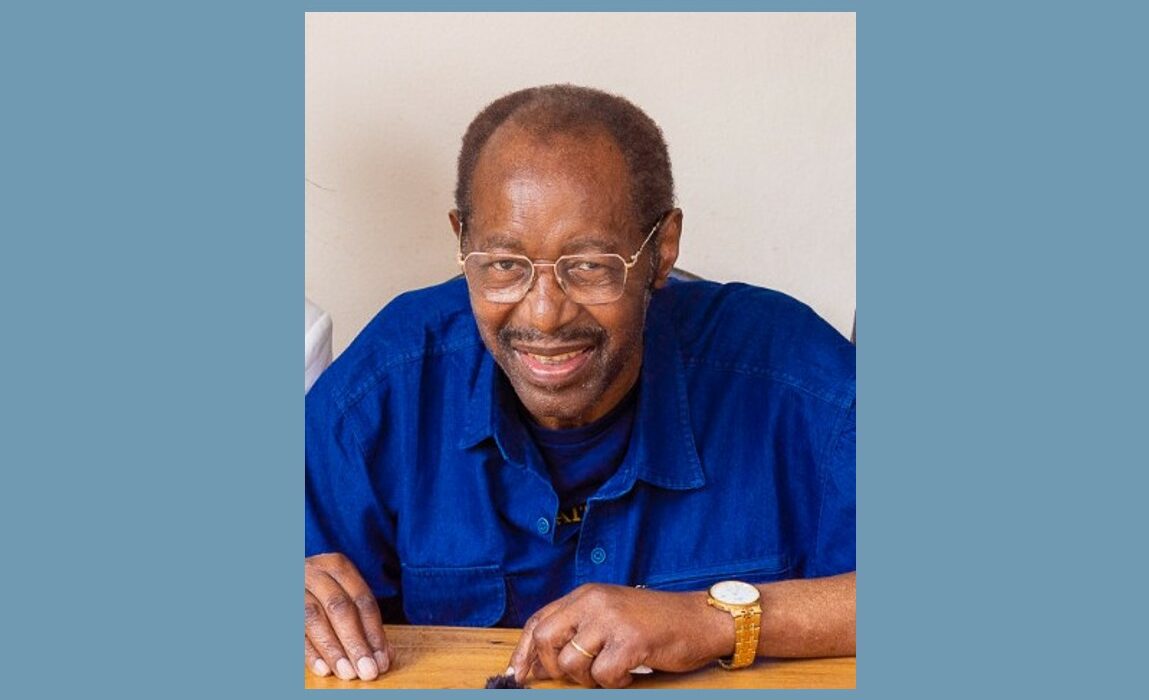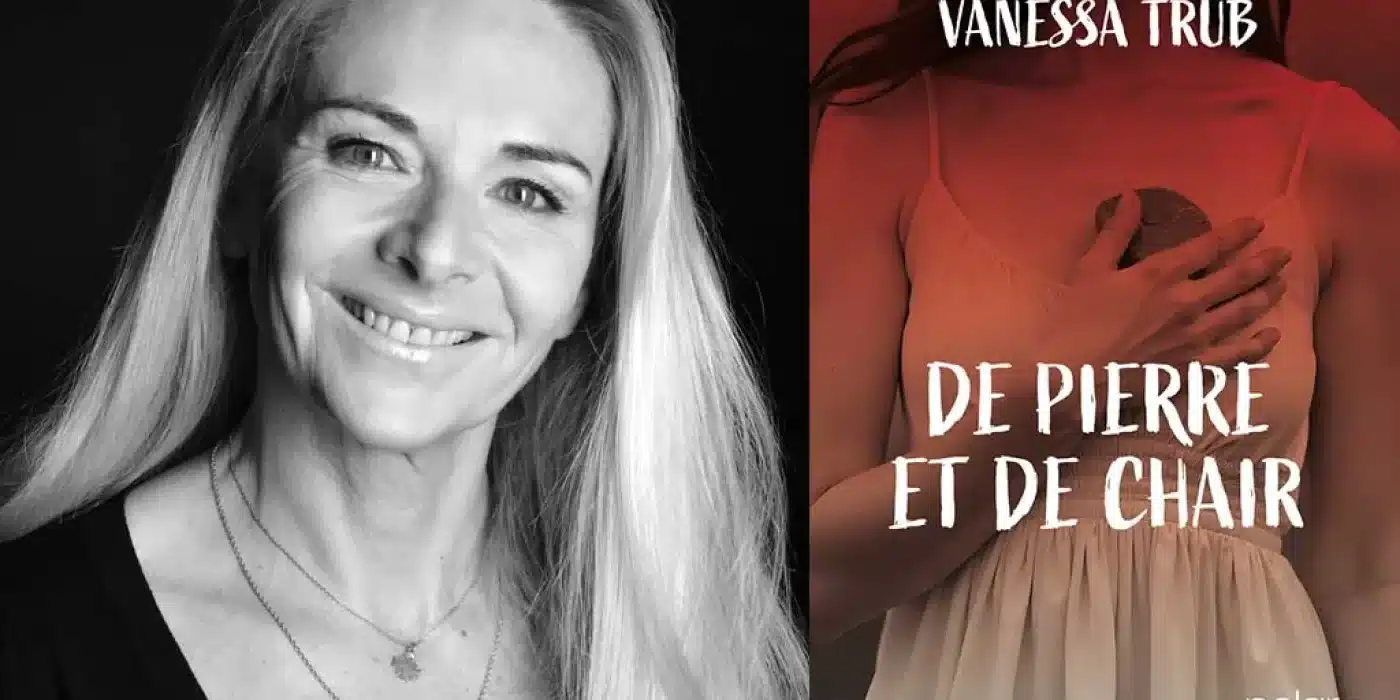Par Thierry Sibieude, président de FAIR6 et professeur émérite, fondateur de la chaire Entrepreneuriat et innovation sociale de l’ESSEC
L’utilité sociale consiste à répondre à un besoin non couvert, à recréer du lien, à améliorer le bien commun. Elle se révèle encore plus précieuse lorsque ce besoin est ignoré des mécanismes marchands traditionnels. L’impact social, quant à lui, dépasse la simple réponse, la seule action. Il intègre l’ensemble des effets – durables, positifs ou négatifs, directs ou indirects – qu’un projet ou une activité génère sur la société, ses bénéficiaires, ses salariés, ses bénévoles ou le territoire tout entier. Cette notion dépasse la simple performance économique et constitue une véritable transformation humaine, sociale et environnementale.
Pourquoi et comment mesurer l’impact social ?
Mesurer l’impact social ne se résume pas à l’élaboration d’un tableau Excel : c’est une vraie posture stratégique. Il s’agit de mieux piloter une organisation, d’orienter plus finement les ressources, d’apporter des preuves tangibles à ses financeurs, à ses partenaires, et aux bénéficiaires eux-mêmes. Et surtout, de rendre visible ce qui échappe souvent aux indicateurs classiques – l’épanouissement, la confiance, le sens retrouvé – autant d’éléments essentiels à la valorisation du travail d’acteurs engagés. Selon les organisations concernées, les objectifs de cette mesure d’impact diffèrent : pour une association de l’économie sociale et solidaire, il s’agit avant tout de démontrer la légitimité de sa mission.
Pour pouvoir mesurer cet impact, il faut avant tout distinguer trois stades complémentaires et différents : la mesure en tant que telle, qui consiste à définir un périmètre, des objectifs et une méthodologie puis à collecter et analyser des données ; l’interprétation, qui porte un jugement sur la pertinence et l’efficacité ; et la certification, qui fait appel à un tiers pour valider la démarche. Ces exercices, loin de s’exclure, s’articulent selon les besoins, les ressources disponibles, et le stade d’évolution de la structure.
Les méthodes mobilisées sont nombreuses : théorie du changement associée à la théorie des parties prenantes et des méthodes quantitatives et qualitatives de collecte de données, analyse coûts-avantages, retour sur investissement social… Certaines approches combinent d’ailleurs des indicateurs quantitatifs et des récits qualitatifs afin de donner corps et sens à la donnée, et, à ce titre, l’exemple de l’entreprise sociale Café Joyeux est particulièrement éclairant. Cette entreprise a pour objectif de donner du travail à des personnes déficientes intellectuelles ou présentant des troubles du spectre autistique.
Café Joyeux a réalisé avec le laboratoire ESSEC E&MISE une mesure de son impact auprès de quatre parties prenantes : ses employés travailleurs handicapés, leurs familles, les managers qui les encadrent au quotidien et enfin les clients des cafés. Ainsi par exemple, 99,1 % des cent dix-huit travailleurs interrogés ont augmenté leurs interactions sociales, 99,1 % ressentent du bien-être au travail ou bien encore 89,8 % déclarent avoir gagné de la confiance en eux. Sur le plan de la monétarisation et de la valorisation financière de ces impacts, ESSEC E&MISE a montré que Café Joyeux, grâce à toutes ses contributions, a créé une valeur sociale de 68,75 M€ pour les salariés, leurs familles et les clients, soit un SROI (retour social sur investissement) calculé de 7,40 €. Cela signifie que pour 1 € dépensé, qui permet à des travailleurs en situation de handicap d’avoir un emploi et de bénéficier de l’accompagnement et de la formation adaptés, la value sociale créée est de 7,40 €.
Indicateurs et nécessité de mesurer notre impact
Il convient de bien distinguer les indicateurs de réalisation et de résultats qui relèvent du rapport d’activité et concernent le court terme, comme le nombre de personnes accompagnées ou insérées professionnellement, et les indicateurs d’impact qui mesurent les changements observés à moyen et long terme grâce à l’action mise en œuvre. Ces derniers doivent refléter la pluralité des impacts : évolution des usages et des comportements, amélioration de la confiance ou de la qualité de vie, accroissement du bien-être physique et/ou moral ou encore renforcement de la cohésion sociale. Ces indicateurs sont d’autant plus faciles à lire et à utiliser qu’ils s’inscrivent dans une logique de cohérence avec les objectifs de développement durable : ils permettent à ce titre de décliner localement des engagements internationaux connus du plus grand nombre.
Néanmoins, faut-il tout mesurer ? Je répondrai clairement et fermement par la négative. Il n’est pas question de viser une mesure exhaustive et encore moins parfaite, mais de structurer une démarche de compréhension et de pilotage continu. Trop souvent, des exercices trop lourds s’épuisent dans la collecte de données et finissent par dévier l’attention de la mission première. Une démarche de mesure d’impact n’est pas une fin en soi mais est au service du projet. Elle doit répondre au triple principe de fiabilité, d’opérationnalité et de proportionnalité. C’est pourquoi nous rappelons souvent que toute démarche de mesure d’impact doit commencer par quatre questions essentielles : pourquoi mesure-t-on ? À qui s’adresse-t-on ? Que veut-on évaluer ? Et enfin, comment et avec quelles ressources ? Ces axes de réflexion nourrissent la cohérence entre les objectifs visés, la méthode choisie et les moyens mobilisés. Ils permettent également d’éviter l’écueil de la mesure discursive qui transforme l’évaluation en exercice de communication sans réel enjeu stratégique.
Mesurer l’impact social est un acte profondément politique (au sens noble du terme), stratégique et humain. Les structures de l’ESS, d’abord, sont soumises à cette exigence de montrer qu’elles répondent mieux que d’autres aux enjeux contemporains, qu’elles transforment les vies et les parcours, qu’elles construisent un avenir commun, et ce, d’autant plus dans cette période de remise en question croissante et tragique de ces modèles. Les financeurs, eux, découvrent que la performance sociale se mesure autant que la performance financière, même s’il reste un long chemin à parcourir pour déconstruire la doxa selon laquelle il faudrait choisir entre impact et rendement. Enfin, les décideurs publics s’appuient sur ces données pour arbitrer au mieux leur action au service de l’intérêt général.