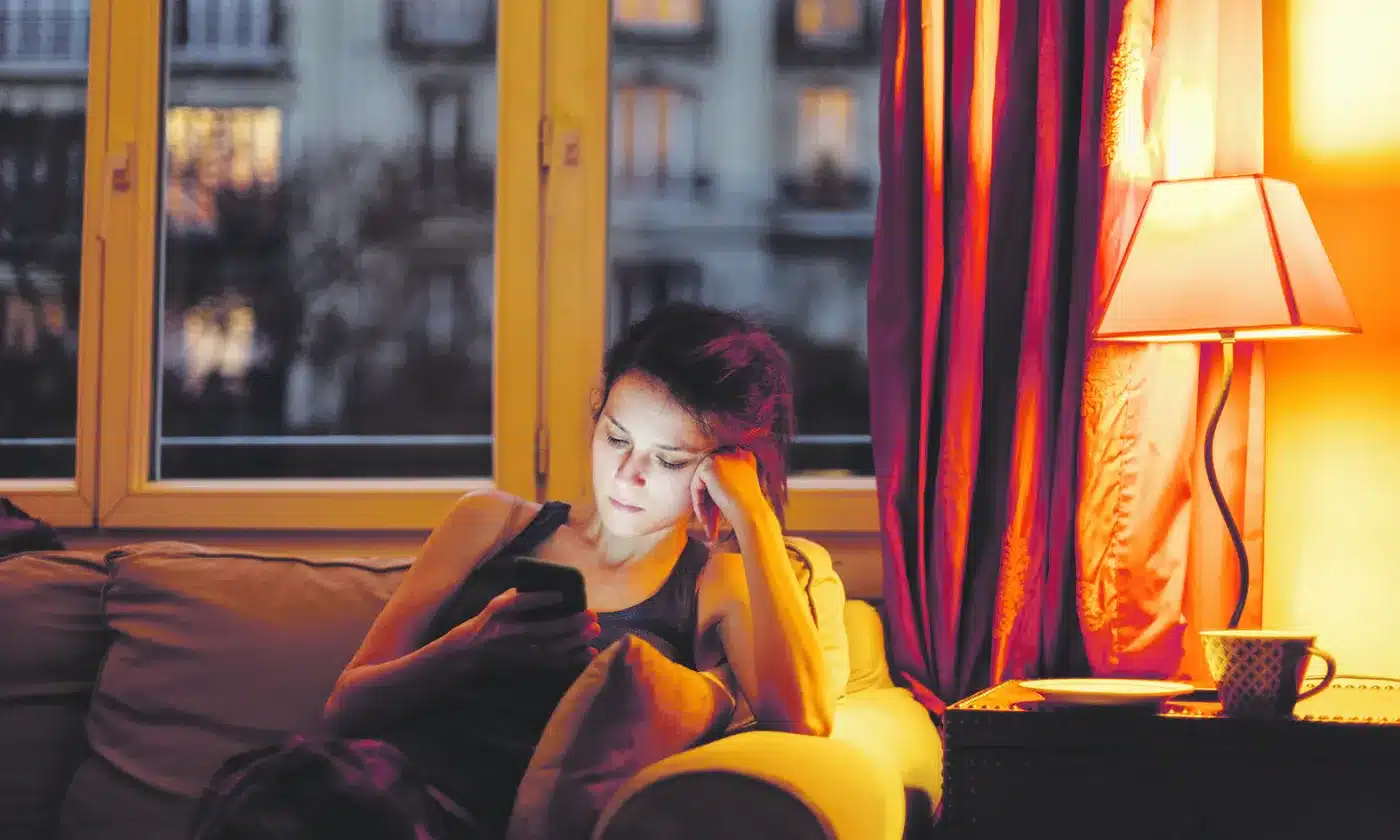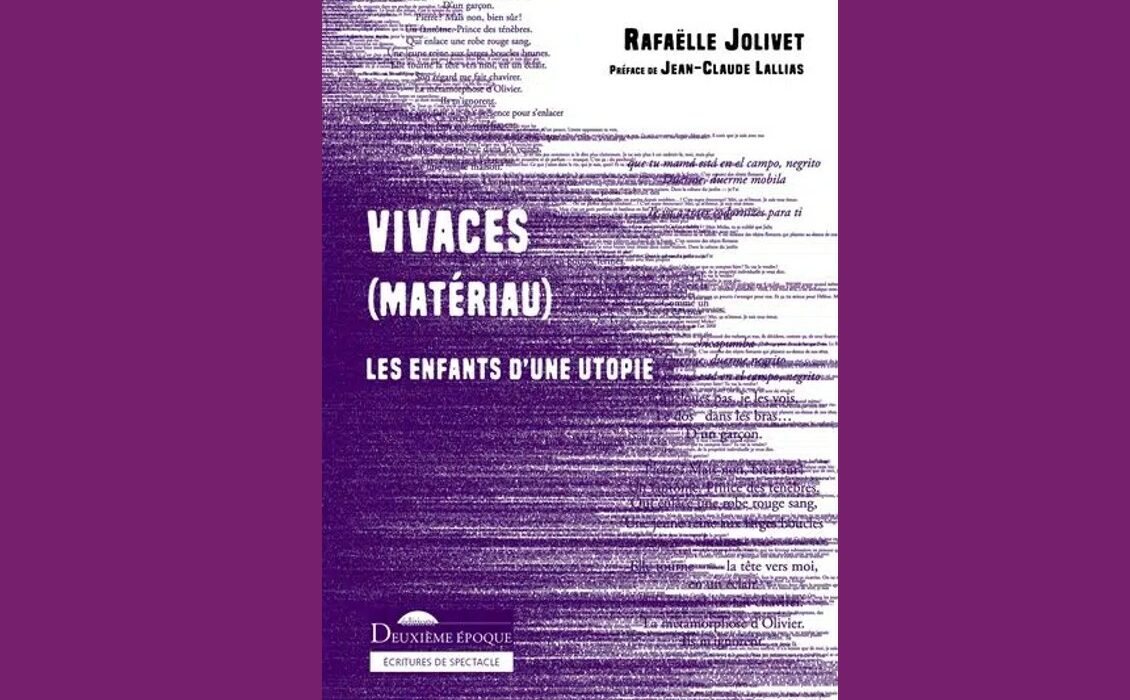«Avant, on avait plus de soucis l’hiver, avec les avalanches. Maintenant, les avalanches, c’est de la rigolade», plaisante Marc Maret. Cet alpagiste, ancien guide de montagne et chef de sécurité piste et sauvetage, a aussi fondé une entreprise de gestion des dangers naturels, remise à son fils au moment de prendre sa retraite, il y a dix ans.
Il ne plaisante qu’à moitié: l’été dernier, des coulées de lave torrentielle ont défiguré la vallée. Sur la route de Mauvoisin, coupée durant deux mois, le bouleversement est spectaculaire. Des dizaines de pelleteuses s’activent sur un sol de caillasses noires, qui semblent avoir tout englouti sur leur passage.
Par miracle, le glissement de terrain a épargné les bâtiments de la ferme de Jean-Louis Bruchez, mais pas ses pâturages. «J’ai perdu 17’000 m2 de terrain», explique cet agriculteur de montagne qui a accumulé les tuiles liées aux intempéries violentes de l’été: ponts d’accès à ses alpages arrachés par les crues, ferme inaccessible – il a fallu transporter les machines par hélicoptère… Et lorsqu’il a voulu partir souffler quelques jours, à Saas-Fee, il s’est retrouvé bloqué là-bas aussi.
Le lien au terrain
Vivre avec des catastrophes potentielles et s’y adapter fait partie de l’ADN des habitants du Valais. Mais ces vingt dernières années, les effets du changement climatique ont rendu ce risque très tangible. Et depuis une décennie, ses effets «ont augmenté en flèche»: précipitations éclair et intenses, sécheresses, températures «jamais vues» à ces altitudes… L’été 2024, avec ses éboulements, a «clairement marqué une intensification» des phénomènes extrêmes, pour Marc Maret. Alors, comment envisager le futur? Partir n’est pas une option pour ces figures de la vallée. Au contraire, plus que jamais, leur connaissance millimétrée du terrain et leur lien avec cette nature hostile se révèlent précieux.
Marc Maret fait partie d’un réseau de guides-observateurs des dangers naturels du Valais romand. Il surveille les moindres failles, indique aux chercheurs où poser des balises GPS pour les «monitorer». «C’est tellement vaste et aléatoire, on ne peut pas tout contrôler. Je dis toujours aux gens de nous signaler le moindre […]