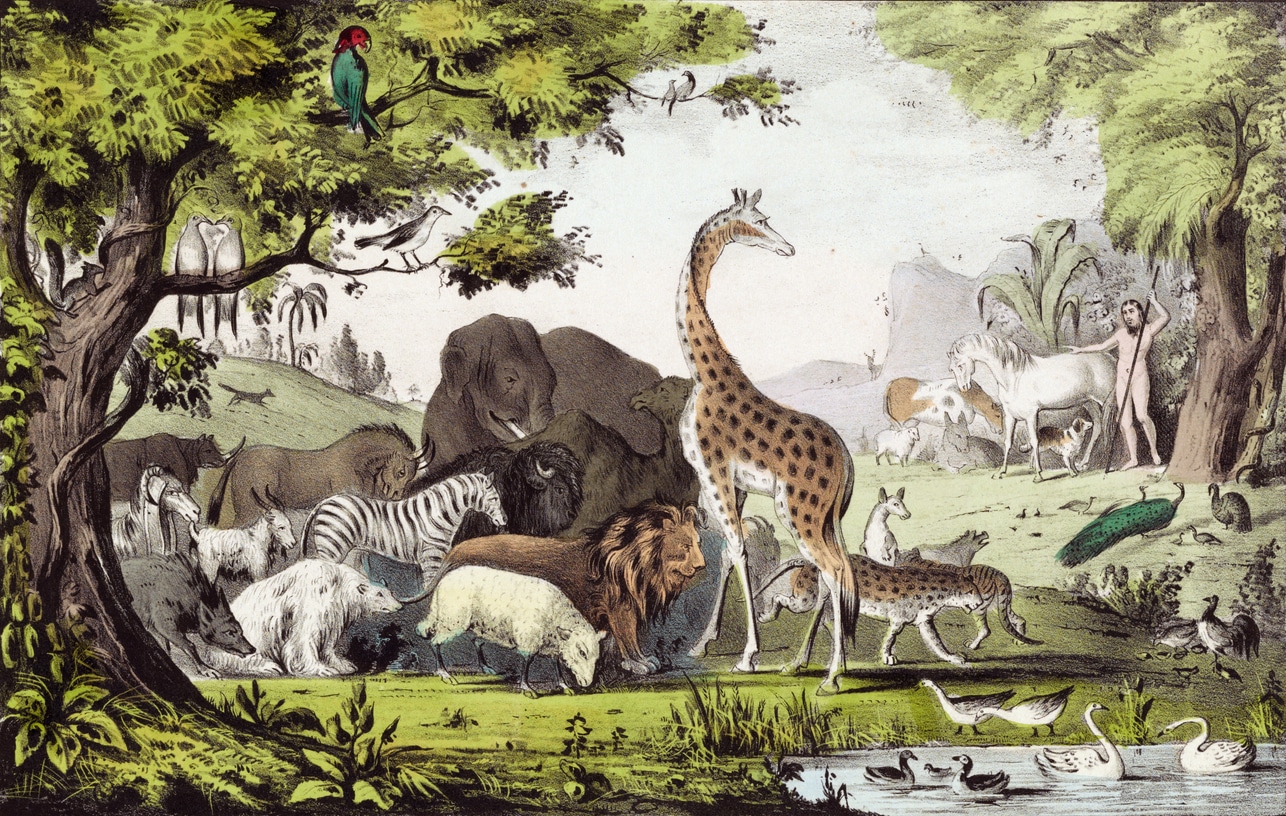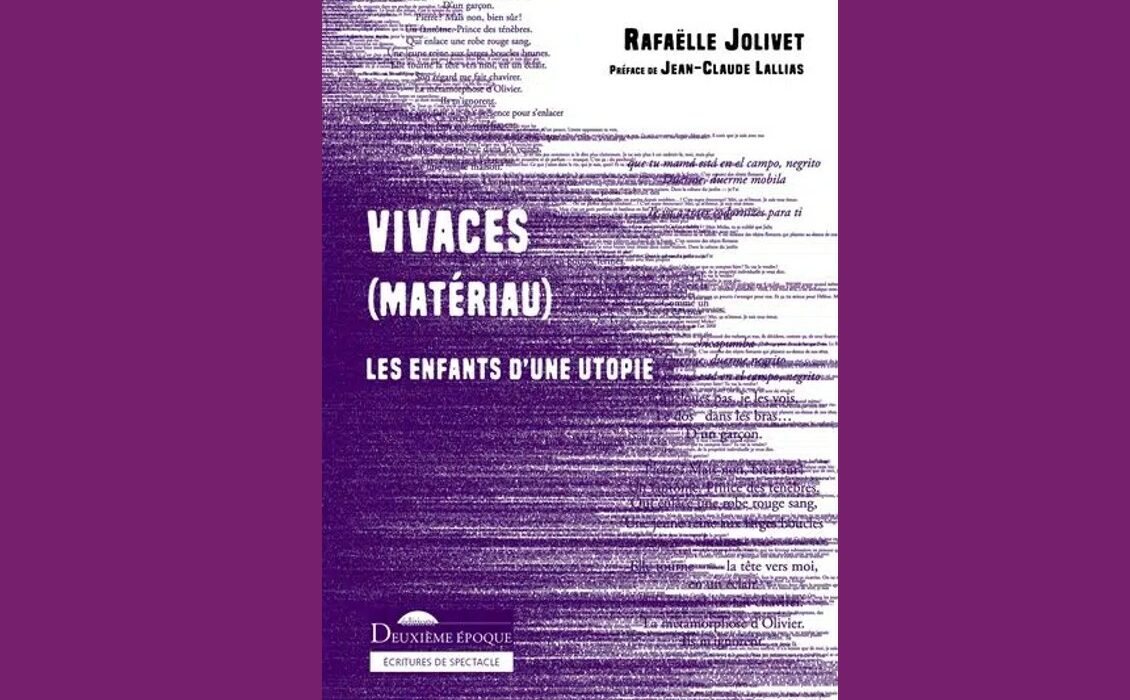Développement durable
Conception du développement de la fin du XXe siècle faisant valoir l’interdépendance des facteurs sociaux, environnementaux et économiques. On souligne aujourd’hui qu’un développement infini est impossible dans un monde fini, mais le concept a eu le mérite de sortir de la pensée du « tout-économique ».
Écologie
Mot basé sur le grec oikos (maison). L’écologie scientifique désigne la science des écosystèmes qui étudie les relations (coopération, compétition, prédation, co-évolution…) des organismes vivants, entre eux et avec leur milieu naturel. L’écologie politique est un mouvement remettant en cause le modèle économique et social et appelant à une refondation des relations entre l’humain et la nature.
Agroécologie
Approche sur mesure de la production agricole, considérant l’exploitation dans son territoire de manière globale et prenant appui sur les fonctionnements naturels des écosystèmes. Elle permet une production plus respectueuse de l’environnement. La permaculture, qui optimise les ressources (espace, énergie, sol, eau…) par différentes stratégies, en est un exemple.
Biodiversité
Ensemble des formes de vie (plantes, animaux, champignons, bactéries…) et de leurs relations, entre elles et avec leur milieu naturel. On parle de biodiversité pour la diversité des milieux de vie, des espèces, mais aussi des individus à l’intérieur d’une espèce. La biodiversité est indispensable à la survie de l’être humain.
Climat – gaz à effet de serre
Les scientifiques reconnaissent unanimement l’effet de l’action de l’homme (anthropique) sur le climat par le biais d’émissions de gaz à effet de serre produits depuis l’ère industrielle (1875). Ces gaz conduisent à l’échauffement de l’atmosphère et provoquent des événements de plus en plus extrêmes : ouragans, canicules, augmentation du niveau des mers, etc.
Empreinte carbone
Les hommes ont émis environ 2 500 milliards de tonnes d’équivalent CO2 de gaz à effet de serre depuis le début de l’ère industrielle. C’est notre empreinte carbone. Pour rester en deçà des deux degrés d’augmentation de la température moyenne de la planète par rapport à l’ère pré-industrielle (1850), seuil au-delà duquel typhons, sécheresses, chute de la production agricole sont prévisibles, notre empreinte carbone ne doit pas dépasser 3 000 milliards de tonnes d’équivalent CO2, seuil que nous atteindrons dans vingt ans, au rythme actuel des émissions…
Éco-anxiété
Dérivé de l’anglais ecoanxiety, ce mot désigne l’ensemble des émotions négatives ou positives (l’éco-anxiété peut motiver des réactions positives), liées à la situation écologique et climatique. Ce concept est complété par la notion un peu différente de solastalgie, douleur morale causée par la perte avérée et irrémédiable d’écosystèmes, de paysages ou d’éléments de la biodiversité, en lien avec cette situation.
Faire sa part
Expression résumant l’idée que, même si la crise écologique et climatique dépend de nombreux facteurs que nous ne maîtrisons pas individuellement, nous sommes appelés chacun et chacune à apporter notre contribution à l’énorme et urgent chantier de réduction de l’impact écologique de l’humanité, car chaque effort compte : c’est « l’effet colibri ».
Énergie
Les énergies fossiles, du fait de leurs formidables capacités à décupler nos forces physiques, ont permis le développement et le confort que l’on connaît ; mais nous en sommes très dépendants. Lutter contre le changement climatique nous oblige à nous passer de ces énergies fossiles, à développer massivement les énergies renouvelables, mais surtout à apprendre à réduire notre consommation d’énergie.
Décroissance-sobriété
Un autre levier de décarbonation de la société est la sobriété. Souvent associée à la notion de décroissance, la sobriété conduit à réduire la consommation, à favoriser l’économie circulaire (réutilisation, réemploi, réparation, reconditionnement, recyclage, etc.) et à interroger notre modèle de développement : on parle plutôt aujourd’hui d’« avenir désirable » ou de « sobriété heureuse » que de décroissance…
Ressources fossiles
Le développement moderne s’est appuyé depuis cent cinquante ans sur les énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz), très efficaces pour se chauffer et faire tourner des moteurs. L’exploitation de ces ressources émet des gaz à effet de serre et provoque pollution, destruction d’écosystèmes fragiles et effondrement de la biodiversité.
Justice sociale et climatique
Le changement climatique concerne toute l’humanité. Non seulement tout le monde sera touché, mais les plus fragiles en subiront davantage les conséquences (habitats invivables, faim et stress hydrique, maladies, etc.). Il y a donc une notion essentielle de répartition juste des efforts pour lutter contre ces effets, comme de responsabilité historique des grands pays riches.