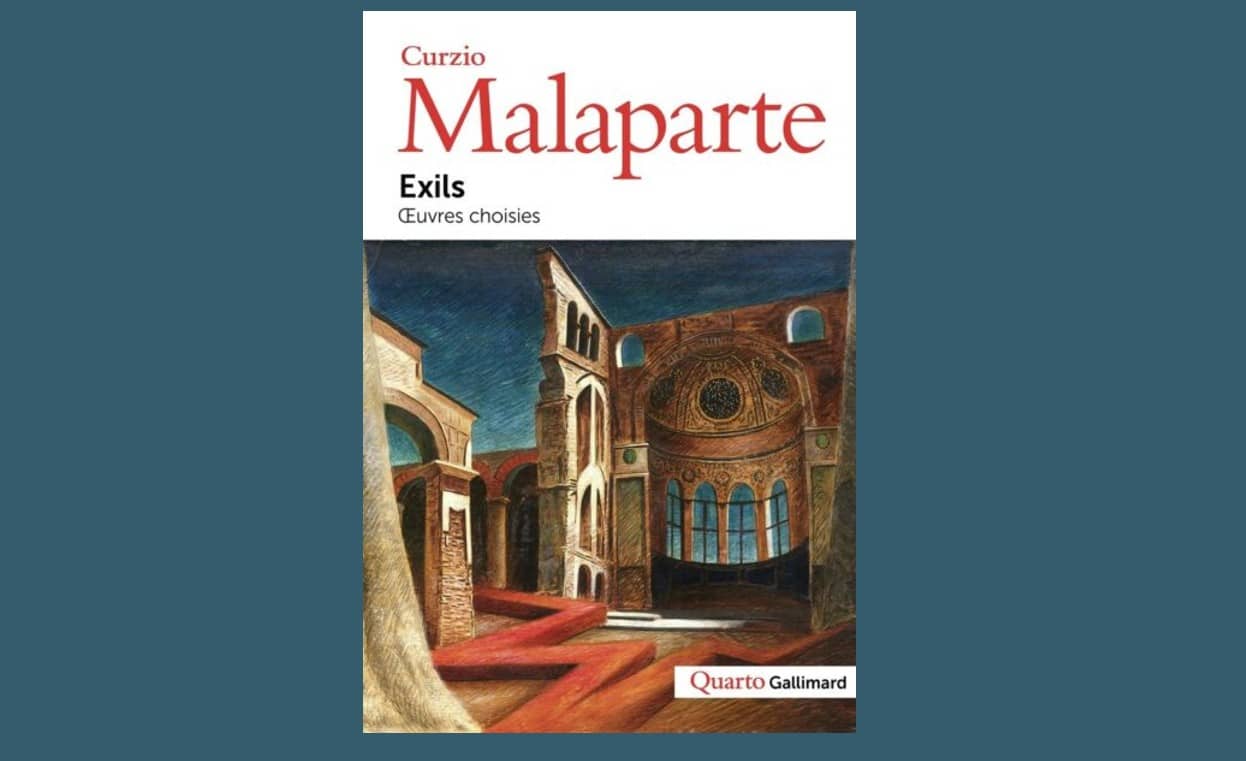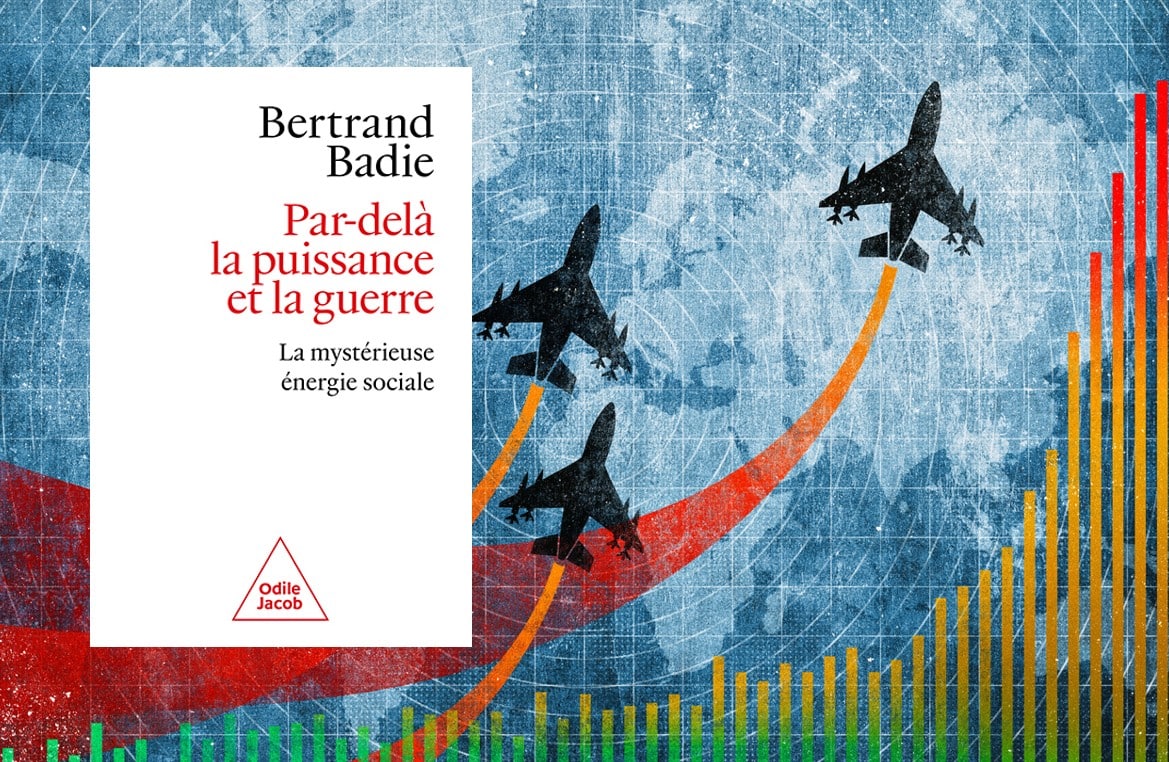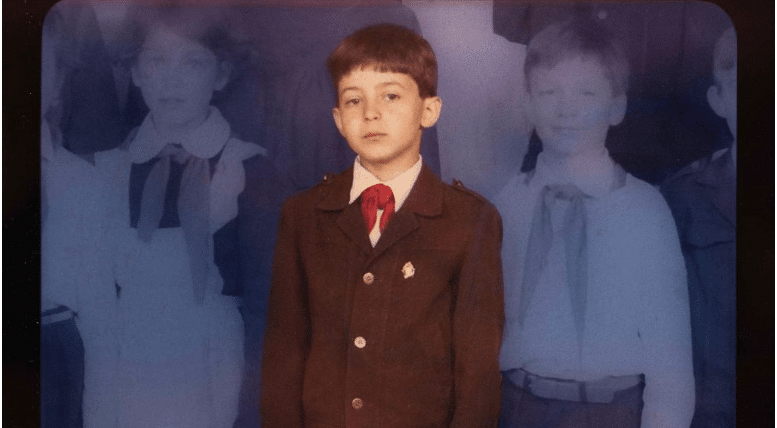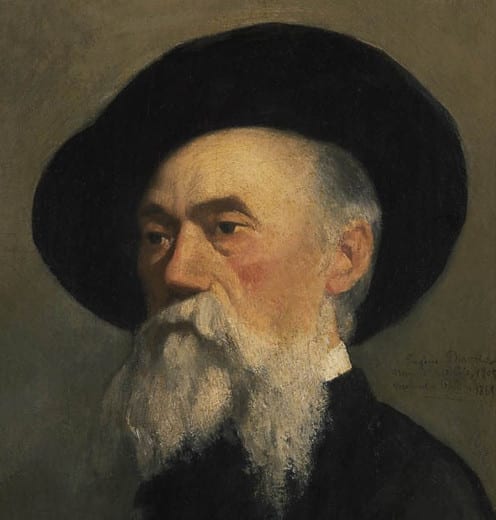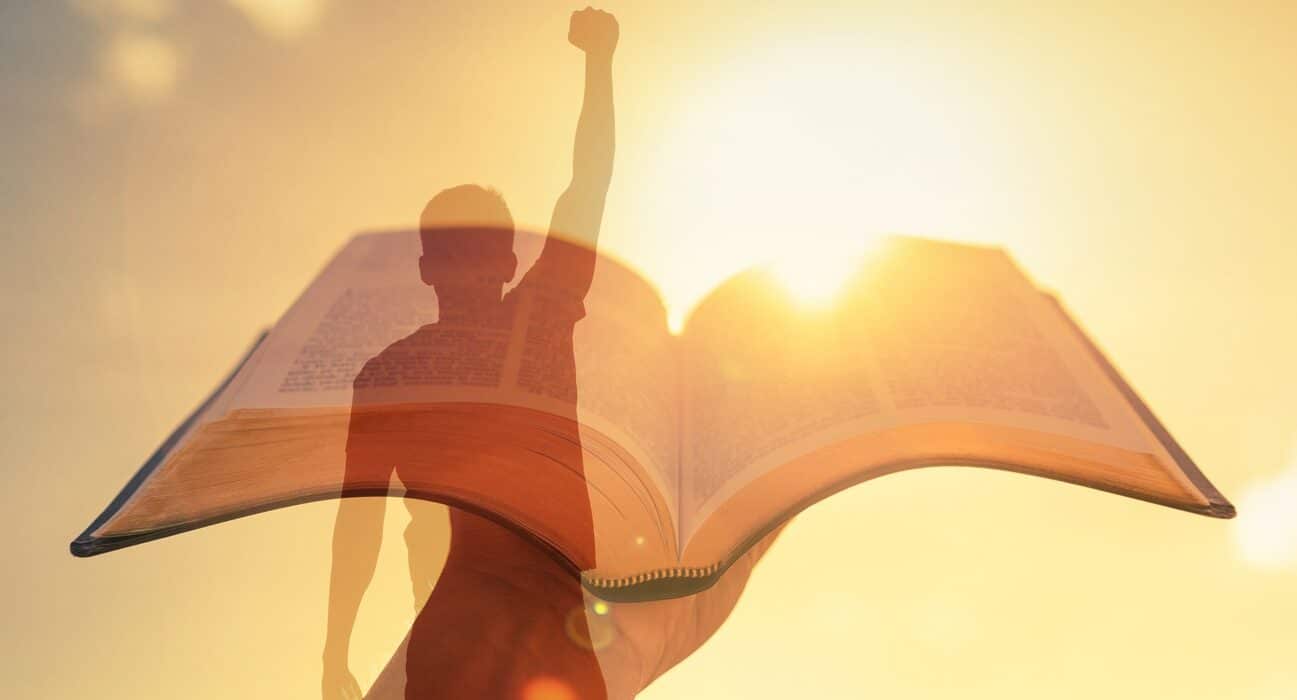La France et l’Allemagne sont les deux pays de l’Union européenne où les citoyens épargnent le plus : à fin juin 2025, leur taux d’épargne représente respectivement 18,9% et 19,4% de leur revenu disponible. Hormis la période de Covid, c’est le taux le plus élevé enregistré dans notre histoire contemporaine. Bien sûr, cette moyenne masque des situations très diverses, avec des ménages qui n’épargnent pas du tout car ils ne parviennent à boucler leur fin de mois. Néanmoins, elle traduit une tendance d’ensemble des mouvements à l’œuvre dans notre société.
L’épargne se définissant comme la part du revenu qui n’est pas consacrée à la consommation, on pourrait imaginer que son augmentation conduise à un surcroît d’investissement. Il n’en est rien : les ménages français et allemands affichent un investissement de près de 10% inférieur à celui de 2019.
L’argent épargné est « placé à la banque ». Dans la parabole des talents, le serviteur qui n’a pas fait travailler l’argent confié par son maître reconnaît « avoir eu peur » et « être allé cacher le talent dans la terre ». Faut-il alors déceler l’œuvre de la peur dans la hausse récente de l’épargne en France et en Allemagne ?
Si tel est le cas, cette situation est d’autant plus dommageable que la France et l’Allemagne représentent à elles seules 40% de la valeur ajoutée créée chaque année par l’Union européenne (mesurée en PIB). Leurs choix ont inévitablement des conséquences pour tout le continent européen. Sortir de la peur pour qu’elle ne domine plus la prise de décision devient donc une urgence pour les deux plus grandes économies européennes. Or la seule manière de la dompter est de tracer une voie d’avenir, crédible, réaliste et constante, sans doute à l’opposé de l’embourbement politique que connaît notre pays aujourd’hui.
Valérie Rabault, conseillère départementale de Tarn-et-Garonne, ancienne première vice-présidente de l’Assemblée nationale, pour « L’œil de Réforme »