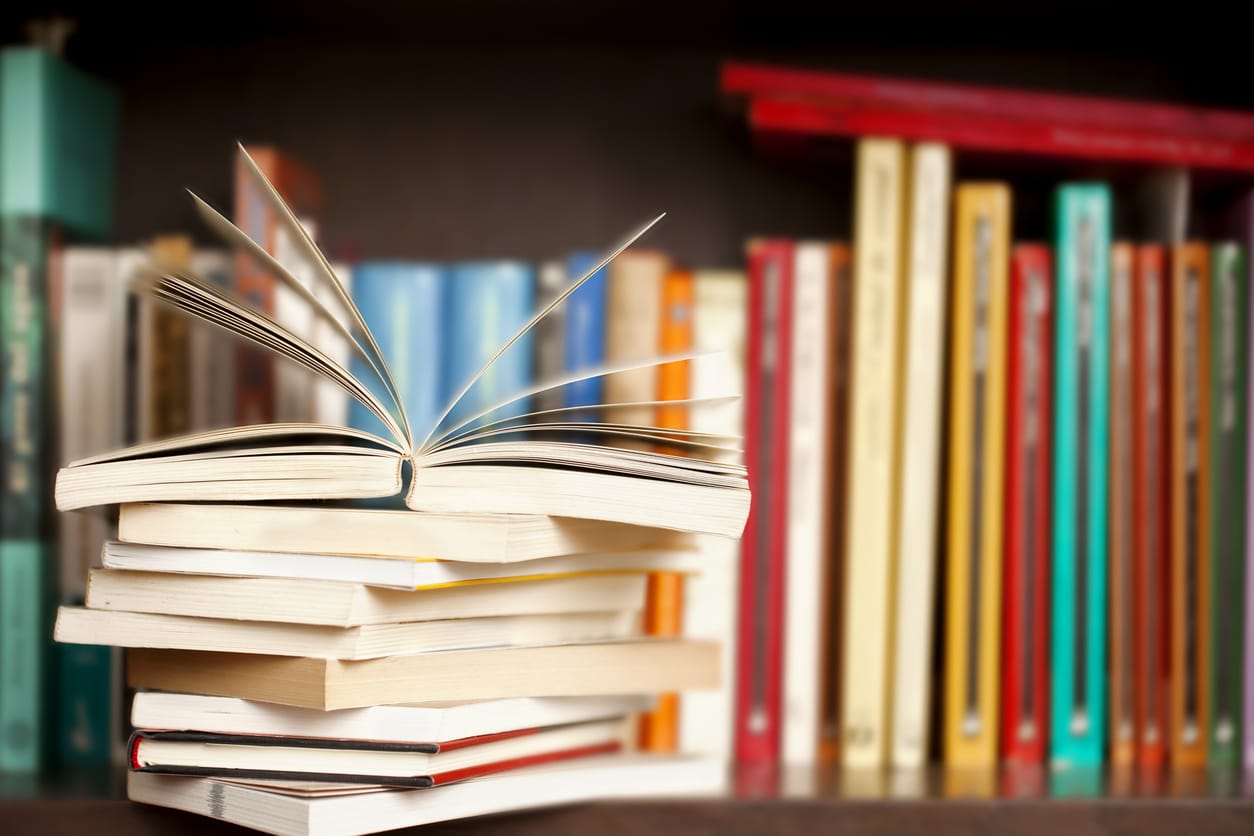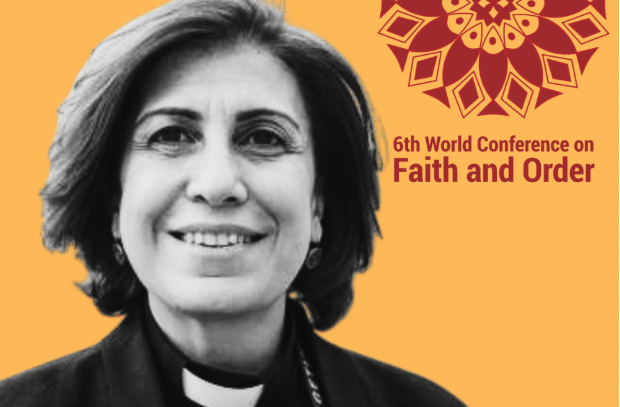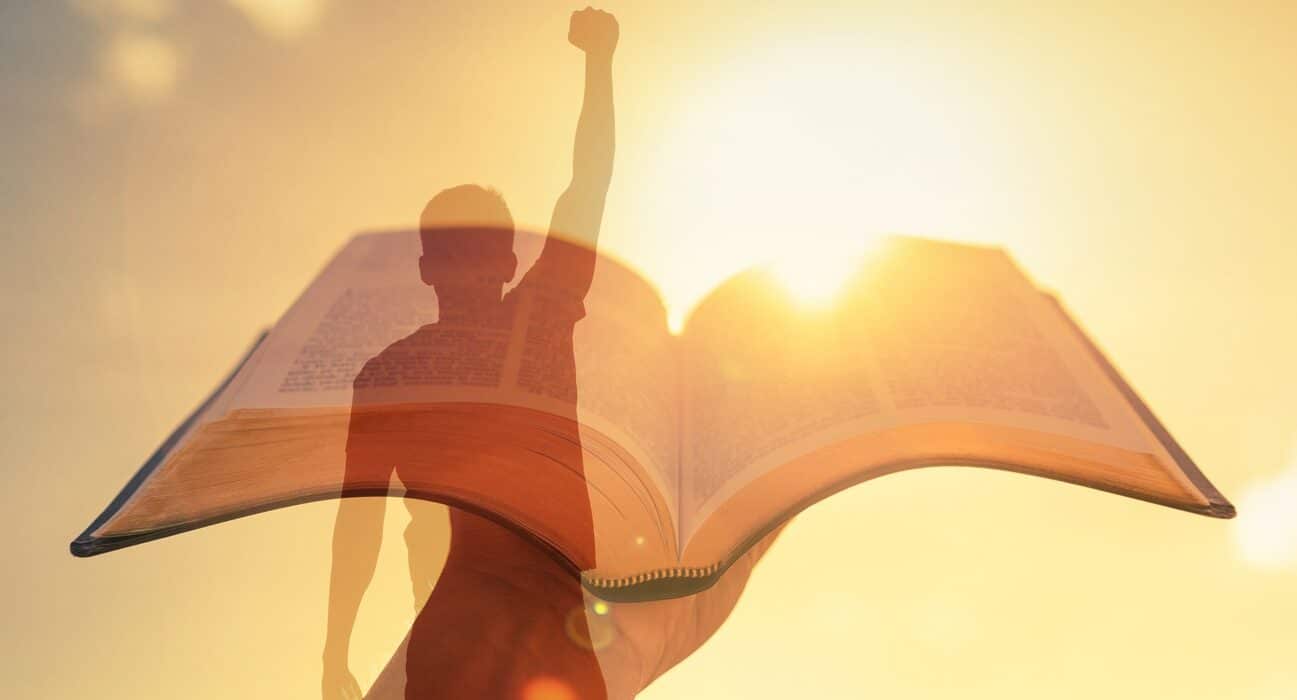Par Corinne Bitaud, chargée de mission écologie et justice climatique pour l’Église protestante unie de France (EPUdF).
L’éco-anxiété est définie par la psychologue Susan Clayton comme « une anxiété associée aux conséquences actuelles et à venir du changement climatique, du manque d’action à son égard et à l’incertitude quant aux conséquences anticipées ». Elle recouvre un ensemble d’émotions parfois contrastées : inquiétude, peur, colère, culpabilité… Mais aussi espoir, altruisme… Elle n’est pas considérée comme une pathologie mentale, mais comme une réaction normale face aux réalités. Toutefois, elle peut générer des angoisses pathologiques lorsqu’elle devient intense, voire exacerber des problèmes de santé mentale pré-existants.
Prendre soin de ses membres
En France, environ 80% des personnes, jeunes ou adultes, se déclarent inquiètes face aux changements climatiques. Une étude a révélé que 37% des 16-25 ans hésitent pour cette raison à avoir des enfants. Des psychiatres soulignent que ces émotions traduisent des questions existentielles : mort, responsabilité, isolement, sens de la vie. Elles appellent donc dans la plupart des cas non pas une approche thérapeutique mais une approche spirituelle. Et puisqu’on ne peut pas « guérir » de l’éco-anxiété, il faut apprendre à vivre avec elle.
L’Église est concernée dans son souci pastoral de prendre soin de ses membres, mais aussi dans sa théologie (de la création, de la justice), et jusqu’au cœur de son message (annonce du salut, rappel de la loi, proclamation de l’espérance). L’Église est également un lieu où un engagement collectif et de nouvelles solidarités sont possibles, par exemple au travers du programme Église verte et des […]