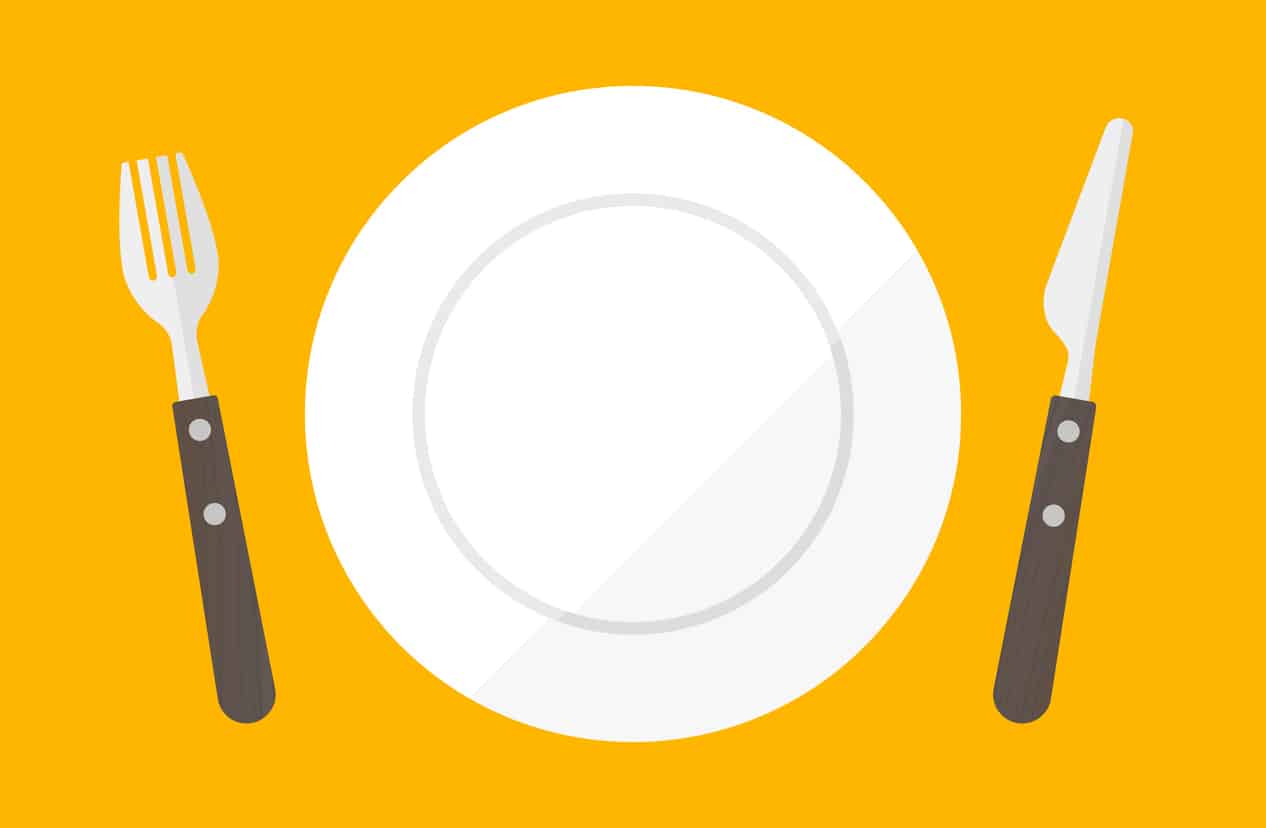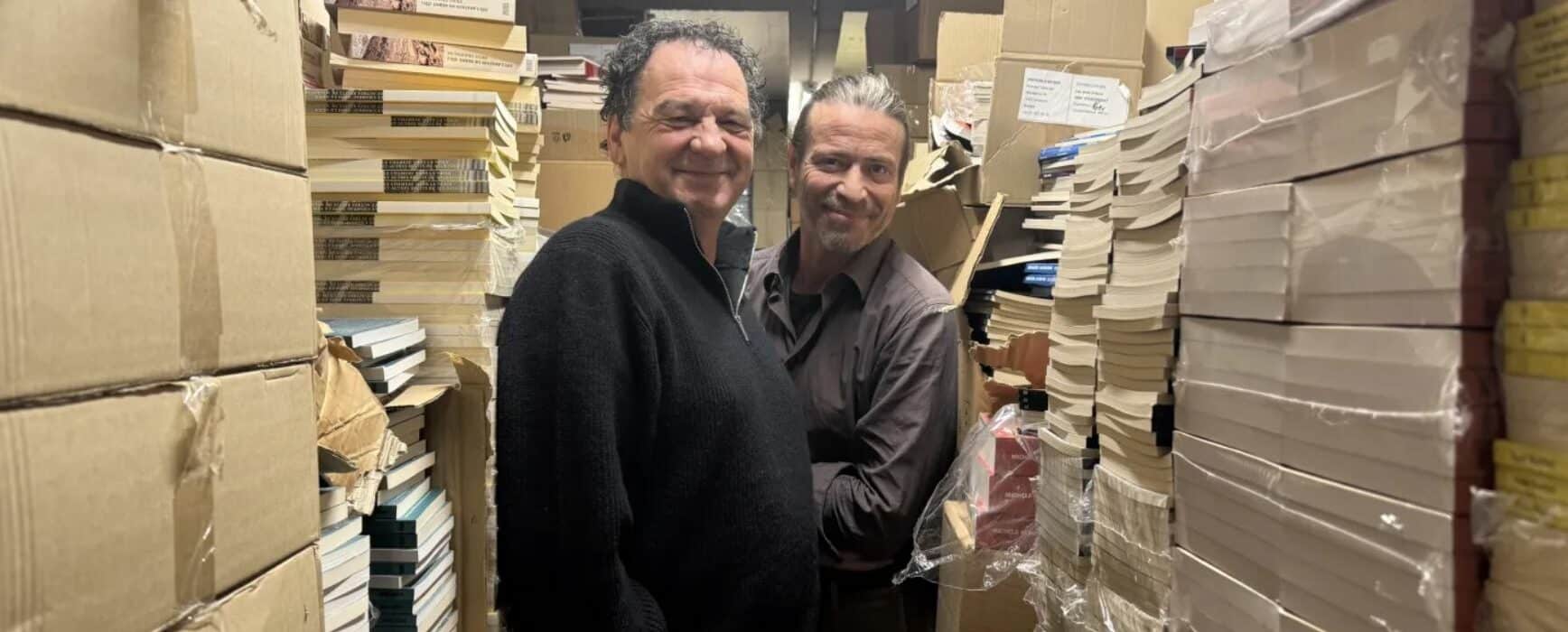Vingt ans après la loi de 2005, quel regard portez-vous sur l’action publique ?
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap portait déjà tout en elle. Quand j’ai rejoint le gouvernement, j’ai demandé à être rattachée au Premier ministre afin de travailler à sa mise en application en impliquant chaque ministère dans son domaine de compétences. Engager des actions plutôt que créer des lois.
L’approche interministérielle a opéré un changement radical. Elle a responsabilisé pleinement les acteurs politiques et instauré un réseau de hauts fonctionnaires dédiés à cette question. Plusieurs avancées majeures ont suivi. Ainsi, l’ouverture de droits à vie a permis à de nombreuses personnes de ne plus avoir à prouver leur handicap, parfois chaque année, et d’alléger les démarches administratives. Elle a envoyé un signal de confiance. Le droit de vote des personnes majeures sous tutelle renforce l’accès à la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Des mesures en faveur de l’apprentissage ont facilité la formation et l’emploi : le taux de chômage des personnes handicapées est passé de 19 % à 12 % entre 2017 et 2022.
Quels freins persistent aujourd’hui dans l’inclusion ?
Des progrès ont été réalisés, mais de nombreux défis demeurent. Prenons l’exemple de l’éducation : en comparaison d’autres pays européens, l’école française n’a pas encore pleinement opéré sa mue. Dès la fin des années soixante-dix, certains de nos voisins ont largement développé l’accueil en milieu ordinaire des enfants en situation de handicap, avec des équipements adaptés comme des salles de rééducation intégrées aux écoles. En rendant le handicap visible dès le plus jeune âge, on change en profondeur le regard de la société.
En France, l’inclusion scolaire a progressé avec le développement des AESH notamment, mais notre vision demeure compartimentée. Si l’on favorise une unité de lieu, les parcours doivent être adaptés aux différents types de handicap. Cette transformation exige une ingénierie parfois complexe, une forte coopération entre les acteurs et un accompagnement au changement pour dépasser le cloisonnement qui peut subsister entre les professionnels du handicap et les enseignants. Heureusement, des initiatives de collaboration existent déjà et ouvrent la voie à des évolutions positives. Mais il reste du chemin à parcourir.
La perception du handicap évolue-t-elle ?
Les Jeux paralympiques ont eu un impact considérable sur l’opinion publique. Ils ont mis en lumière les talents et la détermination des athlètes. Les médias jouent un rôle clé dans cette visibilité. Le cinéma contribue également à faire bouger les lignes : le succès du film Un p’tit truc en plus en est un bel exemple.
Dans le monde du travail, des initiatives comme le DuoDay affichent aussi des résultats concrets. En 2024, 30 000 duos ont été formés entre une personne en situation de handicap et un professionnel. Mieux encore, 25 % des participants ont décroché un emploi à la suite de cette expérience. D’autres initiatives, nombreuses, participent à cette évolution. Mais pour que ce changement s’ancre durablement, il faut une volonté politique forte et constante afin de continuer à les encourager et les soutenir.