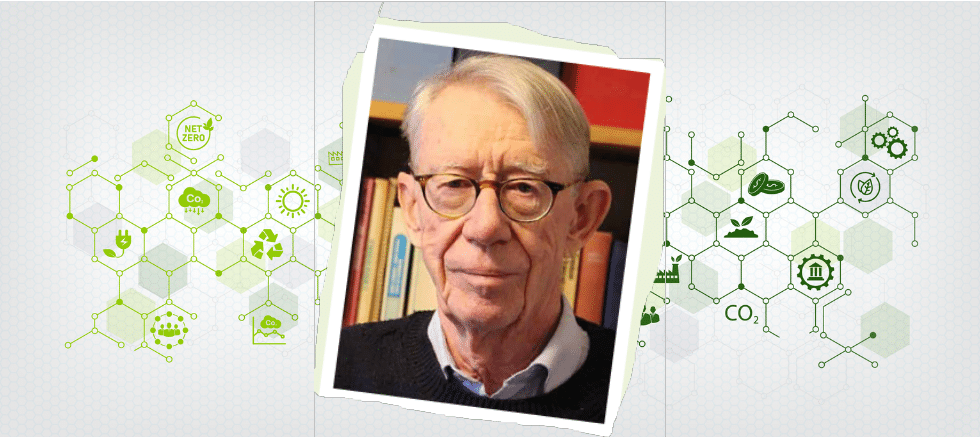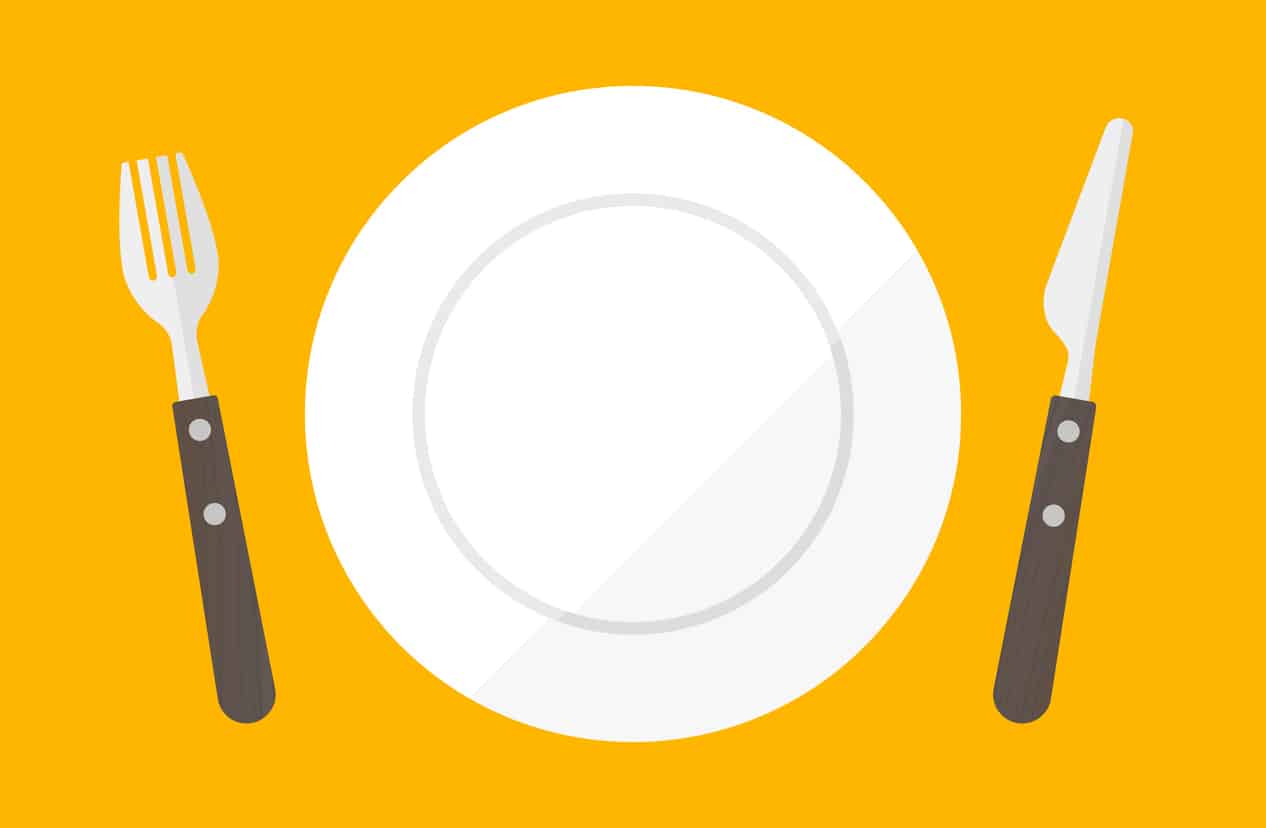1) Le changement climatique est-il désormais une question cruciale?
Dans la problématique écologique globale, c’est assez récemment que la question du climat est devenue centrale. C’est pourtant dès les années soixante-dix que j’avais rencontré des scientifiques qui travaillaient sur cette question ; la Convention des Nations unies sur les changements climatiques date de 1992 (conférence de Rio). Il aura donc fallu plus de vingt-cinq ans pour que la majorité des États (mais pas tous…) inscrivent véritablement cette question dans leur agenda politique, notamment avec l’accord de Paris de 2015. Mais il faut aussi replacer le changement climatique dans une perspective environnementale plus vaste. La transition écologique touche aussi l’érosion de la biodiversité (elle-même largement liée au changement climatique) et une série de très graves pollutions des eaux, de l’air, des sols, qui affectent notre environnement, notre santé, nos sociétés.
2) Justice climatique et justice sociale sont-elles liées?
Justice climatique et justice sociale sont étroitement liées. D’abord sur le plan international. Globalement, entre 3,3 et 3,6 milliards d’humains vivent dans des contextes hautement vulnérables au changement climatique. D’après les Nations unies, d’ici à 2050, environ un milliard de personnes pourraient vivre dans des zones côtières menacées par la montée des eaux. Les pénuries d’eau vont d’abord affecter les populations les plus vulnérables : huit cents millions à trois milliards de personnes pour une augmentation de la température de 2 degrés, et quatre milliards à + 4 degrés. Citons les pénuries alimentaires, la mortalité causée par les événements climatiques extrêmes, quinze fois supérieure sur les populations vulnérables, etc. Or, un citoyen américain émet huit fois plus de CO2 (13 tonnes) qu’un Indien (1,6 t), trois fois plus qu’un Chinois (4,4 t). L’UE est en position intermédiaire (5,5 t).
À l’intérieur même d’un pays, certaines régions ou catégories sociales sont et seront plus affectées que d’autres ; par exemple, les sécheresses sont inégalement réparties en France. En Europe, les 10 % les plus riches émettent 29,2 tonnes de CO2 par personne et par an, contre 5,1 tonnes pour les 50 % les plus pauvres ; aux États-Unis, 73 tonnes de CO2 par les 10 % les plus riches, contre 9,7 tonnes par an pour les 50 % les plus pauvres. En provoquant ou amplifiant les dommages environnementaux, le changement climatique accroît les inégalités sociales déjà existantes. Il faut aussi penser à l’impact social et à une juste répartition des coûts de la lutte contre le changement climatique. Et n’oublions pas les drames humanitaires et géopolitiques : les exils climatiques et les guerres sont également des catastrophes écologiques.
3) Les chrétiens ont-ils un rôle spécifique à jouer ?
Le rôle des chrétiens peut être important, mais leur discours ne doit pas être moralisateur. Il nous faut penser et agir selon notre espérance chrétienne ; c’est le « croire quand même, espérer quand même », selon la maxime de Wilfred Monod. Les Églises ont mis longtemps à se réveiller, particulièrement en France, malgré l’engagement précoce du Conseil œcuménique des Églises dès 1974. Mais désormais, elles se mobilisent à divers niveaux, notamment avec le label Église verte, ou l’association chrétienne A Rocha. Dans le protestantisme français, citons le réseau EPUdF Espérer pour le vivant, et la commission Écologie et Justice climatique de la FPF. Côté catholique, l’encyclique Laudato Si’ du pape François a un fort impact. D’une façon générale, il existe un réel potentiel d’influence et d’action des Églises chrétiennes. Des changements radicaux doivent s’opérer rapidement dans nos modes de vie. L’homme a la capacité de réagir et de s’adapter, mais le temps presse !