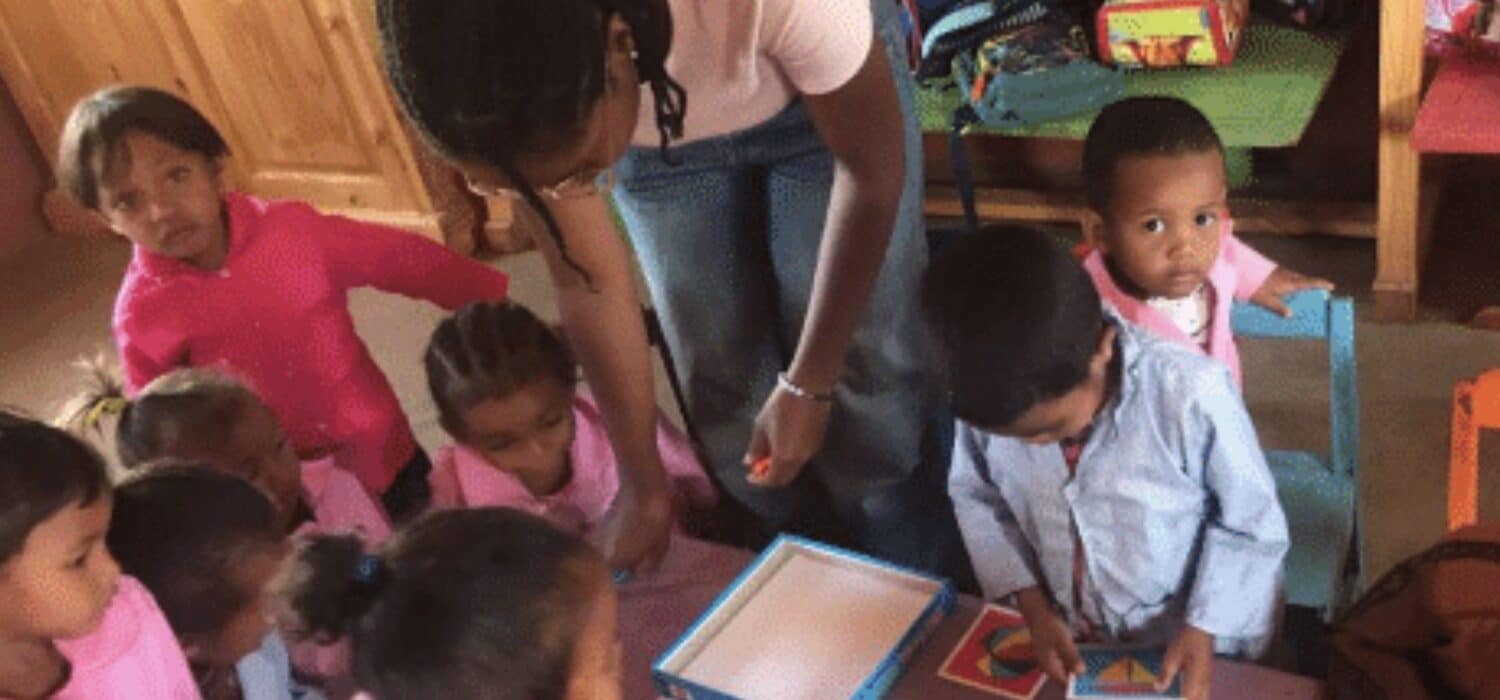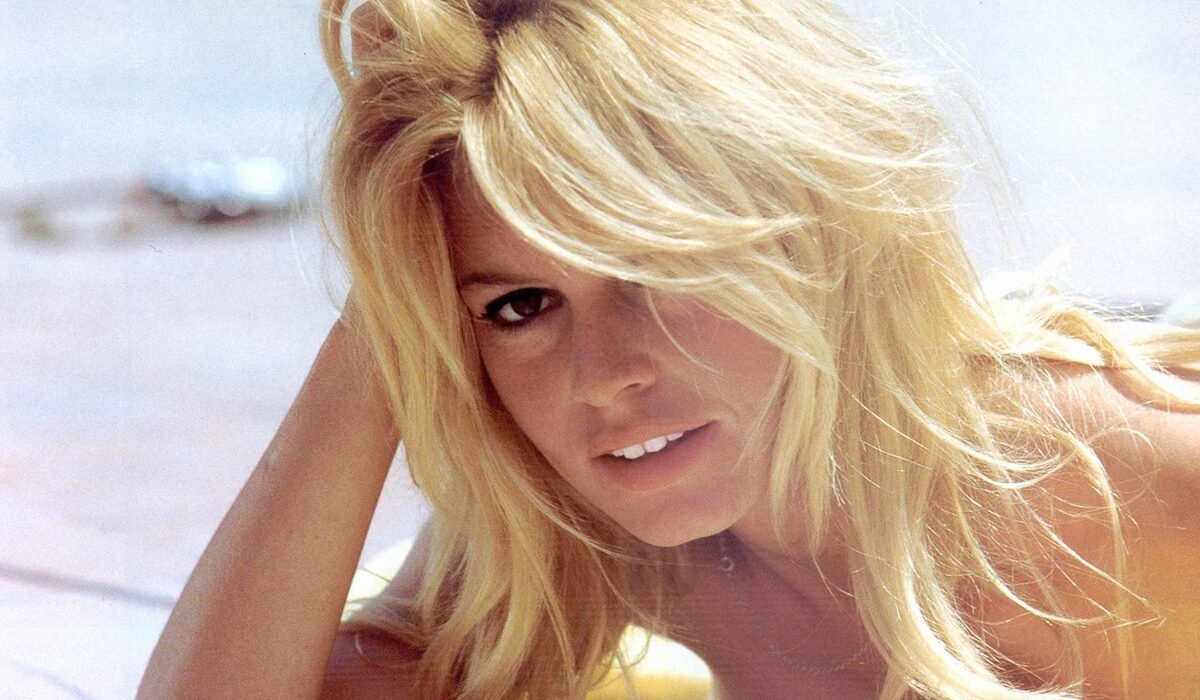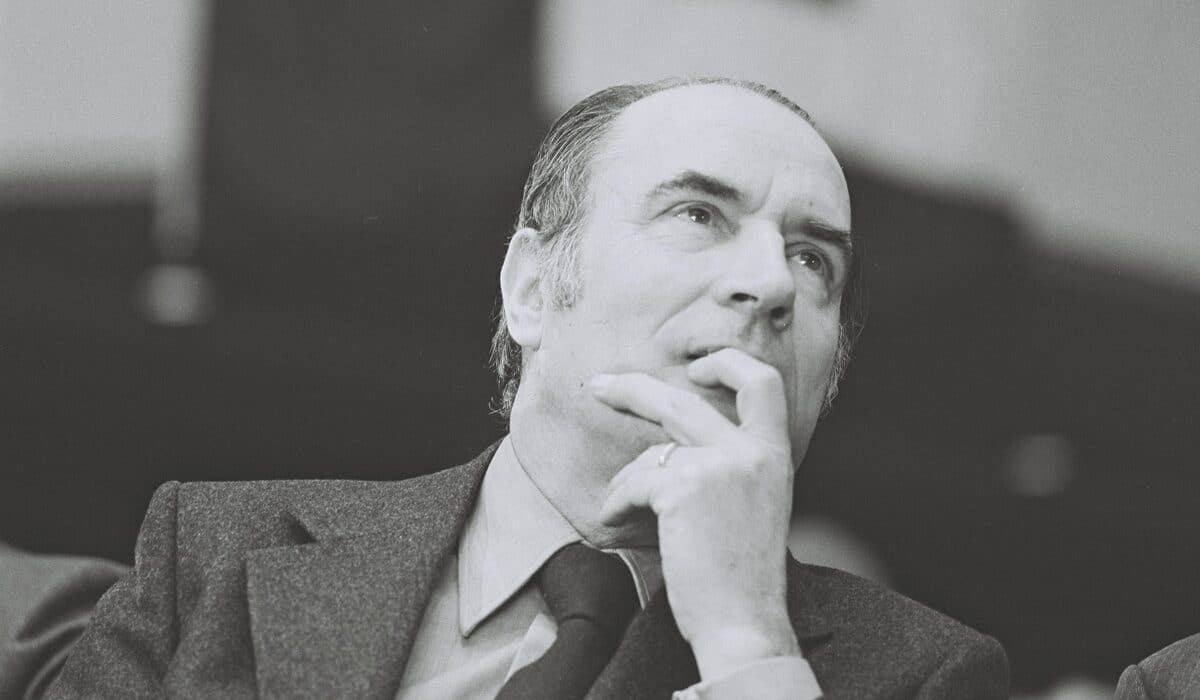Par Antoine Colonna d’Istria, fondateur d’Aginso, agence d’innovation sociale, et ancien membre du bureau de l’association la Fonda, qui oeuvre pour la construction d’une société inclusive et durable.
Évaluer pour mieux décider
L’évaluation est un outil d’aide à la décision. Elle permet de discerner ce qui est bon et ce qui peut être amélioré. Elle apporte de la transparence aux gouvernances et de la redevabilité vis-à-vis des partenaires. Elle peut être motivée par le désir d’être plus efficace, plus pertinent, plus durable, ou plus transformatif. Elle offre aux porteurs de projet la possibilité de s’assurer que leur action répond à un besoin réel (pertinence), produit des résultats concrets (efficacité), dans la durée (soutenabilité). Dans le cas de l’innovation sociale, elle formalise une preuve de concept : démontrer qu’une solution innovante fonctionne et mérite d’être soutenue ou déployée.
Mesurer l’impact, une approche spécifique
La mesure d’impact est une forme particulière d’évaluation. L’impact est en effet l’un des critères possibles pour évaluer un projet. La mesure d’impact se focalise en principe sur les résultats indirects d’un projet, afin de valoriser la différence à long terme et/ou à grande échelle. La mesure d’impact s’inspire de la démarche scientifique : elle implique la formulation d’hypothèses, la construction d’un cadre d’analyse, la définition d’indicateurs, la collecte et l’interprétation de données. Elle repose généralement sur une théorie du changement, distinguant trois niveaux de résultat : les produits, les effets et les impacts.
Prenons l’exemple du mentorat pour les jeunes défavorisés, largement promu depuis 2021 par le plan « 1 jeune, 1 mentor ». Cette politique publique a permis une forte hausse du nombre de mentorés, passés de vingt-cinq mille à cent soixante mille par an en 2023. Les résultats directs du mentorat sont encourageants : les jeunes mentorés et les mentors sont satisfaits de l’expérience, et perçoivent des effets positifs tels qu’une meilleure estime de soi. Le mentorat démontre ainsi une certaine efficacité. Pourtant, la mesure de l’impact réel reste un défi. D’abord, parce qu’elle devrait se fonder sur des groupes témoins pour isoler un effet « net » du mentorat. Ensuite, parce qu’elle devrait s’évaluer à l’aune de l’égalité des chances, qu’on pourrait matérialiser ici par la réduction des inégalités d’accès à l’enseignement supérieur. Or, les écarts d’accès entre classes sociales s’accroissent. Cela nous amène à nous interroger : le mentorat est utile, mais contribue-t-il à transformer une situation structurellement inégalitaire ? La réponse dépend de multiples facteurs – système éducatif, conditions de vie, etc. – qui dépassent le dispositif.
Une approche exigeante et collective pour faire évoluer les organisations
C’est ici que l’évaluation d’impact prend son sens. Elle situe un projet dans son écosystème, éclaire ses interactions avec d’autres politiques ou initiatives, et encourage des coalitions intelligentes entre acteurs poursuivant une même cause. L’impact est collectif : il résulte d’actions coordonnées, et non de solutions isolées.
Une évaluation ou mesure d’impact exigeante est consommatrice de temps, particulièrement lorsqu’on veut estimer un « impact net », mais elle garantit qu’un projet contribue à une transformation durable et équitable de la société. Les organisations doivent répondre au défi de choisir intelligemment leurs pratiques d’évaluation afin de trouver un équilibre entre l’investissement et la valeur créée par l’évaluation : des preuves, mais aussi des enseignements pour leurs stratégies.