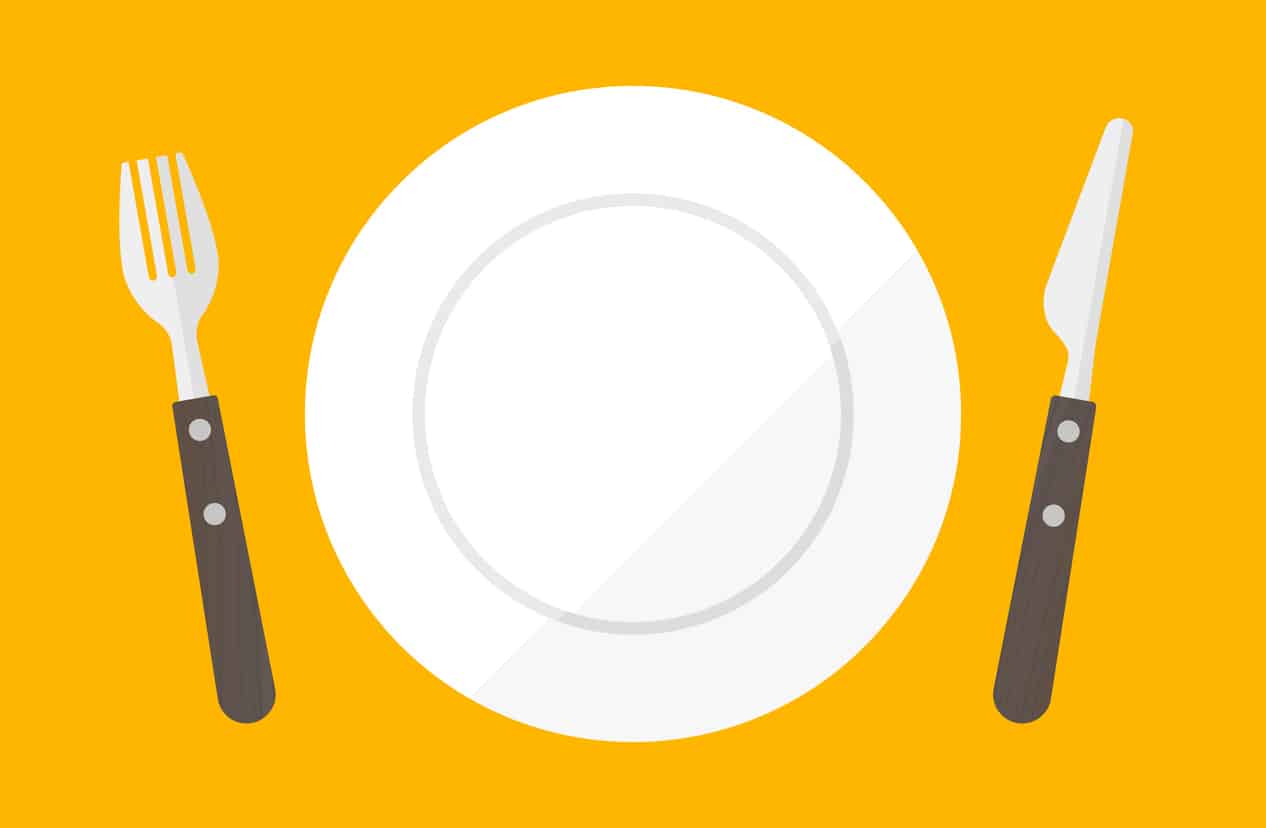Comment définir l’approche systémique ?
Les structures qui travaillent sur des enjeux sociétaux et environnementaux font face à des problèmes très complexes, multifactoriels, transdisciplinaires, qui peuvent être éclairés par de nombreuses approches comme les sciences politiques, la sociologie ou la psychologie.
On attend des associations qu’elles apportent des solutions à court terme, efficaces, mesurables : quand elles sollicitent un mécène, elles ont intérêt à présenter des chiffres qui prouvent que leur solution fonctionne. Mais on est là dans un paradigme solutionniste. Malheureusement, 95 à 98 % des efforts des associations sont dédiés à penser la solution plutôt qu’à comprendre le problème. Celles qui accompagnent les personnes sans abri, par exemple, comprennent bien le besoin social, savent comment entourer, adopter la juste posture, mais ont du mal à cerner les mécanismes qui font que, inlassablement, le sans-abrisme se perpétue.
L’approche systémique propose un regard différent pour mieux comprendre la complexité de la situation et agir de manière plus pertinente, saine, robuste et durable. Elle ne se contente pas de mettre des sparadraps sur les problèmes en sacrifiant le long terme sur l’autel de l’urgence. L’approche systémique n’est pas la panacée mais elle offre des pistes pour sortir de cette fuite en avant solutionniste et repérer tous les impacts de nos actions, positifs et négatifs – car nous faisons aussi des dégâts malgré nous.
Des dégâts que l’on appelle « effets de bord » ?
Oui, ce sont des effets indésirables, imprévus et difficilement attribuables à nos actions. Je peux apporter une solution avec du sens, efficace à court terme, mais qui renforce le problème à long terme ou en crée d’autres. Il suffit souvent de se poser les bonnes questions. On peut notamment se demander si les actions engagées gênent d’autres acteurs ou les incitent à ne pas faire leur travail. Les associations qui pallient les manques de l’Éducation nationale, par exemple, contribuent malheureusement en partie à son désengagement de certains sujets ou à l’hétérogénéité et la fragmentation de l’accompagnement des jeunes. Se poser les bonnes questions offre des pistes d’amélioration à la fois à court terme (les « PPPPP », les plus petits premiers pas possibles) et des perspectives de transformations plus profondes. On regarde moins à travers la lorgnette solutionniste, on se concentre moins sur un objectif à atteindre. On dézoome pour prendre en compte l’ensemble de nos influences et avoir une action globale.
L’évaluation est-elle incontournable ?
Elle est largement généralisée. Si elle est bien faite, elle crée de l’intelligence et permet d’identifier des axes d’amélioration. Mais souvent, elle se fait à la demande des financeurs, ou sert d’outil de marketing pour les convaincre de l’intérêt des actions menées, et elle renforce la vision solutionniste. Les associations veulent prouver qu’elles ont un impact. Mais savoir si ce qu’on fait fonctionne ou pas n’a pas de sens. Réduire la complexité de nos actions à une mesure technique et s’en emparer pour clamer à quel point notre travail est formidable est un principe qui va à l’encontre de l’approche systémique.
La plupart des pratiques d’évaluation vérifient si l’objectif est atteint, sans se demander si cet objectif est bon ni prendre en compte les dégâts collatéraux. On peut se bercer de l’illusion que ce que l’on fait est souhaitable. Le premier enjeu est moins d’essayer de mesurer l’impact – ce serait très prétentieux de notre part – que d’évaluer notre utilité, nos contributions, nos influences. Il faut changer de posture, faire preuve de curiosité, raisonner dans une logique d’apprentissage, remettre en question nos certitudes.
Le deuxième enjeu est de mettre tout en œuvre pour mieux comprendre les problèmes. L’évaluation, mais aussi tout travail d’enquête en partenariat – ou pas – avec le monde de la recherche, peut nous aider à cerner ce qu’il se passe, donc à mieux agir.