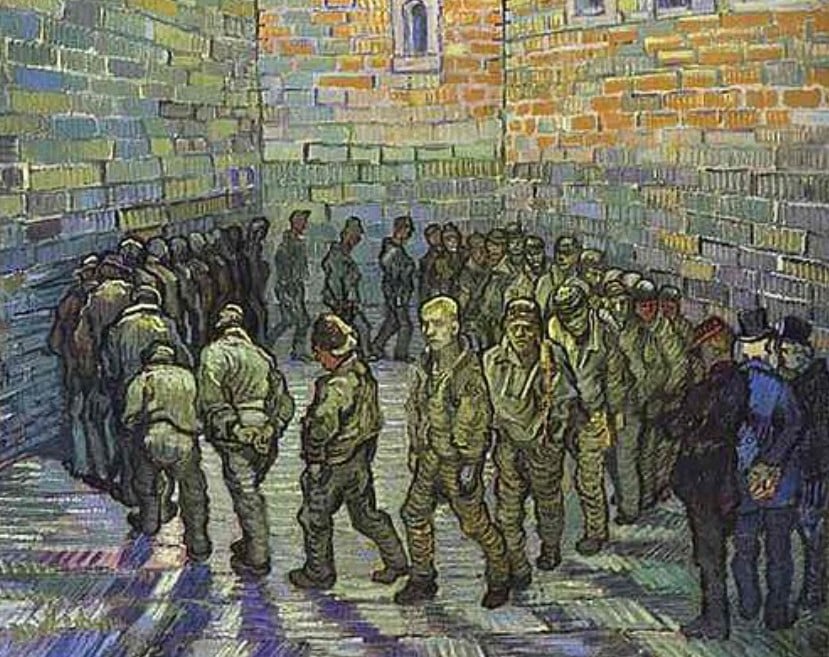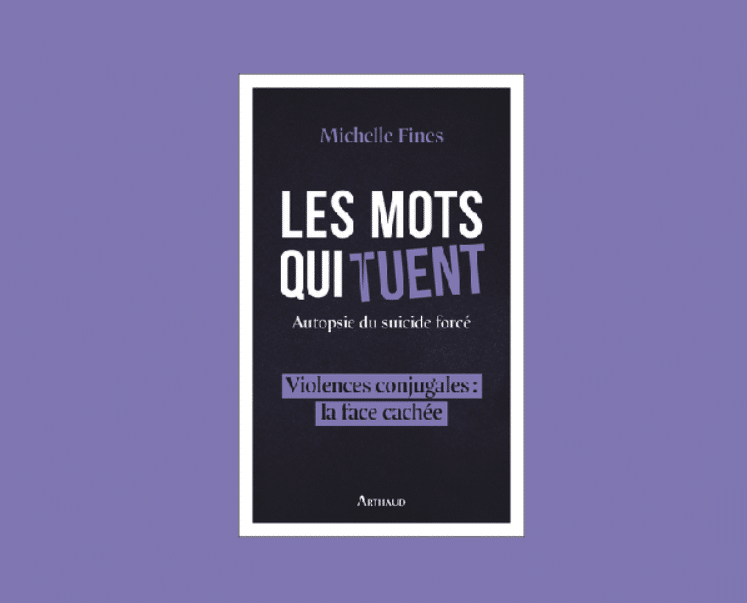L’histoire de l’institution pénale a mis en rivalité l’aumônier et le psychiatre, alors qu’il est indispensable, face à la complexité de la souffrance morale des prisonniers, qu’ils unissent leurs efforts en bonne intelligence. L’histoire de l’institution pénale et le sens de la peine de prison trouvent leur origine dans la religion, et plus particulièrement dans la vie monastique, comme le souligne l’ouvrage de Jean Mabillon, Réflexions sur les prisons des ordres religieux, publié en 1724. Une rupture majeure s’effectue au moment de la Révolution française, quand l’Assemblée nationale décide d’impliquer le corps médical dans la prise en charge des détenus, et impose la présence des aliénistes (ainsi étaient nommés les psychiatres) aux côtés des aumôniers. Jusque-là l’aumônier était le seul à recueillir les confidences des détenus ; peu à peu, l’on assiste à une laïcisation de l’espace de la prison, par le biais de sa psychiatrisation.
A partir du début du XIXème siècle se développe l’idée d’une science pénitentiaire qui doit permettre de résoudre les problèmes sociaux qui se posent à une société en mutation, en analysant le plus finement possible les ressorts criminels des individus. Il s’agit alors de chercher les rapports du physique et du moral pour tenter de rationaliser les rapports sociaux. La science criminelle s’installe en prison et, avec elle, l’idée que la délinquance est une maladie que l’on peut soigner. Comme l’écrivait déjà Platon dans le Gorgias : « Il ne faut pas chercher à cacher la faute commise (…) Il faut donc se forcer, soi-même et les autres, à ne pas être épouvanté à l’idée de la punition, mais à vouloir se livrer à la justice, plein de confiance et de courage, comme on se livre au médecin qui doit pratiquer incisions et cautérisations »[1] (1).
De la Révolution jusqu’au Second Empire, la proximité des missions que l’Etat attribue au psychiatre et à l’aumônier est étroite, comme en témoigne l’architecture de la prison de la Santé, achevée en 1867 : le centre de la prison est occupé par un bâtiment qui regroupe la chapelle et l’infirmerie. Mais à partir de la Troisième République, la laïcisation de la société française va progressivement exclure la prise en charge de l’âme du prisonnier par l’aumônier au bénéfice de celle de son psychisme par le psychiatre. A partir de 1816, obligation est faite au détenu de déclarer une religion et d’assister au culte ; cette obligation sera maintenue jusqu’au milieu des années 1920, plus de 20 ans après la loi de 1905. Depuis le début du XXIème siècle, une obligation de soins, effectuée par un psychiatre ou un psychologue, est prononcée de plus en plus souvent en complément de la peine d’emprisonnement – et parfois même à sa place. L’intervention de l’aumônier est remplacée par celle du psychiatre, la confession par la thérapie, la charité par le soin[2]. On remarquera toutefois que si la prépondérance des intervenants change, la volonté de l’Etat de contrôler les émotions et les pensées du détenu par la procédure judiciaire et la sanction pénale reste la même.
La rivalité entre psychiatre et aumônier s’est soldée par la victoire du premier, ainsi qu’en témoigne les procès en cour d’assises : si l’expertise psychiatrique est un élément central des débats, à aucun moment l’avis de l’aumônier n’est sollicité. Pourtant, l’Etat demande à l’un comme l’autre d’intervenir pour la même finalité, comme en témoignent les polémiques autour de la prise en charge des détenus radicalisés : il fait une demande comminatoire aux aumôniers du culte musulman de participer, aux côtés du psychiatre, à leur désengagement idéologique.
La rivalité de l’aumônier et du psychiatre est stérile, car leurs rôles sont complémentaires. Ils doivent se renforcer l’un l’autre pour aider le détenu à se réhabiliter moralement et se préparer à réintégrer la société. Cette complémentarité des interventions est indispensable, comme l’illustre la prise en charge d’un type particulier de détenus que sont les délinquants sexuels.
Les aumôniers sont souvent sollicités par les délinquants sexuels qui trouvent une oreille attentive et disponible pour des personnes qui sont rejetées par l’ensemble de la détention, co-détenus et personnel pénitentiaire. Rejet qui aboutit souvent à une violence verbale et physique. Le passage à l’acte du délinquant sexuel n’a pas comme objectif la possession d’un bien matériel, et les enjeux et conflits psychiques sont différents et bien plus importants que pour le délinquant ordinaire. Si certains d’entre eux présentent une pathologie psychiatrique, pour la majorité des autres, il y a une véritable souffrance psychique antérieure à l’agression sexuelle, que la personne n’arrive pas à contrôler et qui l’entraine vers un passage à l’acte, pour soulager la tension mentale qui l’envahit. Conscient du caractère transgressif de son acte, le délinquant sexuel va plus facilement vers l’aumônier que vers le psychiatre, car s’il s’estime coupable d’une faute, il ne se pense pas pour autant souffrant d’une maladie mentale. Ces personnes recherchent davantage un acte de réparation du côté de la morale, que la religion véhicule, qu’un soin qui leur parait trop mécanique et décalé face à leurs besoins. Le suivi psychiatrique est fondé sur une attitude de neutralité bienveillante face au patient, ce qui exclut toute forme d’empathie, de repentance et de pardon de la part du psychiatre. Les aumôniers sont souvent déroutés car beaucoup de ces délinquants sexuels sont dans le déni de leurs actes. Si certains se comportent ainsi du fait d’une pathologie perverse, d’autres se protègent par ce mécanisme psychique, car sans cela, la prise de conscience de l’horreur de leurs actes serait insupportable, et pourrait les conduire au suicide.
Le psychiatre et l’aumônier, en cherchant l’«étincelle d’humanité» qui se cache dans le monstre, sont à la fois les témoins et les acteurs d’une philosophie pénale qui veut que l’homme est capable de changement. La raison principale de leur présence en détention, au-delà de soulager la souffrance spirituelle et psychique des détenus, est de donner un sens à leur peine. Assigné par l’Etat à côtoyer les mêmes détenus, ils sont la caution morale et scientifique de la capacité de l’individu — mais aussi de la société — à se confronter au mal, dans l’espoir de le surmonter.
[1] Platon, Gorgias, Paris, Garnier-Flammarion, 2007, p.209.
[2] Hervé Guillemain, Diriger les consciences, guérir les âmes : une histoire comparée des pratiques thérapeutiques et religieuses (1830-1939), La Découverte, 2006.