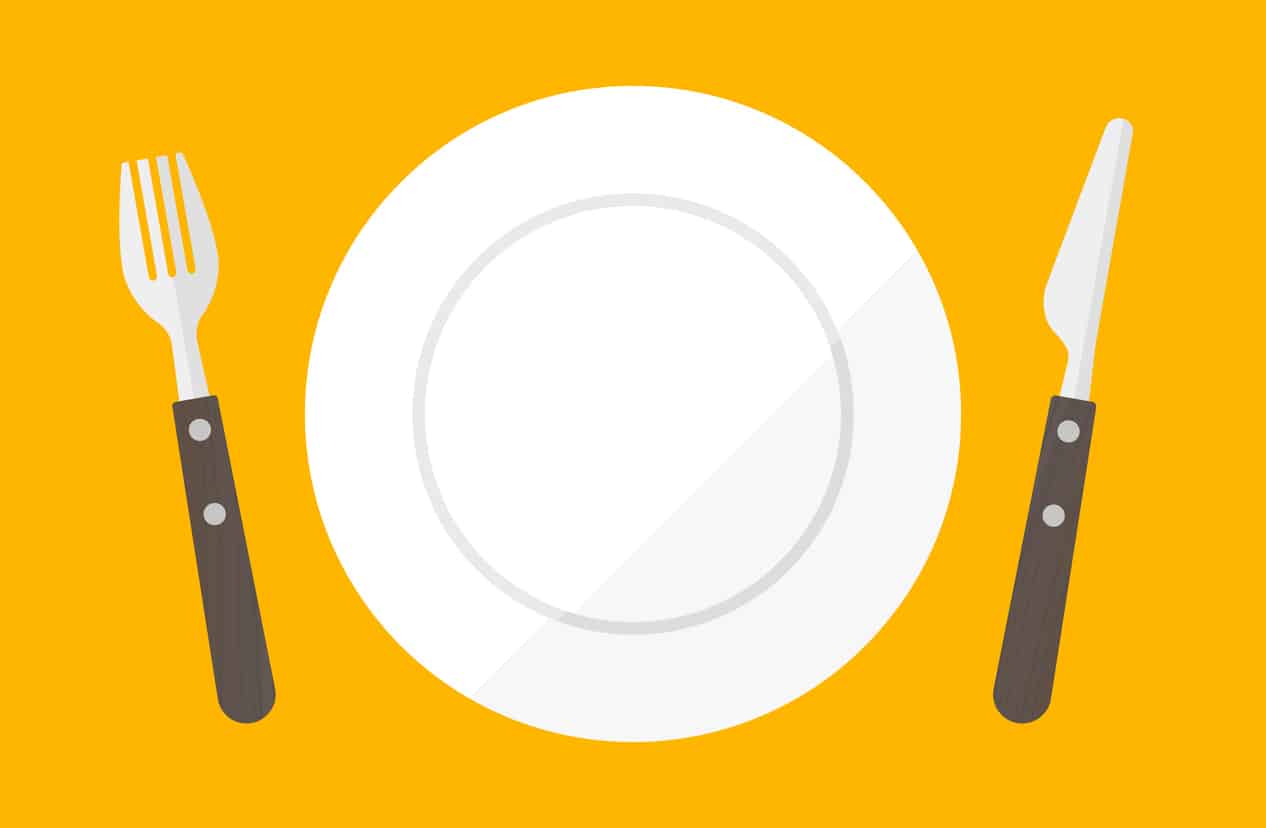Je me souviens d’avoir écrit, il y a trente ans de cela, dans mon mémoire d’habilitation en sociologie, cette phrase qui était d’actualité, à l’époque : « La modernité est désormais condamnée à l’altérité, pour le meilleur et pour le pire. » Bizarrement, seul le mot de modernité semble, aujourd’hui, un peu désuet ! Mais, pour le reste, le thème de la « société éclatée » était déjà au centre des réflexions.
Le grand tournant libéral des années 1980 était passé par là, avec la fameuse déclaration de Margaret Thatcher : « La société est quelque chose qui n’existe pas ! Il n’y a que des individus, hommes ou femmes, et des familles. Et le gouvernement ne peut rien faire sans passer par les gens, et les gens, pour leur part, pensent avant tout à eux-mêmes. » Cette profession de foi individualiste et libérale, de la très méthodiste Margaret Thatcher, donne le ton de tout ce à quoi le protestantisme a pu servir d’alibi par la suite. Dans un tel cadre de pensée, l’autre n’existe pas. À tout le moins, il est inutile de s’en préoccuper. Il vit sa vie et, tant qu’il ne me gêne pas, je peux l’ignorer.
Mais il semblerait que l’autre gêne ! À l’époque, les allergies à l’égard des populations étrangères étaient déjà présentes. Elles n’ont fait que croître et se développer depuis. De plus en plus « d’autres » perturbent apparemment bien des personnes qui souhaiteraient pouvoir les ignorer.
L’effritement du poids des collectifs
Des raisons structurelles justifient ces évolutions. Si l’on regarde des photos de la vie quotidienne d’il y a cinquante ans à peine, on est frappé au premier coup d’œil par l’importance et la taille des groupes qui sont rassemblés à tout propos. Les ouvriers qui sortent des usines font bloc, même s’ils ont une vie dure. Les rues, en dehors même des artères commerçantes, sont peuplées. Les moments festifs remplissent l’espace. Bref, il existe toute une vie collective, avec ses défauts et ses tensions, mais qui a du sens et s’exprime concrètement au jour le jour.
Depuis, les échanges à distance se sont multipliés (le téléphone est devenu moins cher, Internet et le téléphone portable se sont répandus puis ont fusionné). La taille des collectifs de travail n’a cessé de décroître. Et il est de plus en plus facile de vivre, matériellement, sans interagir avec les autres. Les groupes sociaux ont, certes, toujours été clos sur eux-mêmes. Mais la multiplication des moyens de communication n’a nullement facilité la communication entre des personnes d’horizons différents. Au contraire, elle a rendu possible de passer plus de temps avec ceux qui nous ressemblent.
Le rapport à l’autre, moins indispensable, mais toujours salutaire
On peut donc se passer des face-à-face avec un grand nombre de personnes. Même les achats peuvent se faire à distance. Dans les entreprises, et même les services publics, les décisions les plus contraignantes et les plus douloureuses viennent d’officines lointaines qui n’ont pas de visage. Mais tout cela nous fragilise collectivement et individuellement. Avant même l’épidémie de covid, on avait remarqué que, depuis 2010, les épisodes anxieux et dépressifs avaient brutalement augmenté (multipliés par 2 pour les hommes et par 1,5 pour les femmes).
En fait, l’autre, absent ou lointain, se pare de toutes les caractéristiques de l’être bizarre, incompréhensible et menaçant. L’autre, présent et proche, nous énerve et nous fatigue sans doute, à l’occasion, mais il nous stimule également. Il nous soutient quand nous perdons courage. Il nous enrichit. Au risque de faire de la psychologie sociale un peu grossière, j’ai observé que les personnes qui acceptent de s’impliquer dans des réseaux de relations de proximité vont d’autant mieux que ces réseaux sont divers et qu’ils les sollicitent de manière profonde.
J’ai du mal à comprendre de plus en plus de personnes et de groupes
Il n’en reste pas moins que nous continuons à nous éloigner les uns des autres et que, moi-même, qui avais fait mon métier de l’exigence de comprendre les autres, de restituer leurs ressorts d’action, le sens de leur pratique, je dois constater que j’ai du mal à saisir l’attitude d’un nombre croissant de personnes.
J’ai entendu, à l’occasion, des conversations ordinaires truffées d’injures entre usagers à l’arrêt de bus, sans comprendre leur sens à vrai dire, ni m’expliquer comment ils parvenaient à s’entendre les uns les autres (sans que les discussions dégénèrent en rixe non plus). Mais c’est le genre de discours que l’on trouve fréquemment sur les réseaux dits « sociaux ».
J’ai discuté aussi avec des personnes ancrées dans des théories parallèles (pas forcément complotistes). Les échanges d’idées demeuraient courtois mais ressemblaient à un dialogue de sourds. Ce n’est même pas un socle de croyances partagées qui fait défaut. Il n’y a plus d’entente sur ce qui pourrait constituer une preuve, un indice, un élément matériel qui ferait avancer le débat. Tout devient affaire d’affirmations gratuites.
Il est très difficile de ne pas perdre pied face à ces élaborations qui sont pourtant monnaie courante dans beaucoup de milieux et ont tendance à se répandre, peu ou prou, dans toutes les sphères. On a l’impression que l’autre est devenu tellement différent qu’on a du mal à trouver un moyen de le rejoindre. Au-delà du conflit, c’est l’ignorance mutuelle qui s’installe.
Le Bon Samaritain nous montre la voie
Face à une telle perplexité, la parabole du Bon Samaritain m’ouvre une voie très pertinente. On peut, en effet, s’interroger longuement pour savoir qui est proche de moi, jusqu’à quel point il est proche, en quoi je dois être solidaire avec lui. Ou bien ruminer longtemps les menaces, réelles ou imaginaires, que les autres font peser sur nous.
Mais la parabole met en scène un autre qui s’approche de moi et fait preuve de bienveillance malgré nos différences. Et lorsque je me remémore quelques-uns des « autres » qui m’ont secouru quand j’étais en difficulté, blessé sur le bord de la route, victime de la violence du monde, je change radicalement de point de vue. Oui, ils sont nombreux et divers ceux qui m’ont tendu la main au bon moment. Ils étaient autres, mais ils se sont rendus proches, ne serait-ce que quelques instants.