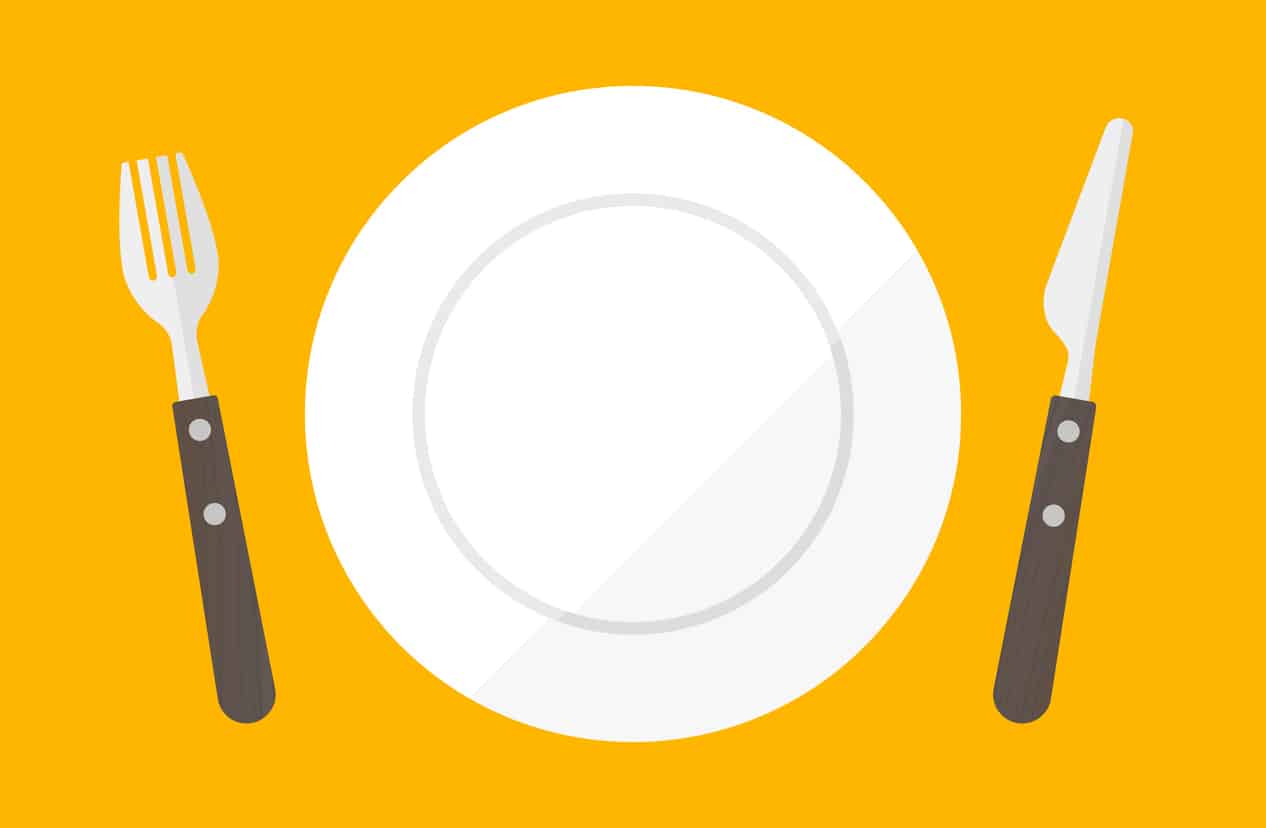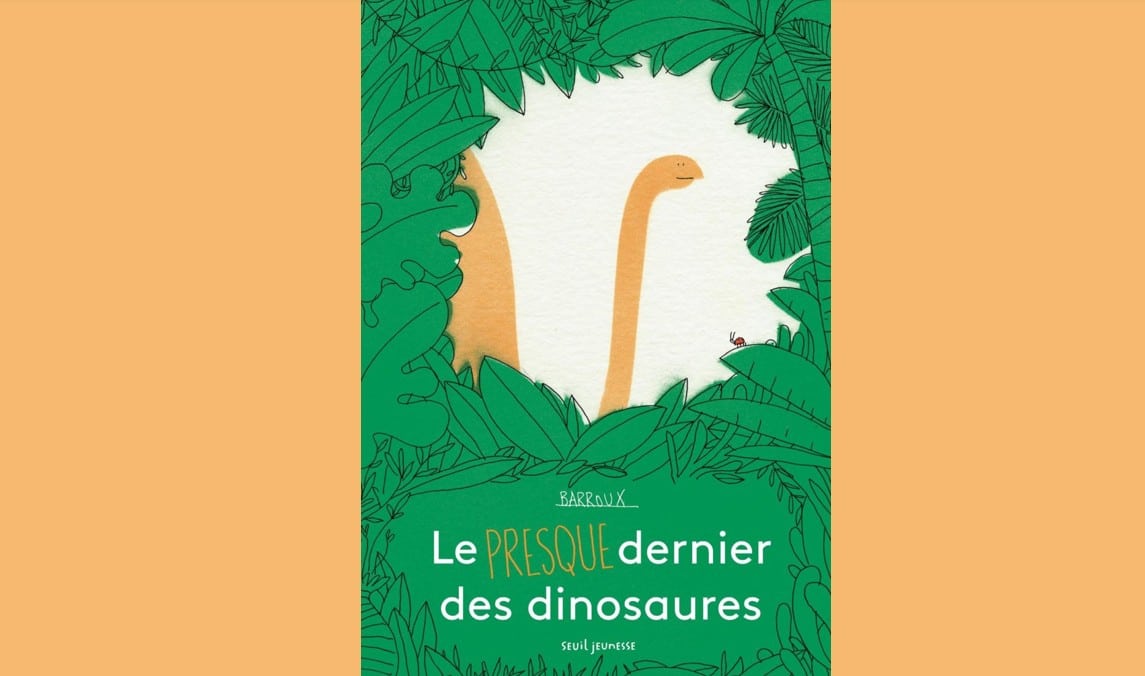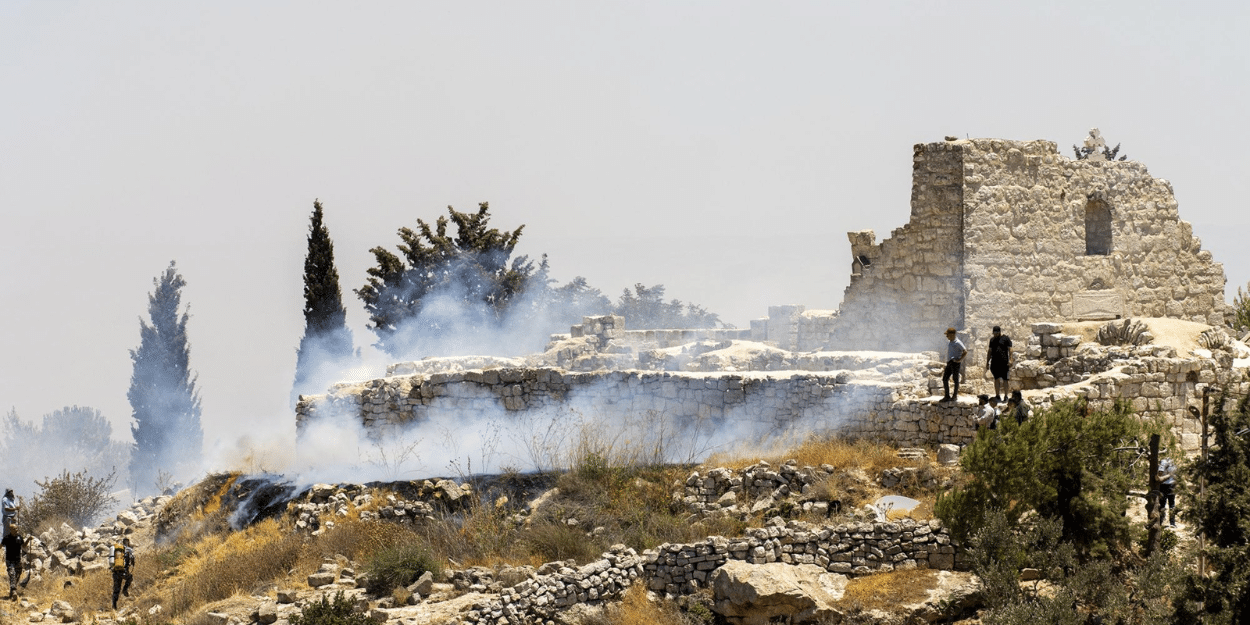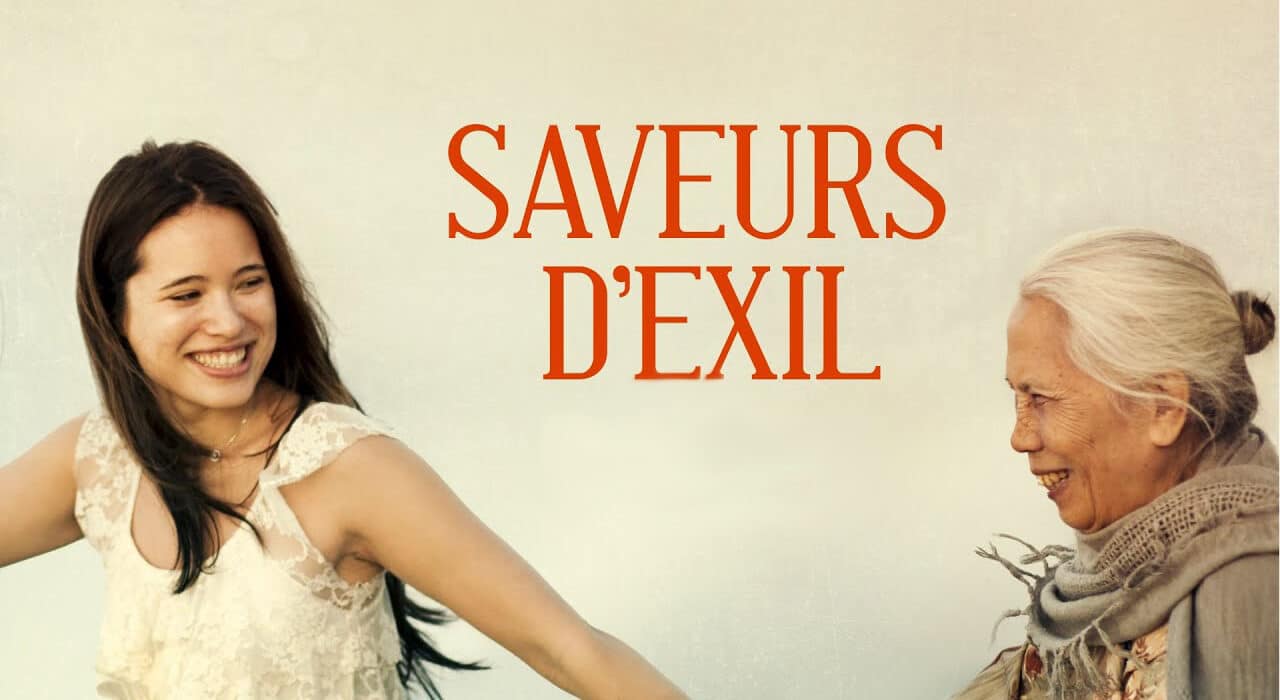Dans les établissements et associations adhérents à la FEP, « l’autre » prend de plus en plus souvent les traits du musulman, qu’il soit accueilli, salarié ou bénévole. Sa pratique religieuse, parfois visible et fervente, bouscule les membres des structures d’accueil. Celles-ci ne sont toutefois pas sans ressource pour recevoir l’altérité culturelle et religieuse.
L’enquête sociologique récemment menée, à la demande de la FEP dans une quinzaine de structures adhérentes montre que la relation à l’autre n’est pas toujours sans friction, et c’est bien normal ! Pour grandir, nous avons aussi besoin de vivre des différends. Mais les situations délicates ne doivent pas occulter les deux grandes tendances observées durant cette enquête : une grande majorité de musulmans, même observants, s’adaptent aux règles des institutions sans chercher à imposer ce qu’ils considèrent comme leurs obligations cultuelles ; la plupart des structures procèdent déjà à des aménagements pour faciliter le culte musulman (repas sans viande, allègement des programmes lors du ramadan…).
Le savoir-faire des « reconnaissances de l’autre »
Peu de cas conflictuels, causés par des attitudes délibérément provocatrices de quelques activistes islamistes, ont été relevés. Plus courantes sont les situations de malaise, dues à une mauvaise compréhension de la laïcité ou des crispations identitaires chez des bénévoles non musulmans. Mais globalement, les trois modes de « reconnaissance de l’autre » qu’avait théorisés Axel Honneth en 1992 sont déjà à l’œuvre. La reconnaissance affective correspond aux valeurs chrétiennes et à l’accueil inconditionnel ; la reconnaissance juridique dépend principalement des lois républicaines ; la reconnaissance solidaire permet d’œuvrer à un projet commun qui transcende les individualités. L’ancrage protestant des établissements et associations, dont certains intègrent pasteurs, aumôniers ou accompagnateurs spirituels, favorise un quatrième mode de reconnaissance : la reconnaissance spirituelle.
Des personnes musulmanes ouvertes au dialogue
Souvent présenté comme une religion exogène, l’islam est en réalité une religion judéo-chrétienne : le Coran ne cesse de se référer à la Bible et à ses prophètes, le culte musulman majoritaire est proche du culte juif orthodoxe, avec une souplesse héritée du message évangélique. De fait, dans les structures enquêtées, les personnes musulmanes participent volontiers aux « moments spi » proposés ; en cas de décès de résidents musulmans dans un Ehpad, des moments d’adieu interconfessionnels sont organisés sans difficulté. Dans des foyers pour personnes en situation de handicap mental, des temps de prière ou de méditation peuvent réunir soignants, bénéficiaires et ministres du culte. Des espaces de prière polycultuels pourraient être partagés entre croyants de différentes traditions.
Autre fait marquant, des personnes musulmanes ferventes sont en demande de discussions sur la foi, les Écritures et les pratiques religieuses chrétiennes. Les ressources religieuses des uns et des autres, souvent peu mobilisées en raison d’une mauvaise compréhension du principe de laïcité, pourraient permettre une meilleure cohésion au sein des structures et favoriser des relations humaines plus riches et profondes.
L’autre musulman n’est ainsi ni menace ni promesse : chrétiens et musulmans ne placent-ils pas leur sauvegarde et leur espérance en Dieu seul ? L’autre est un cadeau, une belle occasion de mieux se connaître soi-même, une invitation à faire preuve de créativité sur le chemin emprunté ensemble.