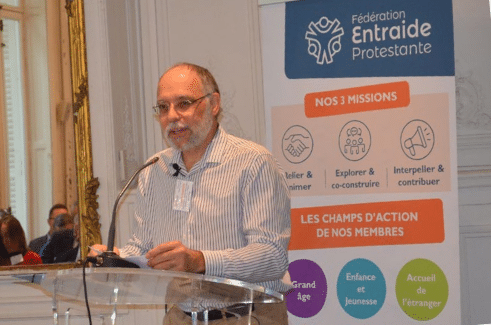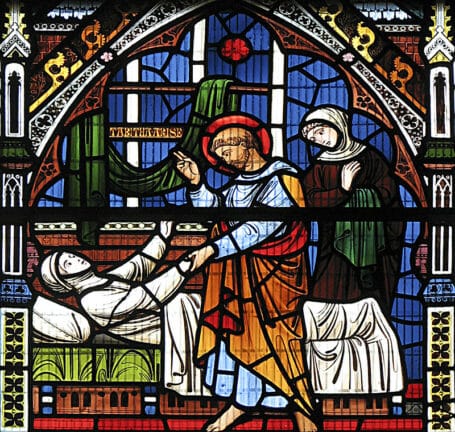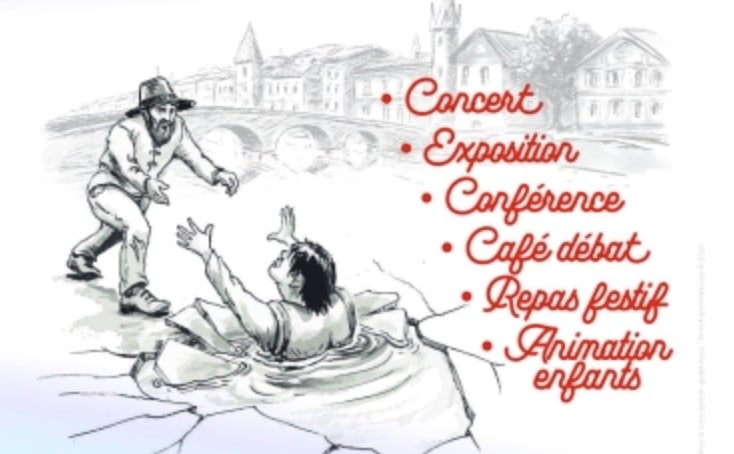Les métiers du soin sont-ils dévolus aux femmes ?
Les résidents des Ehpad sont, à 74 %, des résidentes. Les soignants, des soignantes neuf fois sur dix. Peu d’hommes sortent des instituts de formation. Historiquement, les femmes s’occupaient du foyer, des enfants, et souvent des parents âgés. Lorsqu’elles ont commencé à travailler après-guerre, au nom de cette aptitude « naturelle » au soin, beaucoup d’entre elles ont rejoint des maisons de retraite de proximité où elles faisaient peu ou prou la même chose qu’à la maison. On les a « dédommagées » avec un petit pécule, et leur fonction a été invisibilisée. Les métiers du soin n’étaient pas pour les hommes, d’autant plus qu’ils étaient sous-valorisés financièrement. C’est toujours le cas, mais plus on monte dans la hiérarchie, plus on a une grande proportion d’hommes. Le pouvoir, c’est valorisant pour les hommes.
Est-ce que la douceur, l’écoute, l’empathie, sont des attributs féminins innés ?
Je ne crois pas. L’anthropologie a montré qu’en Afrique notamment, si le bébé est un garçon, la mère lui donne le sein au premier pleur ; si c’est une fille, elle la fait attendre pour lui apprendre la patience…
Je crois que le care est fondé sur l’émotion. Or, les hommes n’expriment pas facilement leurs émotions. La patience, la bienveillance… un homme aussi est capable d’éprouver tout ça, mais l’éducation fait que souvent il ne s’y autorise pas. On lui a appris qu’un garçon ne pleure pas ! Il faudrait revoir l’éducation des garçons. Et lutter contre les stéréotypes culturels.
Face à quelqu’un de vulnérable, pour que ma réponse s’inscrive dans l’éthique du care, il faut que je repère son besoin. Je peux utiliser mes émotions ou les techniques que j’ai apprises lors de ma formation. Les femmes étant davantage enclines, culturellement, à écouter leurs émotions, elles identifient plus facilement les besoins de l’autre. De ce fait, on a pensé qu’il était moins nécessaire de les former ; mais cela est en train de changer fort heureusement.
L’émotion est donc une alliée précieuse dans le soin ?
Oui, à condition d’apprendre à la gérer et d’en faire un atout dans la prise en soin. Mais de plus en plus
d’écoles enseignent aux futurs soignants à ne pas s’impliquer émotionnellement. C’est une mauvaise idée car si on n’éprouve rien face à l’autre vulnérable, on déshumanise la relation. L’humain est un individu émotionnel. Est-ce qu’on soigne mieux quand on réprime ses émotions ? Je ne suis pas sûre.
Avec le vieillissement de la population et les carences de soignants dans les établissements, on assiste à une déshumanisation des soins. Le temps manque et les soins sont trop rapidement exécutés, sans tenir vraiment compte de la personne soignée. Un soin ne devrait jamais devenir « un travail à la chaîne ».
Dans ma pratique, j’ai souvent observé que les soignantes qui ont une spiritualité font la différence. La foi est un moteur qui les anime et donne du sens à ce qu’elles font.
La mixité dans les équipes est-elle un plus ?
Quand il y a dans les équipes des hommes qui laissent exprimer leurs qualités dites féminines, ils sont très appréciés par les collègues. Comme par les résidents. J’ai en tête un soignant avec lequel j’ai travaillé et que tout le monde adulait au point que, quand une aide-soignante entrait dans une chambre, c’était la déception : «Ah, c’est vous? David n’est pas là?» Bien sûr, s’il y avait plus d’hommes dans les équipes, ce serait formidable, d’autant que ce sont des métiers très physiques. Je crains qu’on ne les y trouve pas tant que les métiers du soin ne seront pas valorisés.