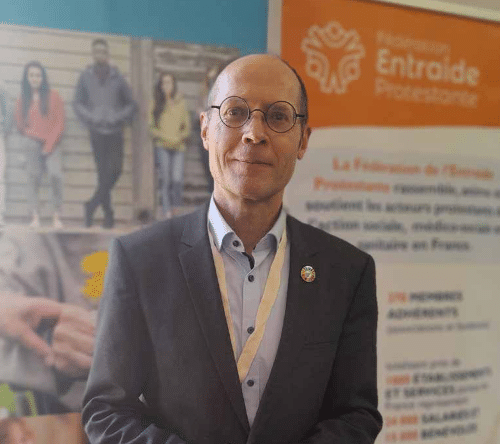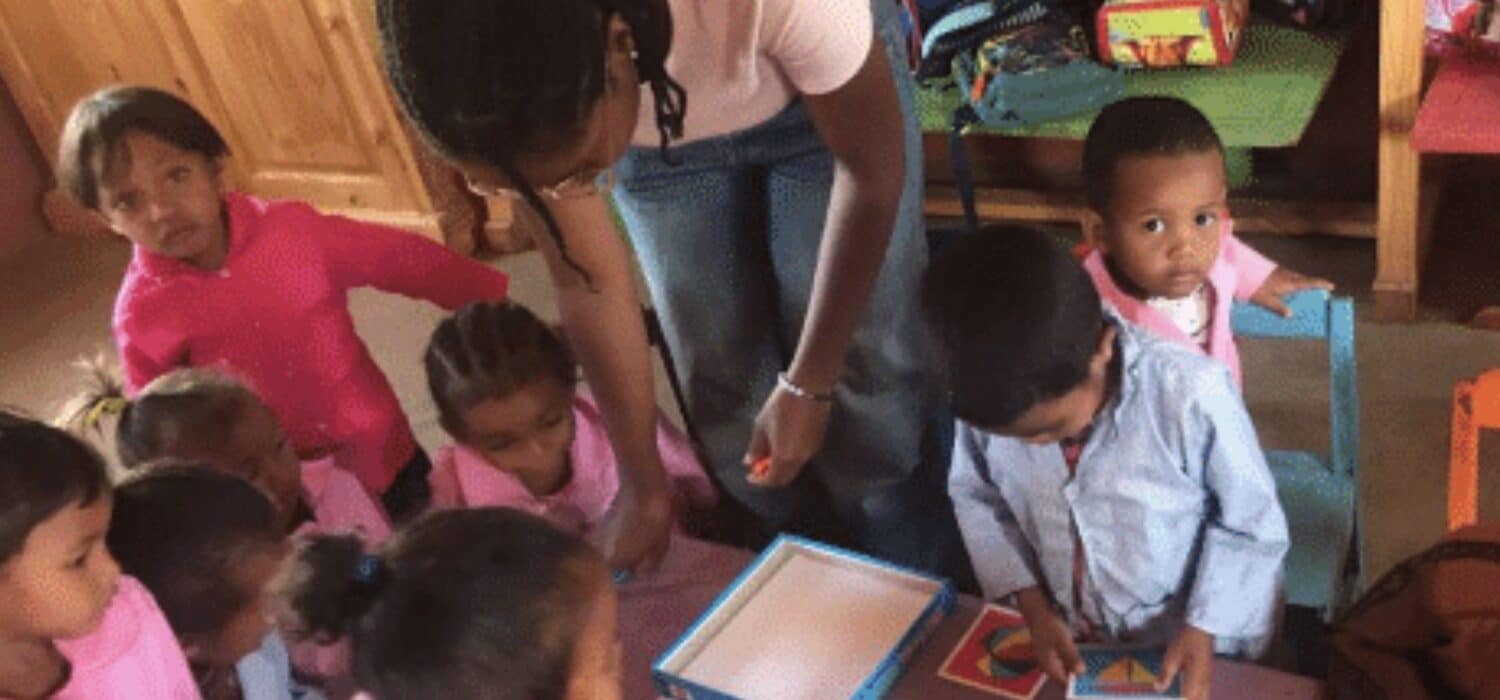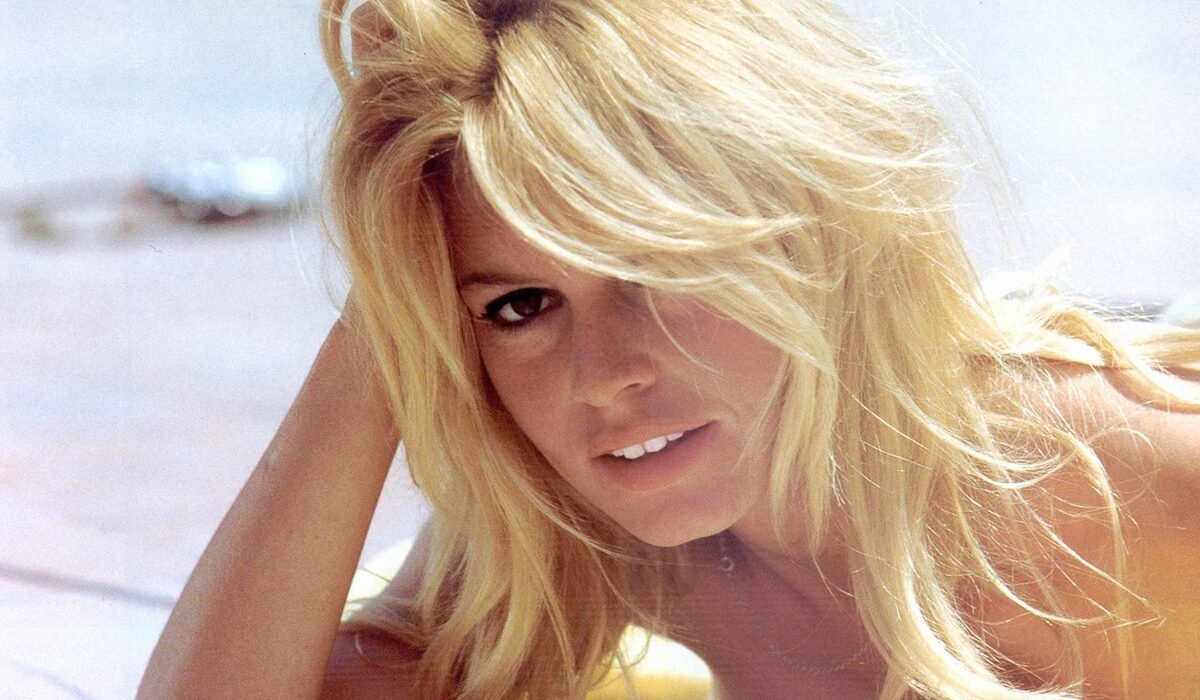Pourquoi est-ce si important d’évaluer son impact social ?
Les mesures d’impact social se développent pour qu’on puisse s’assurer que les gouvernements investissent dans les services sociaux, et pour pousser les organisations qui offrent ces services à maximiser leur efficacité. La difficulté principale est qu’on mesure beaucoup mieux certains impacts que d’autres. Les impacts économiques, notamment l’amélioration du capital humain, de la qualification, qui permet aux personnes d’être employables, sont plus aisément quantifiables que le bien-être, le capital social (ce qui nous permet de « faire société ») ou encore la capacité de concilier vie professionnelle et vie privée. Bien des dimensions extrêmement importantes de la vie des gens se mesurent très mal.
Les mesures d’impact orientent-elles les politiques publiques ?
On a beaucoup progressé sur les indicateurs de bien-être et sur notre capacité à mesurer autre chose que l’augmentation des possibilités de consommation matérielle et le produit intérieur brut. Mais ces mesures n’ont pas abouti à des changements dans la manière dont les politiques sont conduites. Les gouvernements comprennent qu’il faut des indicateurs de progrès alternatifs mais n’essaient pas fondamentalement de faire se modifier notre manière de produire et de consommer. Ils ne tirent pas les conclusions de ce que ces indicateurs montrent et ne changent pas de cap. Ils se limitent à focaliser leur attention sur la quête d’autres instruments de mesure.
La croissance économique prévaut ?
Au sortir de la guerre, on a concentré les efforts sur l’augmentation de la production et de la consommation parce qu’il y avait des pénuries et nécessité d’investir dans des infrastructures. Il fallait satisfaire des besoins essentiels. Mais la poursuite continue de la croissance est devenue contre-productive : à force de s’entêter à créer de la croissance économique, de la richesse monétaire, on néglige des questions essentielles de distribution, d’équilibre, on échoue à interroger les gens sur la qualité de leur vie et sur le capital social.
Les professionnels sont-ils réticents aux mesures d’impact ?
Tant que les mesures d’impact sont focalisées sur ce qui contribue, à travers les indicateurs quantitatifs définis à cette fin, à la performance économique, je comprends qu’on s’en méfie. Personne n’a envie de voir son travail réduit à la question de la richesse qu’il crée, a fortiori si cela se limite au court terme. La méfiance vis-à-vis des mesures d’impact tient au fait qu’elles ont trop souvent légitimé une approche purement économique du travail et de l’investissement social. Ce qui est très réducteur et contre-productif.
Cette méfiance engendre-t-elle un mal-être au travail ?
J’ai vu beaucoup d’incompréhension par rapport à des objectifs quantitatifs fixés sans prise en compte des contraintes réelles du travail social. Il y a une véritable transaction, un trade-off, entre la qualité de l’accompagnement social et l’obligation de faire du chiffre. Beaucoup de travailleurs sociaux sont de plus en plus mal à l’aise par rapport à leur travail parce qu’ils sont soumis à des obligations de performance, quantitativement évaluées, incompatibles avec l’éthique de leur métier.