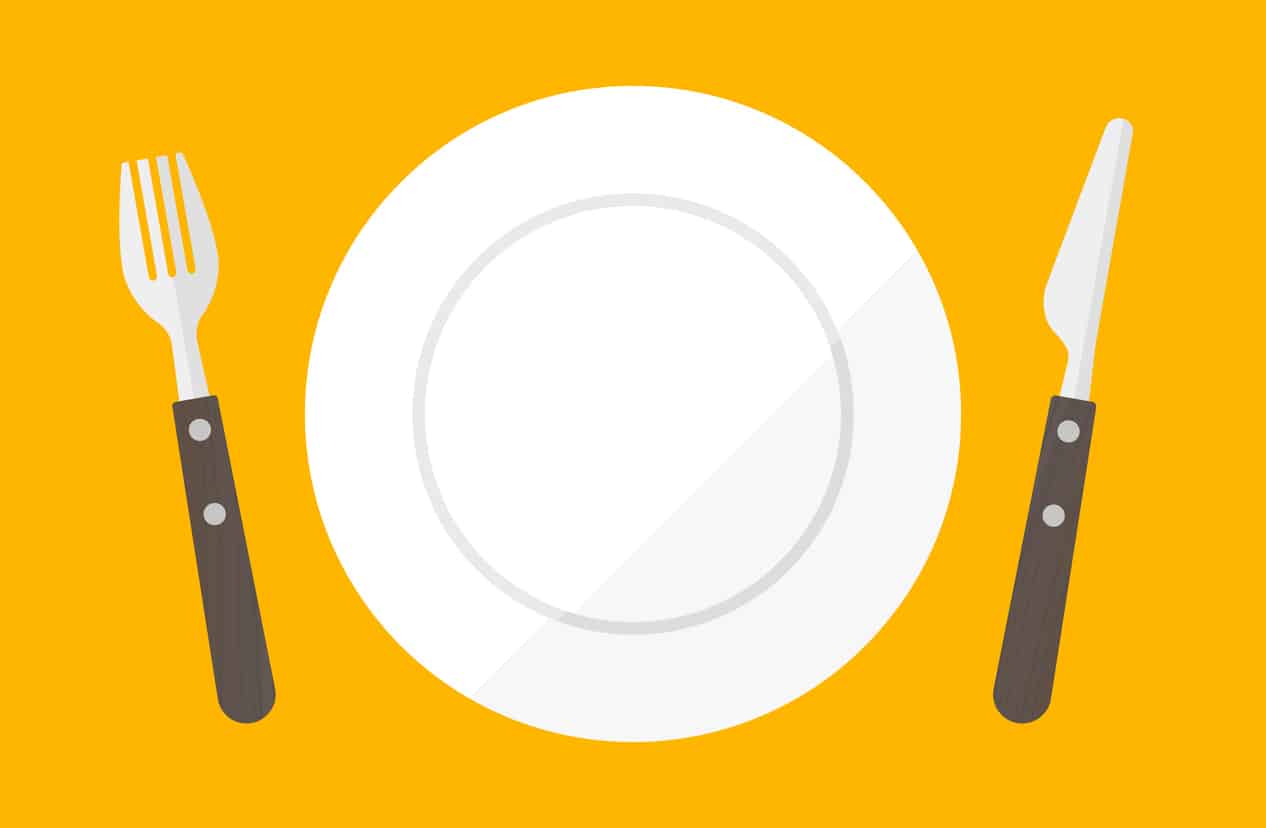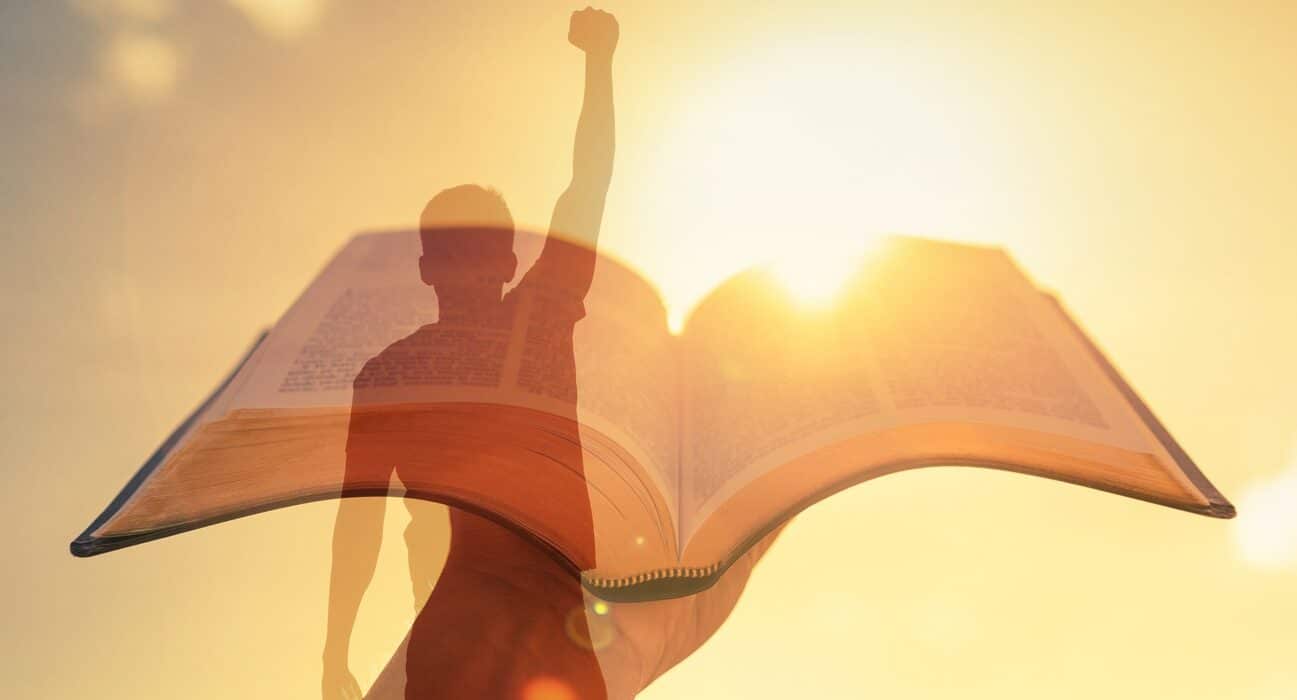Laurence vient de prendre sa retraite. Dynamique, la sexagénaire s’interroge : vers quelle association se tourner pour lutter contre les injustices sociales ? Très engagée jusque-là dans son travail et sa vie familiale, elle n’a aucune expérience du bénévolat. Une chose est sûre cependant : elle ne consacrera pas à cette activité plus d’un jour par semaine. Lucide, elle commente : « Je ne veux pas me relancer dans un mi-temps bénévole alors que je découvre une forme de liberté. »
Poser des limites
La posture de Laurence est révélatrice. Qui ne connaît pas des enfants de militants ou de pasteurs d’hier qui déplorent de ne jamais avoir vu leurs parents, accaparés par des engagements trop chronophages ? « Ils s’occupaient beaucoup des autres et pas assez de nous », regrette ainsi Béatrice.
Le pasteur et théologien Michel Bertrand commente : « Dans le domaine vocationnel, où l’on a vraiment choisi d’être là, la tentation existe d’aller au-delà de ses capacités émotionnelles ou physiques, il est donc très important qu’il y ait un cadre. » Ainsi de plus en plus d’associations établissent un contrat avec le bénévole, pour qu’il sache où il met les pieds, ce qu’on attend de lui et… ce qu’on n’en attend pas. Car le risque de toute-puissance guette toujours. Mu par sa foi et ses convictions, le volontaire pense qu’il va faire « bouger la montagne ». Son enthousiasme est indispensable, ses idées nouvelles aussi, mais il faut poser des limites.
Michel Bertrand insiste : « Parmi les garde-fous, il y a tout d’abord la collégialité. Il y a le projet associatif commun et la nécessité de rendre compte au groupe de ses actions, de communiquer sur son expérience, de partager ses questions et ses doutes. Le bénévole n’a pas à se créer son propre couloir de nage. L’autre facteur majeur est celui de la formation et, là encore, les associations ont fait un pas de géant. »
Se former
Se former est en effet indispensable, tout comme réfléchir sur les raisons conscientes et inconscientes de son engagement. La bonne volonté ne suffit pas. Elle peut même faire des dégâts. C’est pourquoi il est important de rappeler que, dans le bénévolat, on donne et on reçoit. Gabrielle, coprésidente d’une association de réfugiés, le répète à chaque réunion : « J’insiste sur le fait que l’action bénévole apporte de nombreuses rétributions symboliques. Certes, elle est gratuite sur le plan pécuniaire mais elle nourrit l’estime de soi, la création de liens, l’assurance de prendre sa part dans la marche de la société. Je le redis sans cesse, nous ne sommes pas là, ensemble, pour en baver mais bien pour agir joyeusement. »
Quant aux résultats de l’action, doit-on et peut-on les mesurer ? Si, dans le monde professionnel, il peut être plus facile d’établir des grilles d’évaluation, la culture du chiffre n’est pas au cœur de l’engagement bénévole, notamment dans un cadre chrétien. « Quand on est porté par le service de l’autre, quand il s’agit d’accompagner quelqu’un dans la durée pour l’aider à se remettre debout, le chiffre dit bien peu. Et je n’aime pas l’idée d’évaluation car on tombe vite dans des jugements de valeur », poursuit Michel Bertrand.
La persévérance, la capacité d’inventer, l’écoute sont-elles quantifiables ? Et quand survient l’échec ou le constat d’impuissance, l’essentiel n’est-il pas d’être là, à côté, parfois même silencieusement ?